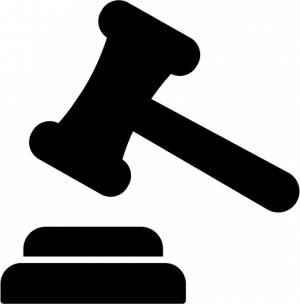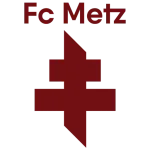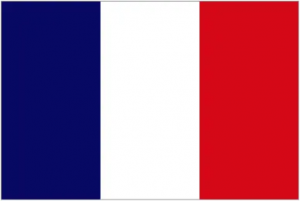- International
- Interview
Ivan Ćurković : « Je ne suis pas yougo-nostalgique »

Ancien gardien des Verts durant la fameuse épopée de 1976, Ivan Ćurković, « Yougoslave et catholique » de naissance parle de son enfance, de son ancien pays et de son football, réputé comme l’un des plus techniques de l’histoire.
De quelle nationalité êtes-vous ?Je suis catholique et de nationalité yougoslave. Je me considère et me présente toujours comme tel. Chez nous, si vous êtes catholique, vous êtes croate. Si vous êtes orthodoxe, vous êtes serbe. En France, ça ne marche pas comme ça. Chez vous, catholiques, protestants ou orthodoxes, vous êtes français. Chez nous, c’est un peu bizarre. On est d’une nationalité par rapport à une confession.
Que veut dire être yougoslave ?Ça veut dire être né dans un pays qui s’appelle la Yougoslavie. J’ai fini mes études dans un pays qui s’appelle la Yougoslavie. Quand je suis arrivé en France, j’étais fier d’appartenir à mon pays. Durant mon enfance, j’ai été élevé comme un bon citoyen et dans une certaine justice sociale. On avait une sécurité sociale gratuite.
On a vécu dans un pays qui nous donnait des choses essentielles. Et puis il y avait quelqu’un qui s’appelait Tito, un président que j’ai connu et qui m’a énormément marqué. Je ne pourrai jamais l’oublier. Après beaucoup de choses se sont passées. Aujourd’hui, je vis en Serbie, j’y suis très bien, je respecte énormément ce pays. Dans toute ville où j’ai pu jouer comme à Zagreb en Croatie, Ljubljana en Slovénie, Skopje en Macédoine, Sarajevo en Bosnie-Herzégovine ou au Monténégro, j’y ai toujours senti ce lien d’appartenance, sportif ou culturel. Je m’y sens comme chez moi malgré le passé récent qui n’a pas été facile. Je n’ai jamais renié quelque chose que je porte en moi.
Vous regrettez que la Yougoslavie n’existe plus ?Je ne suis pas un yougo-nostalgique. C’est fini, mais c’est une époque qui m’a marqué, une période de bonheur pour moi et mon entourage. Aujourd’hui, on vit dans un État différent, mais je vis sans réelle nostalgie, je vis très bien. J’ai vécu en France, à Belgrade en Serbie. Mais je garde les bons souvenirs qui m’ont marqué.
Aujourd’hui quelle équipe nationale supportez-vous ?Mon cœur bat avant tout pour l’équipe de Serbie. Ce sont les successeurs de la Yougoslavie d’une certaine façon. J’ai été dirigeant, vice-présent et même sélectionneur de ce pays durant les années 2000. Mais ma deuxième équipe, c’est la France.
Pas la Bosnie-Herzégovine, contrée dans laquelle vous êtes né ?Je suis bien sûr attaché à cette équipe, c’est la République où je suis né, j’ai des amis là-bas. Mais vous savez, j’ai aussi des amis en Croatie, Slovénie, Macédoine, au Monténégro. Nous nous connaissons tous. Je suis un supporter serbe, mais je me réjouis toujours si une équipe de l’ancienne Yougoslavie se qualifie pour un tournoi européen ou mondial.
Avec votre papa, vous alliez voir le Velez Mostar.Mon père était un joueur amateur. C’est lui qui m’a transmis le virus du football. Avec lui, je supportais le Mostar. À l’époque, on y disputait le championnat de Yougoslavie sur un terrain en terre battue. Le Velez Mostar a eu son vrai stade en 1958.
À 14 ans, vous intégrez le club et devenez le plus jeune pro du pays.Pendant deux ans, j’y ai fait de la natation, c’était un club multisports. Le football restait toujours sacré pour moi, mais mes entraîneurs étaient contre.
En 1956 ou 1957, le Mostar a organisé un tournoi de quartier pour recruter les jeunes talents. J’ai commencé dans le but. On m’a remarqué et j’ai signé ma première licence pour les juniors du Velez. J’ai commencé comme ça, sur la terre battue. J’avais les coudes et les genoux en sang tout le temps, mais j’ai continué et je me suis très vite révélé. J’ai commencé en pro à partir des années 1960 dans un match contre l’Étoile rouge, un monstre sacré. Et puis, au moment de partir, j’ai eu la possibilité de choisir entre les quatre grands clubs qui dominaient le football yougoslave à l’époque : le Partizan, l’Étoile rouge, le Dinamo Zagreb et l’Hajduk Split. J’ai choisi le Partizan.
Pourquoi ?C’était une grande équipe de champions. Il y avait beaucoup d’internationaux dont un gardien qui s’appelait Šoškić, une grande vedette à l’époque. Quand je suis arrivé, il est parti faire son service militaire, obligatoire à l’époque. J’ai pris sa place, on a gagné le championnat. En 1966, il est revenu, le Partizan jouait la Ligue des champions. On se partageait les matchs de championnat, mais en Coupe d’Europe, c’était lui le titulaire. Cette saison-là, le Partizan a été exceptionnel en Coupe d’Europe des clubs champions. On est arrivés en finale contre le Real Madrid en 1966 à Bruxelles. On a perdu malheureusement 2-1. C’était ma première finale de Ligue des champions.
La rivalité entre le Partizan et l’Étoile rouge de Belgrade ?Une très grosse rivalité. Elle existe depuis la création des deux clubs, qui ont été reconstitués, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. Le Partizan été constitué de militaires. Ils se faisaient appeler les Partizans. Des joueurs, des résistants, sont arrivés de toutes les anciennes républiques yougoslaves. Ce club était un symbole de l’unité du pays, un club multi ethniques qui représentait la Yougoslavie dans sa diversité et quelques-unes de mes idoles y jouaient. Je ne regrette pas mon choix.
Depuis l’éclatement de la Yougoslavie, la ville de Mostar est divisée en deux communautés : croate et bosniaque, comment ça se passe ?Avant cette guerre qui a éclaté dans les années 1990, toutes les communautés vivaient bien, il y avait de l’amitié, de la compréhension. On ne savait pas de quelle religion vous étiez.
Malheureusement, dans une guerre civile, il y a toujours un mélange entre la foi, la nationalité. Dans une telle situation, tout éclate. Je n’étais pas à Mostar à ce moment-là, mais ma famille y était. Ça a été une période terrible. Le club, qui avait l’étoile rouge comme symbole depuis toujours, a été marqué comme une équipe musulmane et a dû prendre un petit stade en périphérie. La ville a dû être aussi partagée en quartiers différents. Beaucoup se sont exilés. J’ai quitté Mostar en 1991. J’y avais fait construire une grande maison. Je n’y suis pas revenu avant 2002. Mon jeune frère a été assassiné par un sniper depuis l’autre côté de la rivière. C’est une tragédie.
En 2002, lorsque vous êtes revenu dans cette maison. Qu’avez-vous ressenti ?De la tristesse, mais je me suis comporté en homme. J’ai gardé mes amis serbes, croates, etc. Ils étaient tous des amis de longue date et je n’ai jamais perdu contact. Aujourd’hui, dans mon esprit et dans mon cœur, Mostar reste comme avant. J’y vais une, deux fois par an.
En sélection, comment ça se passait entre les différentes ethnies ?Vous savez, même durant ce conflit, le sport nous a unis. Il ne nous a jamais séparés.
On se connaît, on est amis de longue date. L’amitié sportive est la plus profonde, la plus soudée, la plus vraie. Beaucoup plus que l’amitié politique et du business où il y a de l’intérêt. Dans le sport, on est liés par l’émotion. On gagne ou on perd. On se voyait toujours, on était toujours ensemble. Malgré le conflit, on est toujours resté amis.
Malgré plusieurs belles générations de joueurs, réputés pour leur technicité, la Yougoslavie n’a remporté « que » les JO.Nous avions des joueurs de talent, mais composer une équipe est très difficile. On manquait un peu de professionnalisme et on n’avait pas le sens de l’improvisation. Il nous aurait fallu le réalisme allemand, la persévérance des footballs espagnol et italien. À l’époque, le professionnalisme qu’on trouvait dans les principaux pays de football n’existait pas chez nous. On manquait aussi parfois de caractère malgré une bonne tactique et des joueurs techniques.
Propos recueillis par Flavien Bories