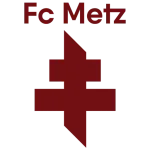- États-Unis
- Disparition
Henry Kissinger : la diplomatie du soccer
On le connaissait comme le stratège de la diplomatie américaine lors de la guerre froide, déroutant Prix Nobel de la paix 1973. Ce qu’on sait moins, c’est que le docteur Henry A. Kissinger, né en Bavière en 1923 et décédé le 29 novembre dernier à 100 ans, entretenait un étrange et fol amour avec le jeu préféré du reste du monde.

En pleine guerre froide, un jour de 1970, à Washington DC., Bob Haldeman, alors chef de cabinet de la Maison-Blanche, voit son bureau recouvert de photos glanées par le conseiller à la sécurité nationale du président, Henry Kissinger, encore sous le choc de sa découverte.
– Alors voilà… s’aventure Kissinger.
– Voilà quoi ?, lâche Haldeman.
– Ces photos ont été prises par un avion espion au-dessus de Cienfuegos, un port cubain, et montrent que des terrains de soccer sont actuellement en construction, explique Kissinger. Avant de déclarer, le plus distinctement possible : Ces terrains pourraient signifier que nous sommes en guerre, Bob.
– Tiens donc. Et pourquoi ?
– Les Cubains jouent au baseball. Les Russes jouent au soccer.(1)
Kissinger expliquera en 1979 au Time Magazine, qu’« une photographie montrait que deux nouveaux baraquements, des locaux administratifs et des terrains de sport étaient apparus sur l’île et qu’un terrain de soccer était clairement visible. Dans [son] esprit, ce ne pouvait être qu’une base russe, parce que le vieil amateur de soccer [qu’il était] savait que les Cubains jouaient rarement au soccer et auraient de toute façon construit un terrain de baseball en premier. » Nixon réactiva alors le téléphone rouge, créé huit ans auparavant lors de la crise des missiles, et le conflit fut – momentanément – désamorcé.
Le stade, lieu de confiance
Le jeune Heinz Alfred Kissinger naît à Fürth, en Bavière, en 1923. Solitaire et réfléchi, toujours un livre sous le bras, il tombe amoureux du Fussball très jeune, à un moment où le club local, le SpVgg Greuther Fürth, remporte deux de ses trois titres, en 1926 et 1929. Kissinger découvre alors la fascination exercée par le stade : « Mon père était désespéré de voir son fils préférer rester deux heures debout au stade plutôt que de s’asseoir confortablement derrière un piano, dans un fauteuil d’opéra ou dans un musée. » Délaissant momentanément ses livres, Heinz s’aventure dans les bois : « Il a joué gardien de but, mais s’est cassé la main sur une sortie dans les pieds et a arrêté sa formidable carrière », explique le documentariste allemand Hermann Vaske(2). En 1933, les équipes de football de juifs allemands ne peuvent jouer qu’entre elles. « Les autres gamins nous frappaient », rappelle Kissinger, qui se souvient aussi qu’en 1936, Joseph Goebbels, amateur de football, se servait des magazines sportifs pour relayer sa vision toute personnelle de la composition de l’équipe nationale. Peu doué, Kissinger adopte alors un rapport au jeu « très analytique, à un moment où le différentiel positif entre le nombre d’attaquants et le nombre de défenseurs dans une équipe a tendance à s’inverser ». En 1938, il doit quitter Fürth – il est resté membre honoraire du club au trèfle jusqu’à sa mort – et l’Allemagne. La famille émigre aux États-Unis par le transatlantique. Elle perdra treize des siens dans l’Holocauste.
Le soccer est de l’ordre du drame implacable, sans temps morts, pauses pubs, ni pauses toilettes.
À l’arrivée à New York, Heinz devient Henry. Lors de l’été 1939, il travaille dans un atelier de fabrication de blaireaux de rasage, et, motivé par ses collègues d’origine italienne, redécouvre les joies du stade… de baseball : « Le Yankee Stadium fut un moment important de ma découverte de l’Amérique. » Le stade, un des seuls lieux où Kissinger soit en confiance. Il se rendra régulièrement par la suite au Giants Stadium, que ce soit aux côtés de Mick Jagger pour les matchs du Cosmos de New York ou lors d’exhibitions, comme le 8 août 2002, pour AS Roma-Real Madrid. « Le soccer est de l’ordre du drame implacable, sans temps morts, pauses pubs, ni pauses toilettes », résume-t-il. Kissinger passe ensuite du City College de New York aux corps diplomatiques via Harvard en quelques années, sans jamais manquer de se rendre au stade dès que possible, « arrangeant [son] emploi du temps en conséquence ». « La première fois que j’ai su que le football le passionnait autant, c’était en 1974. Nous étions à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN. À la fin de la réunion, il me propose de venir avec lui voir un match à Dortmund le jour même. C’est comme ça que je me suis retrouvé dans l’avion officiel américain puis au stade à ses côtés », témoigne un ancien vice-président de la Commission européenne, le Belge Étienne Davignon.
Henry Kissinger by Jean Pigozzi
Cosmos Soccer Game, Soccer Bowl, New York City, 1978 pic.twitter.com/QvlPVyFACA
— Chris Fralic (@chrisfralic) November 30, 2023
Stratégie militaire et football total
Au fil du temps, Kissinger deviendra davantage un analyste de Coupe du monde – il a assisté à toutes les finales depuis celle de 1970, hormis celle de 1986 – qu’un spectateur dilettante, ce qu’il reste au baseball. Sa science de la stratégie militaire déteint souvent sur son analyse du jeu. « Comme en stratégie militaire, toute manœuvre offensive au soccer génère un mouvement compensatoire défensif. (…) Le rôle croissant du buteur a contribué à développer la défense de zone, laquelle a généré le football total », écrit-il en 1986. Il distingue également « trois manières de jouer : à l’anglaise – gagner en se basant sur la performance physique et des balles hautes –, à l’européenne, tendance continentale – six joueurs offensifs et quatre défenseurs, avec des espaces dans les couloirs – ou à la latine, comme le Brésil ». Admirateur d’un « catenaccio machiavélique » comme il aime à le rappeler, il assiste à la Coupe du monde espagnole en 1982 et se réjouit de la victoire des Italiens. « Kissinger m’a parlé du match du deuxième tour entre le Brésil et l’Italie, raconte Vaske. Pour lui, après que les Brésiliens sont revenus à 2-2, un score qui les qualifiait, ils font une erreur stratégique et continuent d’attaquer. S’ils avaient alors joué en défense, ils auraient largement géré la situation et auraient même pu marquer en contre. Là, ils ont continué à attaquer, et la défense regroupée italienne les a eus à l’usure. » S’il voyait en Beckenbauer un joueur révolutionnaire dès le début des seventies – « En jouant libéro, il a donné au poste une nouvelle dimension, en le transformant en un rôle dual : organiser la défense et agir en attaque comme un quarterback de football » –, Kissinger admire avant tout « les milieux de terrain [qui] dirigent le jeu, exécutent leurs passes de façon plus précise que celle des autres joueurs et repèrent un espace vide que d’autres ne voient ou ne soupçonnent pas ».
S’appliquant, jusqu’à l’épisode des photos de Cuba, à séparer les affaires rationnelles d’État de son amour sensible du soccer, il est par la suite amené à se servir du sport comme levier diplomatique. Le 10 avril 1971, neuf joueurs de ping-pong, quatre hauts responsables et dix journalistes américains lancent « la diplomatie du ping-pong », sur invitation de l’équipe chinoise. Kissinger s’était rendu au préalable deux fois en Chine, dans le plus grand secret, pour préparer cette rencontre symbolique qui permit de normaliser les relations entre les deux pays. L’épisode chinois conduit Clive Toye, le président du New York Cosmos, et ses compères du comité exécutif de la NASL, à convaincre Kissinger de les rejoindre comme président honorifique, afin de faire la publicité de la ligue grâce à son aura. « Son boulot était de faire quelques discours, raconte Toye, dans lesquels il disait toujours : “J’ai participé à de nombreux matchs avec beaucoup de buts à Fürth, dans ma jeunesse.” Pause. “Je jouais gardien de but.” La salle éclatait alors toujours de rire. » Kissinger, comme Toye, voit plus loin, en grand admirateur de Pelé, dont il connaît le surnom – « Dico » –, et signe même, en 2006, une ode à son idole : « Les héros marchent seuls, mais ils deviennent des mythes lorsqu’ils anoblissent les vies et touchent les cœurs de tous. Pour ceux qui aiment le soccer (…), Pelé est un héros. »
Les héros marchent seuls, mais ils deviennent des mythes lorsqu’ils anoblissent les vies et touchent les cœurs de tous. Pour ceux qui aiment le soccer, Pelé est un héros.
En 1975, au Brésil, Pelé est bloqué au pays par le régime militaire. Toye abat alors sa carte maîtresse. « J’ai réussi à faire écrire à Kissinger une lettre au président du Brésil (Ernesto Geisel, NDLR) dans les ultimes étapes de la signature du joueur. Pelé était d’accord pour signer avec moi, mais s’inquiétait encore des réactions chez lui, au Brésil. Kissinger a alors envoyé sa lettre, qu’il a rendue publique, disant ce que cela signifiait pour le peuple américain… » Kissinger accompagne même les dirigeants du club au Brésil pour la négociation finale. Gordon Bradley, alors entraîneur-joueur du Cosmos, se souvient de la méthode Kissinger : « Il est arrivé devant une assemblée de dirigeants du football brésilien et leur a dit : “Écoutez, l’Amérique a tant fait pour le Brésil, nous aimerions que vous nous prêtiez Pelé.” Au début, les types sont devenus dingues, nous ont dit au revoir et nous ont invités à prendre le premier avion. » Ce sera chose faite, mais avec le joueur dans les bagages. Ce que les États-Unis ont alors lâché sous le manteau restera classé secret-défense. Kissinger interviendra une autre fois pour le Cosmos, quand Toye lui demandera de faire toute la lumière en Haïti sur l’assassinat – a priori par les escadrons de la mort, mais non élucidé – de Joe Gaetjens, le buteur américain lors de la victoire à Belo Horizonte. Aucun certificat de décès ne sera produit.

Le faiseur de rois
En 1978, Henry Kissinger se rend pour la première fois et en famille en Argentine, au Monumental de River Plate. Après avoir déclaré cinq ans plus tôt qu’« il ne voit pas pourquoi [les États-Unis devraient] rester stoïques et regarder un pays devenir communiste à cause de l’irresponsabilité de son propre peuple »(3), il est, à Buenos Aires, l’invité de marque personnel du leader militaire Jorge Rafael Videla, et assiste au sacre de l’équipe nationale. Comme la junte au pouvoir, Kissinger, qui avait donné sa bénédiction à la poursuite de la « sale guerre » deux ans plus tôt, se lave les mains : « La Coupe du monde a permis un moment de répit dans des quasi-conditions de guerre civile, avec une répression officielle brutale. » Et d’ajouter, cyniquement : « Ce pays a un grand avenir, à tous les niveaux. » Kissinger, qui avait connaissance de l’opération Condor(4), repart avec un contrat de 500 000 dollars pour l’entreprise américaine Burson-Marsteller. « C’est quelqu’un qui s’est souvent référé au précédent, du point de vue diplomatique », explique l’ancien ministre des Affaires étrangères français Jean François-Poncet. Ceci explique qu’il reviendra en Amérique du Sud, au Chili notamment, où, après avoir contribué à destituer le général Schneider – et faciliter le renversement, sanglant, de Salvador Allende –, il débarque dans le stade national à la mi-temps d’un match pour serrer la main des joueurs chiliens dans les vestiaires. Là même où avaient été emprisonnés des dissidents au régime.
Dans les années 1980, il multiplie les voyages en Europe et assiste à de nombreux matchs. Il échappera d’ailleurs de peu au drame footballistique de la décennie. Le Belge Étienne Davignon se souvient : « Je l’avais invité à venir voir la finale Liverpool-Juventus au Heysel. Il était alors conseiller de Giovanni Agnelli et de la Fiat. Ayant une confiance relative dans les capacités organisatrices de mon pays, je me suis rendu au stade un peu plus tôt. J’ai rapidement vu que ça pouvait mal se passer et je l’ai appelé pour lui dire de ne pas venir. » Deux ans auparavant, une première candidature américaine – avec Kissinger, Pelé et Beckenbauer comme VRP – avait été officiellement proposée pour la Coupe du monde 1986. En vain.
Ambassadeur du soccer dans son propre pays
Last but not least, « ses statuts et ses contacts ont été très utiles pour obtenir la Coupe du monde 1994 », se rappelle Toye, qui contribue à la nomination de Kissinger comme président du comité d’organisation. « Nous sommes en mission, déclare alors Kissinger. Nous devons rendre ce sport aussi populaire aux États-Unis qu’il mérite de l’être. » Quitte à verser dans le conflit d’intérêts. Administrateur de CBS, c’est sa chaîne qui finira « contrainte » de diffuser les matchs, à un moment où NBC préfère se retirer, TNT a de mauvaises audiences et ABC ne s’engage que pour « quelques matchs ». « Une fois que les Américains auront vu le jeu tel qu’il se pratique, ils seront excités », affirme Kissinger. Raté. Le vicomte Davignon : « Il aurait aimé que l’équipe américaine soit meilleure, mais il a toujours regardé les matchs non pas comme un supporter, mais en fin connaisseur, en appréciant d’abord la qualité de ce qu’il voyait. Son statut faisait que les gens étaient polis avec lui lorsque ses vues n’étaient pas les meilleures. » Le sénateur Jack Kemp se souvient de l’argumentaire utilisé alors par Kissinger pour vanter le jeu dans les coursives : « Quand il s’agit de soccer, savourer ces flux de frustration, d’exaltation et d’épuisement final m’amène à un niveau relativement élevé d’attention. »
Il n’y a pas assez de minorités dans le soccer américain : les joueurs ont tendance à appartenir à la classe moyenne des banlieues.
En mars 2000, il invite Pelé à participer à Washington à un séminaire sur le sport et le développement organisé par la Banque interaméricaine d’investissement. La conclusion du séminaire par les deux compères – « L’Amérique latine peut faire plus afin de faire du soccer un business profitable » – explique à elle seule les orientations prises par la diplomatie américaine sur le continent depuis un demi-siècle. Que ce soit dans le cadre de sa politique étrangère ou de son amour pour le soccer, Kissinger aura finalement été surtout réactif et rarement proactif, sa fascination pour l’opacité expliquant sans doute, en partie, que les Américains ne l’aient pas suivi balle au pied. Le journaliste Charlie Rose, entre deux questions de diplomatie internationale, lui demanda récemment, et insidieusement, pourquoi le soccer américain n’était pas bon. « Il n’y a pas assez de minorités : les joueurs ont tendance à appartenir à la classe moyenne des banlieues », répondit celui qui fut également membre du Conseil d’administration de l’US Soccer Hall of Fame, par ailleurs décoré de l’Ordre du mérite de la FIFA, aux côtés de Pelé, Sir Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Sir Stanley Matthews et… Nelson Mandela. Présent à Berlin en 2006 grâce à « des entreprises qui [l’] ont invité aux demi-finales et finale », dixit l’intéressé, Kissinger réalisera, dans un rare élan de générosité, un dernier diagnostic : « Sur le terrain, les Français n’ont pas cet instinct de tueur. » Des mots qui résonnent du Chili au Bangladesh, du Vietnam à Chypre, du Cambodge à l’Argentine, où lui a su faire régner un silence de mort. Le docteur a parlé. Trop, peut-être.
Par Brieux Férot
Portrait issu du numéro 60 de So Foot, paru en novembre 2008.
Propos d’Hermann Vaske, d’Etienne Davignon, de Jack Kemp et de Jean François-Poncet recueillis par BF, propos de Clive Toye recueillis par JMP.
(1) extrait des Carnets secrets de Bob Haldeman
(2) The Art of Football (2006)
(3) Canadian and World Politics, Ruypers, Austin, Carter et Murphy. Toronto: Edmond Montgomery Publications, 2005.
(4) Campagne d'assassinats et de lutte anti-guerilla conduite conjointement par les services secrets du Chili, de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay au milieu des années 1970.
(5) Kissinger: a biography, par Walter Isaacson, 1992