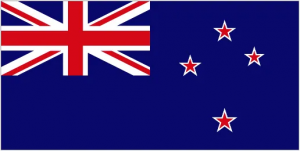- Billet d'humeur
Hatem Ben Arfa et la conception du beau jeu

Hatem Ben Arfa n’est pas le premier à réclamer l’émancipation de la tutelle des idéologues de régiment. En France, il y eut avant lui Jean Snella, Raymond Kopa ou Serge Chiesa. Étrangement, tous partageaient une même admiration pour une certaine conception culturelle et créative du football.
Lorsqu’au retour d’un voyage victorieux, mais mouvementé en Andalousie, et après une nuit supplémentaire passée à Séville dans un hôtel improvisé, Hatem Ben Arfa décida de ne pas se rendre à la mise au vert commandée par Julien Stéphan le soir même pour préparer un match à domicile contre Marseille, les gifles, une nouvelle fois, se mirent à tomber en rafales. « Partout où il est passé, sauf à Nice, il y a eu des problèmes » , braillait le plus retraité de tous nos maréchaux. Il fallait évidemment le « mettre à pied » , en finir avec ces joueurs qui étaient la honte de notre armée, effacer de nos mémoires ces indignes soldats qui n’en finissaient plus de décevoir nos généreux généraux. Éradiquer Hatem, c’était éradiquer l’indiscipline. Supprimer Ben Arfa, c’était supprimer la désobéissance. Et, équation plus inquiétante encore, mais sur laquelle repose cette logique auto-proclamée « pragmatique » : moins il y aurait de liberté accordée aux joueurs la veille des matchs, plus il y aurait de performance le lendemain sur la pelouse. Étrange idée.
Sanctionner Hatem ?
L’affaire de l’absence de Ben Arfa à la mise au vert la veille de Rennes-Marseille samedi dernier fut donc interprétée comme un insupportable manquement à la discipline de caserne. Il n’y avait effectivement, à première vue, aucune raison de ne pas se plier à l’ordre collectif. Il n’y avait, évidemment, aucun motif valable pour se soustraire individuellement à une obligation mutuelle. La santé de l’équipe était en jeu, la légitimité des chefs ne pouvait souffrir une telle insolence. Sanctionner Hatem : telle était l’unique obsession disciplinaire à l’œuvre dans les consciences, au point que les discussions ne portèrent déjà plus sur la légitimité des motifs de la désobéissance – fallait-il oui ou non enfermer des hommes pour les rendre plus créatifs ? –, mais plutôt sur la nature de la sanction à adopter contre lui. Mise à pied ? Amende ? Excuses devant ses pairs ?
Surveiller et punir
Pour comprendre cette fascination française pour la discipline de régiment, il faut revenir à l’histoire étrange de cette procédure adorée des entraîneurs les moins sûrs de leur autorité consistant, les veilles de matchs, à enfermer les joueurs dans un hôtel de banlieue dont il contrôlerait la moindre issue de secours. Les joueurs ainsi « concentrés » , les chefs pourraient s’assurer que les prisonniers se coucheraient tôt et espérer même en secret qu’ils méditassent, dans le silence de leur sainte réclusion, les paroles sacrées de la dernière causerie prononcée. À défaut d’en faire des moines vertueux, ils en feraient au moins des soldats disciplinés.
Cette tradition de la coercition tranquille remonte à Georges Boulogne, inventeur de la DTN et adepte de la morale de régiments. Fier de sa trouvaille empruntée à la littérature hygiéniste, Boulogne paradait en rang dans les gazettes d’antan, présentant la modernité de ces mesures et la manière si martiale de se préparer au haut niveau à une époque – les années soixante – où l’armée française n’en finissait plus de mener d’interminables guerres coloniales. La mesure imposée en équipe de France (qui motivera quelques années plus tard l’achat par la Fédération du château de Clairefontaine en 1983 pour mieux y « concentrer » ses joueurs appliqués) s’imposera ensuite à la quasi-totalité des clubs français.
Emmanuel Kant et Hatem Ben Arfa
Il faut dire que la mesure était populaire, exactement comme toutes les confortables tutelles qu’on épouse volontiers pourvu qu’elles nous promettent de nous libérer de nos angoisses et ne plus jamais avoir à nous préoccuper. Se concentrer, telle était la nouvelle manière, plus agréable et moins risquée, de ne plus avoir à penser. Car « il est si commode d’être sous tutelle, écrit le sage Kant. Si j’ai un livre qui a de l’entendement à ma place, un directeur de conscience qui a de la conscience à ma place, un médecin qui juge à ma place de mon régime alimentaire, etc., je n’ai alors pas moi-même à fournir d’efforts. Il ne m’est pas nécessaire de penser dès lors que je peux payer ; d’autres assumeront bien à ma place cette fastidieuse besogne. » Hatem Ben Arfa n’est pas le premier à réclamer l’émancipation de la tutelle des idéologues de régiment. En France, il y eut avant lui Jean Snella, Raymond Kopa ou Serge Chiesa. Étrangement, tous partageaient une même admiration pour une certaine conception culturelle et créative du football.
Car qu’est-ce que le beau jeu sinon cette manière de prendre son courage à deux mains pour dénoncer les préjugés les plus confortables ? Ainsi à Barcelone, quelques semaines avant de révolutionner le football des années 2000, Pep Guardiola supprima dès son premier jour de mandat, et à la surprise générale, la vieille tradition orthodoxe des concentrations (comme on dit assez justement en espagnol), poussant même jusqu’à – autant que possible – voyager le jour même des matchs et éviter ainsi la routine abrutissante de l’enfermement dans des hôtels devenus prisons. Si l’on voulait apprendre à nos joueurs à être créatifs à l’heure de résoudre toutes les difficultés que propose le jeu de football pratiqué à haute intensité, il fallait que nos hommes sachent penser par eux-mêmes et apprennent à faire usage d’une faculté étouffée sous la pesanteur de la discipline martiale. Il fallait s’arracher à la tutelle de quelques serviles consignes et réapprendre à être libres, c’est-à-dire, en somme, à être des hommes et non plus de simples machines à courir, sauter, frapper.
Guardiola, bon sens et liberté
« Avant d’aller au boulot, les gens ne passent pas un jour entier enfermés dans un hôtel, dit-il le 12 décembre 2011 sur FIFA.com. Nous essayons tous de mener une vie la plus normale possible : si les joueurs ne se reposent pas, s’ils ne font pas attention à leur hygiène de vie, ils joueront mal et perdront leur emploi. Je juge mes joueurs à leur travail et pas à leur vie privée. Je ne suis pas un flic, à 22 heures je dors et n’ai aucune envie de contrôler mes joueurs. Voilà pourquoi je préfère qu’ils restent chez eux en compagnie de leur famille et pas enfermés dans un hôtel à tourner en rond. Nous essayons de faire preuve de bon sens. Quelle est la clé du succès ? C’est ça, c’est le bon sens. »
Ce bon sens, dont parle Guardiola, c’est donc cette manière d’envisager la liberté non pas comme le refus provisoire de quelques contraintes désagréables, mais comme une certaine manière d’écarter les préjugés confortables, mais infantilisants, pour ouvrir devant soi un horizon plus vaste. L’admiration pour le beau jeu raconte donc l’apprentissage particulier d’une liberté qui s’éprouve à mesure qu’elle s’exerce, qui grandit à mesure qu’elle se concrétise. En ne se présentant pas au son du clairon, le révolté ne désobéit pas. Bien au contraire. Il obéit à une nouvelle conception de la liberté. Aussi, le beau jeu, comme la bonne philosophie, n’est donc pas une affaire de préceptes, mais de courage et d’autonomie. Voilà pourquoi Hatem Ben Arfa incarne encore et toujours l’exigence culturelle d’un jeu mis à mal par les préceptes disciplinaires, mais qui, en dépit des sarcasmes et des condamnations successives, se refuse néanmoins à disparaître.
À lire : La Magie du footballDans cet essai de 172 pages, Thibaud Leplat répond et déconstruit les attaques dont le football est la cible. Pour se procurer le livre, c’est par ici.
Lens se réchauffe en battant RennesPar Thibaud Leplat