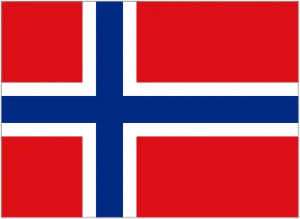- Mondial 2022
- 8es
- Maroc-Espagne
Halilhodžić : « Si je mets de l’eau dans mon vin, je ne suis plus Vahid »

Ce mardi, le Maroc affrontera l'Espagne en 8es de la Coupe du monde, sans que le nom de Vahid Halilhodžić ne soit jamais évoqué. Le technicien de 70 ans, qui a brillamment qualifié les Lions de l'Atlas pour la compétition, se confie en longueur.
« J’ai honte », lance Vahid Halilhodžić avant même de procéder aux politesses d’usage, en entrant dans cette brasserie de Saint-Germain-en-Laye. Ce sentiment habite l’ancien sélectionneur du Maroc depuis qu’il s’est fait remercier en août dernier, après avoir brillamment qualifié les Lions de l’Atlas pour la Coupe du monde. Une performance qu’il réalise pour la quatrième fois, après la Côte d’Ivoire, l’Algérie et le Japon. Un record mondial. Comme celui d’avoir qualifié quatre nations pour le Mondial, mais de n’avoir participé qu’à un seul d’entre eux. « Au lieu d’être au Qatar, je suis ici sous la pluie. Je m’étais vraiment investi dans ce projet à fond pendant trois ans et c’est encore une Coupe du monde que je vais louper. Mais bon, c’est la vie. » Devant un poisson et un verre de Pouilly, « Coach Vahid » vide son sac.
Fouzi Lekjaa, le président de la fédération royale marocaine de football (FRMF), vous reprochait de ne pas sélectionner Hakim Ziyech, de privilégier la presse internationale dans votre communication et de ne pas prendre assez de joueurs locaux. Qu’avez-vous à répondre à ça ?Quand tu arrives dans un pays, tu ne connais pas tous les bons joueurs. Donc il faut les chercher. Combien de cassettes j’ai regardées au Maroc ! Au moins un millier. J’ai renouvelé 80% de l’équipe. Il faut les trouver, les joueurs qui peuvent jouer pour l’équipe nationale. Ce qui fait la crédibilité d’un entraîneur, ce sont les résultats. Et jamais l’équipe du Maroc n’en a obtenu de meilleurs qu’avec moi en éliminatoires de Coupe du monde. 7 victoires, 1 match nul en ayant marqué 3 buts par match en moyenne. Ce que je n’ai pas apprécié, ce sont des campagnes de dénigrement, pour créer de l’animosité entre supporters des différents clubs, entre locaux et Marocains de l’étranger, qu’on empêcherait les locaux de jouer pour leur pays. Cette pression de la fédération durait depuis longtemps déjà. Ils voulaient que je prenne 3-4 joueurs, alors que l’équipe avait obtenu des résultats sans eux. Je n’ai pas cédé, parce que tu perds ta crédibilité quand les joueurs sentent qu’on décide pour toi. Certains refusaient de jouer pour le Maroc parce qu’ils avaient des entourages qui préféraient qu’ils jouent pour l’Espagne, l’Italie ou la France. Et après, ils changent d’avis quand il y a une Coupe du monde ! Mais il fallait être là quand on est allé à Kinshasa ou en Guinée pendant le putsch militaire. Au Maroc, j’ai écrit un document sportif, comme une charte, une synthèse qui décrit l’identité de l’équipe, défensivement, offensivement, sur coups francs, les marquages individuels, les marquages en zone, zone 1, zone 2, à 30 mètres, chaque joueur doit avoir un joueur à côté, dans les 16 mètres, marquage individuel au centre, toutes les bases, jeu dans l’axe, dos au but, remiser en une touche obligatoirement, les appels sur le côté, en profondeur, tout y est, tous les automatismes. Il a été traduit en cinq langues, parce qu’il y a des Marocains de partout. « Tu n’as pas compris ? Tiens, lis ça. » J’ai écrit ça pendant le confinement dû au Covid. On est le seul staff technique du monde qui a travaillé pendant le Covid. Là, c’est sûr, je sentais qu’avec l’équipe du Maroc que j’avais construite, on pouvait faire quelque chose à la Coupe du monde. J’aurais aimé terminer ma carrière sur une Coupe du monde réussie et dire ça suffit !

Vous avez laissé la recette du succès à votre successeur ?Oui, mais j’avais fait pareil au Japon. Vous n’avez jamais parlé de ça. Je ne veux pas me vanter, mais tactiquement j’ai du pif, je sais faire. Défensivement, à la limite, c’est facile, mais offensivement… Il y a mille possibilités. En 2014, toutes les équipes se sont fait bouffer par l’Allemagne, et nous, l’Algérie, on a bouffé l’Allemagne ! Moi, je n’ai pas un système défini, je m’adapte tout le temps, chaque match est une bataille. Aujourd’hui, chaque joueur a des vidéos de son adversaire direct. On analyse globalement, en attaque et en défense, les difficultés et les faiblesses de l’équipe adverse, on met en place plein de petites choses pour en profiter. Tout est programmé. C’est ça, être professionnel aujourd’hui. Tout est fait en amont.
Vous faites quand même des causeries dans le vestiaire ?Non, je prends un livre et je lis. Parce que tout est déjà sur le tableau. Juste, quand tu as la composition adverse, tu redis les consignes de chacun, en fonction des numéros. Des joueurs oubliés sur coups de pied arrêtés, c’est pas possible chez moi.
Au Maroc, comme tout au long de votre carrière d’entraîneur, vos rapports avec la presse ont souvent été tendus. Pourquoi ?Avec les journalistes marocains, qu’est-ce que j’ai vécu… Oh la la ! Un jour, je me suis levé et j’ai dit : « Je vous déteste. Je suis chez vous et je vous le dis en face. » Devant 200 personnes. Ils avaient écrit quelque chose sur ma famille. Des journalistes, j’en connais, mais je n’ai jamais rien attendu d’eux. Je n’aime pas l’idée de faire du copinage avec les journalistes pour maîtriser sa communication. Je suis arrivé au Maroc une semaine après avoir quitté Nantes, où je touchais un salaire trois fois plus important. Tous ces sacrifices familiaux et même financiers, pour finalement être privé de tournoi, c’est dur. Quand tu entraînes un pays, il faut y habiter, tu vas tous les jours au bureau. Et le week-end, tu voyages pour voir des matchs. Au Maroc, ils ont le meilleur centre technique du monde. Largement. C’est phénoménal. Les terrains, le médical, l’hôtel, la piscine, le restaurant… c’est cinq fois mieux que Clairefontaine.
Bien avant Knysna, la première grande histoire de taupe, c’est vous au PSG qui l’avez dénoncée en septembre 2004.Oui, la deuxième saison, c’est ce qui fait exploser l’équipe. J’ai su après qui étaient les deux joueurs télécommandés pour mettre la merde dans l’équipe, et par qui. Un par L’Équipe, l’autre par Merguez… Gilles Verdez, oui, du Parisien. J’ai peut être fait une faute en l’interdisant de Camp des Loges. Tous les journalistes ont été solidaires, ça a été le début de la fin. Je ne veux même pas parler des taupes, ces pourris. Il y en a un qui passe son temps à parler dans la radio.
Jérôme Rothen ?Tout le monde le sait ! Les taupes, tout ce qu’elles veulent, c’est des bonnes notes dans les journaux ! Moi quand je jouais, je préférais avoir une bonne note, mais 5 ou 6 je m’en foutais… On est tous différents, chacun sa sensibilité, sa mentalité, son égoïsme…
Vous ne vous dites pas que si vous aviez mis un peu d’eau dans votre vin, vous n’auriez pas vécu le traumatisme d’une troisième Coupe du monde à la télé, que vous seriez au Qatar en ce moment ?Si j’avais fait ça, je ne serais pas Vahid. Je préfère mourir avec mes idées. Mais je ne suis pas con non plus, je suis capable de changer d’avis quand on me le demande, si c’est pour le bien de l’équipe. Mais si je ne suis pas sûr que ce garçon va apporter un plus et qu’au contraire, ça peut faire exploser un équilibre de groupe… C’est pas parce qu’un joueur a un statut, fait des prouesses en club, que j’ai besoin de lui. J’ai des feedbacks que vous n’avez pas. Le problème, en club, c’est que le coach est devenu le maillon faible, le premier qu’on vire, mais si le chef du sportif est le maillon faible, un club ne peut pas performer. Le coach il décide, mais il passe son temps à consulter ses joueurs, ses adjoints, il décide, mais il ne joue pas, hein… Je ne suis pas un faux cul. Je n’ai jamais appartenu à un lobby. Regardez les entraîneurs portugais, ils sont partout parce qu’ils parlent bien, qu’il y a des cabinets d’agents qui font du lobbying.
Vous supporterez qui, pendant cette Coupe du monde ?La France. Elle peut aller au bout si elle est solide défensivement. Didier Deschamps, c’est l’école de la Juventus. Pragmatisme et réalisme. Gagner. Je n’ai même pas regardé la liste du Maroc (entretien réalisé avant le début de la compétition, NDLR). Une mère m’a téléphoné parce que son fils n’a pas été appelé, il pleurait. Vous ne pouvez pas imaginer comme c’est dur de faire ces choix. Un joueur qui a fait les qualifs et qui n’est pas appelé, vous pouvez détruire sa vie. Moi, je suis encore traumatisé d’avoir si peu joué en 1982. Il faut un sacré mental pour s’en remettre, tout le monde n’en est pas capable. Même de ne pas faire jouer un joueur irréprochable, c’est dur. Mais celui qui ne travaille pas bien, est indiscipliné, je le fais sortir avec plaisir.
Est-ce que finalement, on ne vient pas vous chercher pour les mêmes raisons qu’on vous vire ?Je ne pense pas. Par exemple, au Japon, ce sont les sponsors qui imposent des joueurs. Certains étaient blessés, d’autres ne jouaient pas, donc je pensais prendre des jeunes. Et cela n’est pas passé. Quand ils m’ont viré, ils m’ont reproché ma communication. Quoi, ma communication ? C’était un prétexte. Cela fait trois fois que ça se passe comme ça. Encore une fois, j’ai un petit peu honte. En Côte d’Ivoire, le président Gbagbo m’a ordonné de gagner pour qu’il soit réélu. Je lui ai répondu : « Demandez aux joueurs. » Le président de la fédé, Jacques Anouma, était son bras droit et meilleur ami, et je ne pouvais pas supporter d’ingérence, ce n’est pas le président qui choisit les joueurs. Avec la Côte d’Ivoire, j’ai fait une série de 23 matchs sans défaite, avant de m’incliner en prolongation face à l’Algérie en quarts de la CAN 2010.
Le destin vous a mené à être plus souvent sélectionneur qu’entraîneur. C’est un hasard ?Je n’ai jamais eu de plan de carrière, ce n’est pas organisé. À chaque fois que je quitte un poste, j’ai des propositions dans la foulée. En ce moment, mon téléphone n’arrête pas de sonner. Je n’ai pas un cabinet d’agents qui s’occupe de ma carrière. Ce sont surtout des amis qui me conseillent d’aller là ou là. Après la Coupe du monde au Brésil, lorsque j’ai quitté l’équipe d’Algérie, un club anglais et un très grand club italien ont voulu me rencontrer. Mais j’avais donné ma parole à un très bon ami qui travaillait à Trabzonspor, donc j’ai refusé leurs demandes de rendez-vous. Et dès que je suis arrivé à Trabzon, je me suis aperçu que je m’étais trompé. J’ai un fonctionnement très spontané, à l’affect. Je suis un peu con, mais je n’ai qu’une parole.
À Trabzonspor, vous en êtes vraiment venu aux mains avec Florent Malouda ?Ah, mais lui, j’ai jamais vu ça, je veux même pas en parler… J’organise une séance vidéo après le dîner, et lui me dit : « J’en ai rien à foutre d’étudier cette équipe, connard. » Ah là, j’étais… En plus, la veille, j’avais demandé au président qu’il paye un million d’euros en cash parce qu’il y avait des arriérés de salaires et si les joueurs ont des problèmes en dehors du terrain, ça nuit à leurs performances.
Que pensez-vous de ce football moderne, dans lequel les joueurs peuvent être plus importants que leur club ?Dans mes équipes, c’est impossible. Le patron incontestable, c’est moi.
Le PSG peut avoir ce type de problème avec le contrat qu’il a offert à Mbappé ?Tu ne gères pas Messi ou Mbappé comme les autres, mais… J’ai eu Pauleta, Drogba, Yaya Touré, c’est pas mal aussi. Et je n’ai jamais eu de problèmes parce que je leur ai parlé. J’adore discuter en tête à tête avec les joueurs. Je leur explique que je suis le patron, avec ou sans eux.
À Auxerre, Guy Roux tenait à ce que son salaire soit plus élevé que celui de son meilleur joueur pour garder de l’autorité. Un entraîneur pourrait exiger cela aujourd’hui ?Non. Avant, le football était organisé en associations. Aujourd’hui, c’est un business privé. Cela n’a plus rien à voir. Aujourd’hui, vous savez comment ça marche ? Il y a des agents qui recrutent des joueurs pour des clubs. À Nantes, ils m’ont même proposé une plus-value (sic) sur une recrue. Je n’ai jamais travaillé comme ça, moi ! On me demande de faire progresser un joueur, et qu’au moment où je le perde, je touche sur la plus-value réalisée. Je leur ai dit que ça ne m’intéressait pas. C’est une démarche uniquement économique, à l’image de notre société.
Aujourd’hui, est-il possible d’entraîner sereinement le FC Nantes ? Tous ceux qui se succèdent semblent être systématiquement « en clash » avec la direction ? C’est un petit peu spécial, oui. Quand je suis arrivé à Nantes, l’équipe était 19e. J’ai trouvé des joueurs dans un état lamentable. À la fin de la saison, ça allait mieux, mais il fallait vendre des joueurs et en trouver des nouveaux. Je leur ai proposé 55 joueurs, il n’en ont pas pris un seul. Des joueurs voulaient venir jouer pour moi, parce qu’ils me connaissaient. Mais quand je disais à « fils » (Franck Kita) que lui, c’était un salaire de 100 000, il proposait 25 000. Le joueur me disait qu’il ne comprenait pas. Ce n’est pas comme cela qu’on négocie ! S’il demande 100 000, tu proposes 70 000 et on se met d’accord autour de 85 000. Je ne pouvais pas accepter ce qu’il se passait à Nantes. Mogi Bayat me disait : « Ce joueur, il est bon », je répondais : « C’est moi qui décide s’il est bon ! » Ah, celui-là…
Quel type de joueurs désire jouer pour vous ?Les bons joueurs. Mais cela dépend avant tout de ce que tu as dans la poche. À Paris, j’avais 70 millions d’euros. Aujourd’hui, ils ont un milliard. Quinze fois plus. À mon époque, on me disait qu’on dépensait trop en bouteilles d’eau, parce que les joueurs buvaient une gorgée et jetaient la bouteille. Mais quel que soit le club ou la sélection que j’entraîne, je suis 100% dedans. C’est ma maison, ils me payent mon bifteck. Je suis fidèle à 100%, je ne triche pas !
C’est un regret de ne pas avoir pu associer Pauleta et Ronaldinho dans votre PSG ?En arrivant à Paris, lorsque j’ai demandé aux dirigeants si on gardait Ronaldinho, ils m’ont répondu que c’était moi qui décidais. Et une semaine après, je me suis retrouvé devant le board de Canal+ qui m’expliquait qu’ils étaient obligés de le vendre. Mon rêve était de l’associer à Pauleta, mais ils m’ont dit que si on faisait ça, le club serait relégué par la DNCG. C’est quoi, ça ? Je me suis fâché pendant dix jours, jusqu’à ce qu’ils me montrent le contrat de Ronaldinho. Il était prêté au PSG par une société qui s’appelait Sportfive pour une belle somme d’argent, et en plus du sien, le PSG payait cinq salaires. Sa sœur, son frère, etc. Dans l’effectif, il y avait même un joueur qui n’existait pas. Il s’appelait Rabiu Baïta, un joueur fictif qui servait à en payer d’autres ! Quand tu arrives et que tu découvres ça, tu te demandes si tu dois rester.
Vous vous sentez en décalage avec le football actuel ?Toute la société change, et le football aussi. Maintenant, les joueurs gagnent des sommes colossales et sont entourés de parasites qui utilisent des superlatifs pour qualifier tout ce qu’ils font, de filles qui leur font croire qu’ils sont tous Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo. Comment engueuler un mec qui gagne 15 millions par an ? Il faut imposer sa crédibilité, en tant qu’entraîneur et en tant qu’homme pour gérer cette relation.
Quelle part du travail d’entraîneur représente cette gestion humaine ?Avec certains joueurs, le social représente 90% du travail. Ils n’ont pas toujours reçu une éducation qui les a préparés à ce mode de vie, il faut leur apprendre le respect.
![]()
Vous disiez que vous n’avez pas d’agent. Vous négociez vous-même vos contrats ?Oui. Je n’ai même pas d’avocat, l’expérience suffit. Il y a le fixe et la variabilité qui dépend des résultats. Voilà. Mais alors les contrats de joueurs avec des clauses où si tu marques du droit tu touches 5 millions et de la tête 8 millions… À Paris, j’étais un peu manager. Quand le président négociait avec un joueur, je lui disais : « Francis(Graille), lui c’est à peu près ce salaire. Alors que lui, c’est à peu près ça. »
À Paris, vous avez loué la lucidité d’Hugo Léal, qui vous avait avoué qu’il ne méritait pas son salaire. C’est dingue…Mais quel salaire et quel contrat il avait ! Une fois, il est rentré avec trois jours de retard, donc retenue sur salaire. Mais dans son contrat, il y avait écrit que chaque année il devait minimum gagner tant, primes comprises, quoi qu’il fasse. Une somme nettement supérieure à ce qu’il aurait gagné si on avait gagné tous les matchs. Un contrat phénoménal ! Son agent était Jorge Mendes. Lui, il n’a jamais osé me parler. Comment ils font pour ne pas avoir honte vis-à-vis du club, pour ne pas se sentir redevables, être juste un peu respectueux ? Mais non, ils s’en foutaient ouvertement. Mais ça n’arrive pas qu’à Paris. Si je parle de ce que j’ai découvert dans certains contrats, c’est incroyable, c’est un crime, tu vas en prison tout de suite, même pas de procès, c’est un vol caractérisé, un hold-up ! Je ne comprends pas comment c’est possible. Un président sous pression, l’influence de l’entraîneur, d’un directeur sportif, d’un agent, la volonté sincère de croire en tel joueur ? Je ne sais pas. Moi, je mettais toujours l’intérêt du club en premier, comme si c’était ma maison, mes intérêts.
Lorsqu’on vous parle de Guardiola, vous répondez que vous aimeriez le voir entraîner Amiens ou Dijon. Est-ce qu’a contrario, le plus grand regret de votre carrière est de n’avoir jamais piloté de Formule 1 ?Quand j’ai quitté Lille, j’ai rencontré quatre heures Aulas à Paris, et il m’a appelé le soir pour me dire « Vahid, c’est pour toi le poste, viens signer demain matin », et il a changé d’avis dans la nuit. Ils venaient d’être champions pour la première fois, mais Bernard Lacombe a convaincu Aulas de ne pas me prendre, et ils ont pris Le Guen. Ensuite, je pensais y arriver quand j’ai quitté Rennes pour le PSG. C’était une décision difficile, parce que j’avais une relation particulière avec M. Pinault qui m’avait proposé tout pour continuer. À Paris, j’ai signé quatre ou cinq ans, et je pensais avoir les moyens de faire quelque chose, malheureusement je suis tombé dans une situation économique catastrophique. Pour en revenir à Guardiola, les entraîneurs de grands clubs aiment bien parler possession, jeu direct, blablabla, toutes ces choses que les gens aiment entendre. Mais est-ce qu’ils ont déjà joué la Ligue des champions avec Lille ? Manchester United, à Old Trafford, ils sont pas rentrés une fois dans nos 16 mètres. Deux ans plus tôt, Lille était en deuxième division. Et là, on jouait devant 70 000 personnes contre la meilleure équipe du monde. Je voulais faire entrer Delpierre à la 90e, mais le jeu ne s’arrêtait pas. Je suis même entré sur le terrain en faisant des grands signes pour que l’arbitre interrompe le jeu pour m’expulser. Je sentais qu’on allait prendre le but. Et on a pris le but de Beckham (0-1). Avant cela, on avait éliminé Parme, une des meilleures équipes du monde, 2-0 là-bas, la plus belle victoire de l’histoire de Lille. Alors Guardiola, à Barcelone, au Bayern ou City, il doit avoir la possession parce qu’il a les joueurs pour ça. La question, c’est qu’est-ce qu’il fait quand il perd le ballon ? Récupération rapide en 4 ou 6 secondes. Il est là, le travail. À Lille, dès qu’on récupérait le ballon, on se projetait en contre à une vitesse ! Quand je suis arrivé, ils faisaient 2600 spectateurs de moyenne. Quand je suis parti, 18 000. J’ai été le premier à alerter les politiciens sur la nécessité d’avoir un grand stade et un centre d’entraînement moderne. Je leur ai dit : « Regardez Lens à côté, c’est un village, et ils ont de meilleures installations que nous, vous n’avez pas honte ? »
Vous auriez dû rester à Rennes ?Ah ben ouais. Le président Pinault appréciait beaucoup mon travail, il a tout donné pour moi et ma famille, il voulait que je devienne actionnaire du club. J’avais miraculeusement sauvé le club de la descente. En arrivant, j’ai trouvé le club dans une situation catastrophique. Ils avaient recruté cinq ou six mercenaires qui se foutaient vraiment de la gueule du monde, Turdo, Lucas, Loeschbor… Il faut vraiment être salaud humainement pour se comporter comme ils l’ont fait, ils s’en foutaient ouvertement. Lucas, les agents avaient pris 10 millions sur les 20 qu’il a coûté ! J’ai raconté ça à Pinault, il m’a dit : « Ah bon ? Ils me prennent pour un pigeon ! » Les agents, ils pourraient t’agresser pour que tu fasses jouer un joueur ou que tu le vendes. Ça m’est arrivé partout, ces histoires de menace !
Au quotidien, qu’est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans le métier d’entraîneur ?Voir mes joueurs fêter une victoire. Quand ils crient, comme ça… Dans ces moments, il n’y a plus d’égos. C’est du partage. C’est plus glorieux de gagner en étant responsable d’un groupe plutôt qu’en tant que joueur. Au contraire, je déteste la défaite parce que tu es au tribunal. Pour tout le monde, y compris les joueurs, c’est de ta faute. Tu es l’accusé idéal. « C’est pas moi, c’est l’entraîneur. »
En 1993, quand vous débarquez à Beauvais pour entraîner, vous aviez ce destin en tête ?Non, pas du tout. Déjà, aller à Beauvais m’a sauvé la vie. Je suis parti un jeudi après-midi de Mostar, et le samedi matin, ils sont venus pour me tuer simplement parce que j’étais musulman et riche. Ils ont piqué ma voiture et tout ce qu’il y avait dans la maison et ensuite ils ont mis le feu et tout explosé à la dynamite. J’ai tout perdu, mon café, ma boulangerie, ma boutique de fringues. Il fallait recommencer de zéro. La religion développe la haine du voisin. Dans ma maison, on n’a jamais parlé de religions. Je suis bosniaque, ma femme est croate et ma belle-mère est serbe.
Votre célébrité ne vous protégeait pas…Avant de devenir une cible, j’ai participé à l’organisation de convois humanitaires pendant un an et demi. Et quand je suis parti, des soldats sont venus pour sauver ma belle-famille, grâce à un sergent que je connaissais. La guerre c’est terrible, vous ne pouvez même pas imaginer. J’ai vu des copains s’entretuer. Les gens deviennent des animaux prêts à tuer dès qu’ils mettent l’uniforme. Dans une guerre civile, c’est très difficile de rester neutre. Mais je ne veux plus parler de la guerre. À chaque fois que je vois l’Ukraine à la télé, je change de chaîne tellement cela me rappelle de mauvais souvenirs.
Le Mostar dans lequel vous avez grandi en Bosnie-Herzégovine, de par ses paysages et son mélange de communautés, c’était un petit paradis ?Ça l’a été, oui. Mais la guerre a tout détruit. Il s’est tout passé à Mostar : destructions, massacres, génocides, tout ! Et aujourd’hui, les fascistes au pouvoir apprennent aux jeunes à se détester entre eux ! Mais il y a du fascisme partout. Regarde en Italie, tous ces supporters de Mussolini ! Ils ont été élus démocratiquement, avec la télévision qui répète toute la journée aux gens que l’autre est son ennemi. En France aussi, la société se droitise. Quand il y a un monsieur qui dit à l’Assemblée nationale « Qu’ils retournent en Afrique ! », il faut un petit peu se poser des questions. Je suis fier de faire partie des gens pour qui l’important, c’est la cohésion, le partage. À Lille, je suis parti entre autres parce qu’il avait fallu que je me batte pour que tous les salariés aient une prime Ligue des champions, du jardinier à la blanchisseuse. Eux, ils voulaient partager la moitié pour les actionnaires, la moitié pour l’équipe.
En 1981, vous quittez Mostar à 29 ans pour signer à Nantes. Comment vous êtes-vous retrouvé là ?À cette époque, j’étais l’un des attaquants les plus demandés d’Europe. Il y avait Stuttgart, Hambourg – le président était venu à Mostar en avion privé -, le Torino, Barcelone, Leeds qui avait envoyé pendant un mois deux papys de 90 ans qui me suivaient toute la journée pour savoir ce que je faisais. Après un match avec la Yougoslavie contre la Hongrie, mes dirigeants ont discuté avec une dizaine de recruteurs et à trois heures du matin, ils me disent qu’il y a aussi un club français, Nantes. « C’est quoi, ça ? » Nenad Bjeković, qui jouait à Nice, me dit que c’est un des meilleurs clubs de France, que c’est un super pays. J’ai rencontré Budzynski. Il proposait la plus petite offre, mais je sentais la passion et des objectifs réels, donc j’y suis allé. Ce qui m’a stupéfait quand je suis arrivé à Nantes, c’est qu’il n’y avait qu’un entraîneur. À Velez Mostar, l’entraîneur avait déjà un adjoint, un entraîneur des gardiens et un préparateur physique. À Nantes, il n’y avait que Jean Vincent.
![]()
Mais c’était une équipe de grand talent, avec José Touré, William Ayache…(Il coupe.) Amisse, Bossis, Adonkor, Burruchaga ensuite… Nantes, à cette époque, c’était vraiment une rhapsodie, du Gershwin ! Je ne regrette pas, j’ai voyagé partout, et la France est bien le plus beau pays du monde. Ce qui m’inquiète, c’est la société française qui est complètement déboussolée, un petit peu aigrie. Bon, les Français, ils ne sont pas contents de naissance, c’est une mentalité compliquée ! Mais il y a une érosion éthique et morale de la société, partout. Aujourd’hui le mensonge est presque devenu un mode de communication. Et plus il est gros, plus il intéresse. C’est incroyable.
Plus jeune, vous étiez fan de rock ? À 15, 16 ans, je jouais dans un groupe, j’étais vraiment dedans. Je rêvais d’être un jour Jimmy Page, Brian May ou Clapton.
Et aujourd’hui ?J’adore Rihanna, c’est ma préférée ! J’aimais Whitney Houston aussi, la pauvre. J’aime la soul, le rock, la pop, la musique latine aussi, mais pas trop Shakira. Dans ma voiture, c’est RTL 2 tout le temps.
Vos joueurs ont entre 40 et 50 ans de moins que vous. Comment vous perçoivent-ils ?Ils ne savent pas que j’ai été footballeur. Quand tu deviens entraîneur, il faut oublier qui tu as été en tant que joueur. Mais de temps en temps, j’aime bien envoyer une pique à un joueur. Techniquement, j’étais très fort, et encore maintenant, je travaille avec mes attaquants pour leur montrer les bons gestes. Technique yougoslave. La meilleure du monde. Quand je suis arrivé à Nantes, Emiliano (Sala) était dans un état catastrophique. Attristé, déprimé… Je lui ai dit : « Mon garçon, écoute. Un avant-centre qui ne met pas 20 buts, ce n’est pas un avant-centre. Loin de là ! » Il m’a regardé et il a souri. Par la suite, il est souvent venu vers moi pour me demander s’il pouvait travailler plus. La meilleure mentalité que j’ai rencontrée chez un footballeur. Et puis il a mis 14 buts en 12 matchs. Il est devenu meilleur buteur d’Europe sur cette période. Et après, hop, il part. Et puis il est revenu à Nantes pour boire le champagne avec ses ex-coéquipiers. C’était vraiment un gars exceptionnel. Les trois mois qui ont suivi le drame ont été les plus durs que j’ai vécus en tant qu’entraîneur, terribles.

Jeune, vous rêviez de cette vie d’aventures ? Non, je voulais devenir ingénieur électrique parce que j’étais bon à l’école et qu’à Jablanica, où je suis né, il y avait trois barrages électriques. Puis à 18 ans, j’ai eu le choix entre signer mon premier contrat pro ou partir à l’université. J’ai choisi le football.
Il est vrai que durant votre service militaire, vous avez fait un arrêt cardiaque ?Oui. Ils m’ont anesthésié pour une opération à l’épaule, et je me suis étouffé. Allergie à l’anesthésie. Mais je ne l’ai su qu’un an plus tard, par une voisine qui était l’assistante du chirurgien. Quand elle m’a raconté, je me suis mis à transpirer, pfiouuu.
Vous vous êtes tiré une balle dans la fesse, aussi…La seule fois que j’ai tiré avec une arme, oui. J’avais le pistolet dans le dos, il me gênait un peu, et en le touchant, le coup est parti.
Comment expliquez-vous qu’en ayant joué jusqu’à 35 ans, en ayant été deux fois meilleur buteur du championnat de France et en ayant gagné la coupe de Yougoslavie, vous ne comptiez que 15 sélections en équipe de Yougoslavie ?C’est politique. J’ai été élu meilleur joueur de Yougoslavie, j’ai participé à tous les matchs de qualification pour la Coupe du monde 1982 et on a fini premiers de notre groupe devant l’Italie, futur vainqueur. J’arrive à la Coupe du monde, je suis remplaçant.
Pourquoi ?Je ne sais pas. En 1982, j’arrivais à la Coupe du monde pour être meilleur buteur. À côté de moi, il y avait Sušić et Petrović qui pouvaient me donner les ballons pour marquer. Miljan Miljanić, le sélectionneur de l’époque, m’a dit 30 ans après, quand je l’ai croisé et que je lui ai dit bonjour, parce que j’ai reçu une éducation : « Tu sais, en Espagne je me suis trompé. J’ai été injuste avec toi, il fallait que tu joues. »
Quand on voit la qualité des joueurs, on se dit que le football yougoslave aurait pu performer davantage…Il y avait le talent technique, le physique, mais aussi une fragilité mentale. Ce n’était pas des athlètes qui résistaient à la pression et à la provocation. Là où j’ai appris à être plus malin, c’est quand j’ai joué contre l’Italie. Gentile, Collovati, Cabrini, c’était vraiment des voyous. Ils passent à côté de toi en te touchant l’épaule et ils tombent en criant. Un cinéma incroyable.
Pourquoi êtes-vous resté dix ans au Velez Mostar ? Aller à l’Étoile rouge ou au Hajduk Split aurait pu vous permettre d’aller plus souvent en sélection, non ?Les politiciens ont promis de me donner tout ce que je voulais, ainsi qu’à ma famille si je restais à Mostar. Ils ont un peu mis la pression à mes frères, aussi. C’était comme ça. Aujourd’hui encore, quand je vais à Mostar, les gens chantent : « Vahiiiiid, Vahiiiiid ! » C’est le respect, ils ont de la mémoire. Partout où je suis passé, les gens m’ont apprécié. À part au Maroc, où dans certains stades, ils m’ont sifflé parce que je n’appelais pas Ziyech ou que j’avais entraîné le Raja. Mais c’était organisé.
En France, on vous caricaturait comme le mec qui aimait voir ses joueurs finir l’entraînement en vomissant et qui mettait en réserve ceux qui arrivaient en retard, plutôt que de parler de vos qualités d’entraîneur. Vous le viviez mal ?C’est la caricature des Guignols, des gens qui ne connaissent rien au foot. Mais sur le banc, niveau compétences, je n’ai peur de personne. En général, les joueurs n’aiment pas travailler sans ballon. Mais tu es obligé ! Dire le contraire, c’est du pipeau. Il y a un travail d’aérobie que tu es obligé de faire. Dans mes équipes, il y a très peu de blessures parce qu’on fait beaucoup d’assouplissements. Je vois beaucoup d’entraîneurs qui ont une communication magnifique, extraordinaire. Mais comment sont-ils dans le travail ? Préparer un entraînement, ça peut durer deux heures si tu fais attention à tous les petits détails tactiques ! Moi, je n’ai jamais confié une séance à un adjoint. Jamais. Je veux que mes joueurs s’entraînent comme ils jouent. C’est à l’entraînement que l’on gagne les matchs. Culture du travail et culture de la gagne. Alors on préférait parler de moi comme d’un tyran, à répéter les mêmes histoires. Comme à Rennes, quand je vire trois joueurs, dont Réveillère et Diatta, parce qu’ils avaient joué toute la nuit à la Playstation, alors que le lendemain, on avait un match capital pour se sauver, à Strasbourg. Je me suis passé de deux des meilleurs joueurs, mais on s’est maintenus. On a même fait notre meilleur match de la saison en gagnant 3-0. Mais le collectif, ça se construit au quotidien, et tu ne peux pas faire d’exceptions. Le groupe est toujours au-dessus de tout, c’est mon principe, la base de ma méthode, aucune individualité ne mérite un traitement de faveur. Alors, qu’on dise : « Vahid c’est un vieux con, c’est un dur », ok, si vous voulez. C’est aussi pour ça que je suis parti à l’étranger. J’en avais marre qu’en France, on ne me parle jamais de fond, de compétence, et qu’on m’appelle toujours pour me faire réagir sur ma rigueur. Et je ne comprends pas, pour certains entraîneurs, l’exigence c’est une qualité, pour moi c’était un défaut. Mais la plupart des joueurs avaient confiance en moi, parce que quand Vahid dit quelque chose, il tient parole, il est loyal. En sélection, j’ai connu des joueurs qui refusaient de s’échauffer pour entrer en cours de match. Alors bien sûr que pour eux, c’était fini. Je ne suis pas venu pour faire plaisir à untel ou untel, je suis venu pour faire progresser l’équipe et gagner.
Dans quel état d’esprit êtes-vous aujourd’hui ? Vous cherchez un nouveau poste ?J’ai un petit peu honte, encore une fois. J’ai eu des résultats partout, je travaille toujours de la même manière. Alors il faut avoir un peu de fierté, ce n’est pas rien d’amener quatre équipes en Coupe du monde. J’aurais aimé revivre ce que j’ai vécu avec l’Algérie. Partout où je passe, je suis reconnu comme l’entraîneur des Fennecs, on a laissé une super impression. Le lendemain de l’élimination contre l’Allemagne, je suis allé dans un centre commercial de Porto Alegre pour acheter quelques souvenirs, au bout de 10 minutes il y avait 2000 ou 3000 personnes qui me portaient en triomphe. Tu imagines ça ? Des Brésiliens ! Quand on est rentré, il y avait plusieurs millions de personnes dans les rues du pays. Une fête nationale. Alors je n’ai jamais reçu autant de propositions qu’en ce moment. Des sélections, des clubs, même en France. Je ne sais pas. Quand on m’appelle, je dis merci, c’est tout. Je suis un petit peu dégoûté parce que je suis vraiment un passionné de football. Il y a des gens qui travaillent avec moi qui ont du mal à supporter la charge de travail que j’impose. Je suis comme ça. Un fou de travail.
Propos recueillis par Mathias Edwards et Vincent Riou, à Saint-Germain-en-Laye