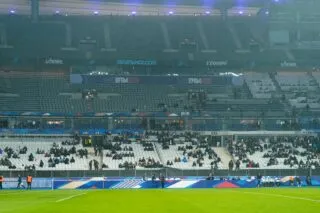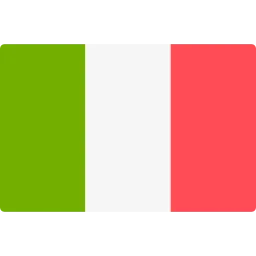Où en êtes-vous de votre documentaire sur le Barça ?
En fait, un producteur est d’abord venu me voir en me disant : « Est-ce que ça te plairait de faire un film sur le Real Madrid ? » J’ai répondu que oui, peut-être. Et lui de me dire de prendre un vol pour Madrid pour rencontrer José Mourinho. Sauf que ce type ne s’est jamais pointé : je me suis fait poser un lapin par Mourinho.
Magnifique…
Ça m’a tellement énervé qu’en rentrant, j’ai dit au producteur : « Tu sais quoi ? Pourquoi ne ferait-on pas un film sur le Barça ? » Avant même que je ne réfléchisse au film, ce que j’avais dit était déjà en ligne. Mais ça ne va pas se faire au final, car je ne savais pas vraiment quoi faire de mieux que la mise en scène dans les conditions de direct. Moi, j’ai besoin de beaucoup travailler pour être prêt, je ne débarque jamais comme ça, en dilettante : le truc le plus dur à faire pour un père de famille, c’est bien d’aller sur la piste de danse parce qu’on peut être ridicule, non ? Là, c’est la première fois que je n’ai rien à faire. Je vais peut-être faire un film pour enfants…
Vous allez passer de films politiques à des films pour enfants ? Car quand même, Bloody Sunday, United 93, Green Zone, Jason Bourne, Capitaine Phillips, ce sont des films politiques , non ?
Disons juste que je ne fais pas de films sur les pommes, je fais des films pour le grand public. Les gens payent pour mes films. Certains réalisateurs sont plus éclectiques que d’autres, je ne suis pas l’un d’eux. La politique, c’est la politique, et les films, ce sont des films. Et puis, je ne peux pas dire que je fais des films politiques, parce que j’enverrais directement le message au public que je fais des films ennuyants (sic). Ce qui m’intéresse, c’est le monde de dehors, le vrai, d’où mon travail : préserver la dimension documentaire avec cette urgence du réel qui illumine le drame. Trouver des histoires à partir du monde tel qu’il est, prendre des personnages et savoir ce qu’ils veulent et ce qui va se passer, c’est cela qui m’intéresse. Mon imaginaire a toujours été plus cinématographique que documentaire, car ma première expérience au cinéma a été de cet ordre-là. Je me souviens parfaitement de ce jour où mon père nous a emmenés voir Docteur Jivago au Palace Theater, au cœur de Londres, nous qui habitions en banlieue sud. La charge des cosaques, cette avancée, avec Jivago qui regarde… pfff, ces émotions sont encore là : l’excitation, l’indignation partagée, les éclairs de la lumière sur les sabres, ces contrastes entre la neige lumineuse et l’obscurité, un monde entier se créait là, devant moi. Une révolution (silence). Et puis, il y a eu À bout de souffle, le film le plus sexy que j’ai vu de ma vie, à la fois érotique, glamour, poétique et cool…
Pourquoi donc avoir réalisé alors pendant plusieurs années les reportages documentaires spectacles de la chaîne ITV, World in action ?
C’était un programme hebdomadaire, entre 1962 et la fin des années 80, un mélange de film et de journalisme radical, qu’on peut considérer aujourd’hui comme une matière sociale plutôt intéressante. J’en ai fait beaucoup, de l’Irlande du Nord à l’apartheid en Afrique du Sud, en passant par Beyrouth, toujours en racontant une histoire, mais avec de vraies gens. C’était le début des années 80, les années Thatcher… La Grande-Bretagne portait les germes d’une révolution sociale, l’actualité était au coin de la rue, donc le reste du monde nous était complètement extérieur : les priorités, c’étaient les grèves et l’Irlande du Nord, pas nécessairement le Moyen-Orient. Mais si je devais regarder aujourd’hui mes documentaires de l’époque, je serais embarrassé (silence). Ils sont ce qu’ils sont et en même temps, ils m’ont permis, en tant que personne, de vivre des situations et de rencontrer des réalités qui sont toujours en moi.
Vous aimez dire que vous ne venez pas de la BBC…
Oui, parce que ITV, c’était une télévision commerciale, c’est-à-dire qu’on ne prenait pas le public de haut, on savait très bien comment capter le téléspectateur de manière dramatique. Ça, ça n’a pas d’équivalent dans la télévision publique, qui préfère souvent créer des mythes autour de ses programmes, alors qu’il faut parler d’une manière à ce que tout le monde comprenne. Certains délivrent un message en se foutant de savoir si le message est adapté au public, or ce doit être une interaction entre égaux, entre humains, comme une vraie conversation dans la rue : il était de ma responsabilité de faire comprendre mon propos. Le crédo chez nous, c’était : « Dites-leur que vous allez leur dire, ensuite dites-leur et enfin, dites-leur que vous leur avez dit. » En faisant cela, on ne perdait personne.
Pourquoi ne pas rester fidèle au documentaire ?
Le documentaire conduit à la vérité, mais la dimension dramatique permet d’en faire quelque chose d’autre : être dans un avion le 11 septembre, seule la fiction peut le faire. De plus, un réalisateur doit avoir une voix, et la fiction est beaucoup plus simple pour les génies que pour nous autres qui avons besoin de travail, de temps, de maturité et d’apprentissage pour faire se rencontrer un enthousiasme des jeunes années et une expérience, qui ensemble donnent un cadre de décision. Que ce soit vrai ou pas, ce qui reste dans le cas d’une fiction, c’est le film. Avant mon film sur le meurtre de Stephen Lawrence, j’étais frustré, je ne trouvais pas ma voie : j’avais peur de regarder ce que j’avais fait, j’avais la rage, beaucoup de frustration, je n’étais même pas authentique, et le pire, c’est que je le savais. Je me décevais à l’époque, le film précédent étant vraiment mauvais, pas bon du tout. J’ai fait trop d’erreurs et je me suis promis de ne plus jamais refaire cela. Ma frustration s’est alors transformée en détermination implacable. Je n’ai pas voulu gagner le respect des gens en faisant ce que je ne voulais pas faire. Mon producteur, celui de Bloody Sunday, m’a poussé à le faire à ma sauce et ne m’a jamais lâché.
Sérieusement, pourquoi n’arrêtez-vous pas de faire bouger la caméra et de faire des plans jaunes, trops chauds, ou bleus, trop froids ?
Je procède plus par contrastes que par couleur, donc le bleu n’est pas si important pour moi. Dans Captain Phillips, je voulais juste accentuer la dichotomie entre le monde de l’affluence et celui de la pauvreté. Idem pour le personnage face à Tom Hanks qui ressemble à Omar dans la série The Wire. Pour ce qui est du rythme, je ne suis pas le premier, personne ne trouve à redire à Marathon Man. Sur le fond comme sur la forme, je n’utilise que des éléments classiques que je renouvelle, rien de plus.
Selon vous, que pourront bien raconter les jeunes réalisateurs qui n’auront pas formé leur œil par Docteur Jivago mais par You Tube ?
Plein d’autres choses. Le processus de production d’objets cinématiques s’est démocratisé grâce aux téléphones portables. Je suis tombé amoureux de la caméra de mon école à seize ans et j’ai eu de la chance qu’ils l’oublient. Aujourd’hui, tout le monde peut faire des films et les mettre sur les réseaux sociaux. Ce don d’ubiquité leur est permis grâce aux technologies, sans la moindre référence sociale. Où cela va-t-il nous mener ? C’est cela qui est intéressant. Moins de montage et des plans séquences bruts, ça rapproche de l’authenticité. Le jour où la bombe a explosé sur le marathon de Boston, plein d’images sont arrivées, qui ensuite ont été montées sur You Tube : la télévision ne le fait pas, mais sur Internet, ça se fait tout le temps. Je me souviens avoir tourné une course de voiture dans les rues de New York pour Bourne ultimatum, et bien la scène était montée en vidéos amateurs avant même que j’ai fini de tourner. Ce que je veux dire, c’est que le paysage cinématographique change radicalement : on passe d’une seule dimension, linéaire, à une approche à 360 degrés, la révolution est de cet ordre-là. Le problème sont les questions de distribution, réussir à trouver à la fois son budget et son public, qui sont désormais liés sur Internet, même si les gens, comme moi, ne vont que sur la même dizaine de sites tout le temps alors qu’il en existe des milliards. Les gens veulent encore des stars, mais veulent aussi créer les histoires eux-mêmes. C’est évident que cela va affecter le cinéma, et mon cinéma, de devoir répondre à une attente tout en répondant à des enjeux de mondialisation. Le temps de distribution est très court, aujourd’hui, même le DVD s’est écroulé.
Propos recueillis par Brieux Férot
Capitaine Phillips, en DVD le 24 mars 2014.
Chili : une question de Vidal ou de mort