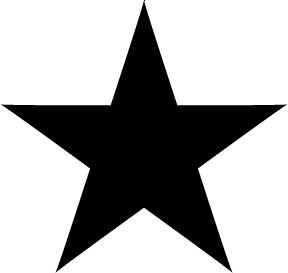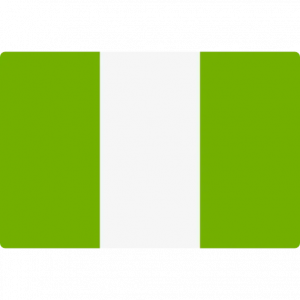- International
- Argentine
Gonzalo Higuaín : « Personne n’est plus proche de la beauté que le numéro 9 »

Le Real Madrid, la Juventus, Milan et Chelsea seront tous sur le pont en Ligue des champions ce mercredi. Le Napoli l'était mardi. Mais Gonzalo Higuaín, lui l'ancien attaquant de ces grands clubs européens, n'en sera pas. Après dix-huit années de professionnalisme et une dernière aventure américaine à l'Inter Miami, El Pipita a annoncé lundi les larmes aux yeux en avoir fini avec le football de haut niveau, à 34 ans. Cet attaquant anachronique, parfois en surpoids, peu spectaculaire, préférant se démarquer sur un pas que de mouliner des passements de jambe, s'était longuement confié au magazine So Foot en 2017.

Tu as grandi entre Belgrano et Palermo, à Buenos Aires, deux quartiers plutôt aisés, mais qui ont beaucoup changé au cours des dernières années. Tu reconnais ta ville quand tu rentres à la maison ?En réalité, j’ai grandi à Coghlan, un quartier dans le même coin. C’est là où j’ai passé la plus grande partie de ma vie. L’Argentine change constamment. Comme n’importe quel pays, sans doute. Quand tu es petit, tu veux voir ta famille, tes amis, et tu ne t’intéresses pas vraiment au reste. Mais quand tu grandis, tu commences à plus t’y intéresser, tu te rends davantage compte des changements.
Quels changements as-tu vus à Buenos Aires par exemple ?L’amélioration des tunnels. Il y avait toujours de gros embouteillages dans les rues. Je crois que c’est ce qui énervait le plus les gens, tous ces bouchons… Les tunnels qu’ils ont faits avec cette nouvelle présidence, pas seulement sous les voies ferroviaires, mais aussi sous les rues, ont beaucoup assoupli le trafic. Et ce n’est pas une connerie parce que pour moi, c’est le genre de truc qui me stresse, prendre tant de temps pour aller d’un endroit à un autre. Ensuite, j’aimerais beaucoup qu’on améliore la sécurité en Argentine, ça, oui, c’est de pire en pire. Ne pas se sentir en sécurité, ne pas prendre soin d’un pays qui est pour moi l’un des plus beaux du monde, c’est du gaspillage.
Palermo, c’est le quartier des artistes, celui de Borgès, de Cortazar, le quartier des musiciens. Tu t’en rendais compte ?Quand j’étais petit, la vérité, c’est qu’il y avait le ballon, et pas grand-chose d’autre. (Rires.) Je voulais être joueur de foot, ce qui comptait, c’était jouer constamment. Après, je sais qu’en Argentine, il y a des coins avec un bouillonnement artistique et culturel important. C’est le cas de La Boca, de Palermo Chico ou de Palermo Viejo, et de tant d’autres lieux, mais ça ne me passait pas beaucoup par la tête quand j’étais jeune.
![]()
Pourtant ta mère est peintre… (Nancy Zacarías est décédée en avril 2021 à 64 ans, NDLR.)
Elle peint depuis toujours, mais ce n’est que récemment qu’elle s’y consacre vraiment. Il y a des gens qui naissent avec un talent particulier, et elle est née avec celui-ci. Elle l’a exploité tardivement, parce que ça fait longtemps que je lui dis de s’y mettre, mais bon elle est en train de le faire, elle est très heureuse.
Ton père Jorge, un ancien footballeur, était plus un modèle pour toi ?Non, j’admirais les deux. En grandissant, j’essayais de tirer le meilleur de chacun d’entre eux. Mon papa c’était la personnalité, la mentalité de gagnant, se battre en permanence, s’entraîner au maximum. Il se donnait corps et âme pour le football. Maman, c’est la classe, elle a une âme d’artiste, elle innove sans cesse. Chaque fois qu’on jouait au football ou n’importe quoi d’autre, elle nous demandait de le faire avec notre âme, avec le cœur. Je suis un peu un cocktail de mes deux parents. Bon, j’ai 29 ans et il me reste encore beaucoup à apprendre, mais je crois qu’ils peuvent aussi apprendre de moi. Ce n’est pas parce qu’ils ont 60 ans que c’est fini. Moi, je suis persuadé qu’on peut apprendre de tout le monde, des jeunes comme des plus anciens. C’est quelque chose qui ne se fait pas trop, ou ne s’accepte pas trop, mais j’adorerais avoir 60 ans et qu’un jeune vienne et m’enseigne quelque chose. C’est comme ça que la société avance et progresse.
Qu’est-ce que tu as appris de la peinture ?J’admire les peintres, notamment ceux qui réalisent des fresques énormes sur les plafonds des églises pendant tant de temps. La patience qu’il faut avoir… Je ne suis pas un expert en peinture, mais je crois que ça ressemble au football dans la détermination qu’il faut pour réaliser une œuvre parfaite, la recherche de la précision. Un artiste ne peut pas peindre une fresque immense en deux heures, pas plus qu’il ne peut porter la faute sur quelqu’un. Comme en football, s’il échoue, il ne peut en vouloir qu’à lui-même. En fait, j’apprécie énormément quand quelqu’un fait quelque chose en cherchant la perfection.
Quand tu jouais avec les jeunes de River, comment se passait la cohabitation avec des gamins qui n’avaient pas un père footballeur ni une mère peintre, qui viennent souvent des quartiers pauvres, ou de l’intérieur du pays ?Moi, je m’en moque. J’apprécie une personne du moment qu’elle se comporte bien avec moi. Le reste n’a rien à voir. Je ne sais pas si eux me regardaient différemment. Je ne crois pas. Je n’ai jamais fait attention à ça. Moi, je sais ce que je suis, je sais comment je suis, je sais que tout ce que j’ai, je le dois à mon travail. Personne ne m’a rien offert.
![]()
Tu devais travailler plus que les autres parce que tu avais un père footballeur. Il te demandait beaucoup ?Non. Quand j’ai commencé à jouer au foot, je voulais m’imposer, et je me suis fendu l’âme pour le faire. Si tu ne le fais pas, tu dures deux ans, trois ans, mais la quatrième année, tu tombes. Parce que c’est comme ça : celui qui n’a ni talent ni constance mentale ne peut pas durer plus, et après, il s’en va et on ne le revoit plus. Moi, ça fait onze ans que je suis en Europe…
Tu dis toujours que tu es un grand travailleur. Au niveau mental, tu…(Il coupe.) Le mental, c’est fondamental. Après, tu dois l’accompagner du physique et du talent.
Tu peux travailler ça ?Ufff, le mental… Ce n’est pas une chose facile. Certaines personnes croient qu’il suffit de dire « c’est blanc » pour que ça se transforme en blanc.
Mais si tu peux faire des centaines d’abdos par jour comme Cristiano Ronaldo, il y a des exercices pratiques que tu peux faire pour progresser mentalement, non ?C’est une question de volonté. Si une personne vient et te dit : « Tu ne peux plus jouer au football », que le lendemain, une autre personne te dit la même chose et que le jour d’après, un autre type fait le même constat, ce n’est pas facile à encaisser. Sauf qu’au quatrième jour, une personne arrive et te dit : « Pour moi, tu peux jouer au foot, et tu peux être l’un des meilleurs. » En général, on retient ce qui est moche, ce qui fait mal. Mais c’est là qu’il faut se dire qu’une de ces quatre personnes croit que tu peux être pro. Quand c’est difficile et qu’on veut atteindre un objectif, il faut s’enfoncer une idée dans le crâne et la répéter : « Oui, je peux être joueur de foot. » Moi, j’ai lutté pour être joueur de football, pour ne pas donner raison aux trois autres personnes, ne pas leur donner le plaisir de pouvoir dire : « Tu as vu que tu ne pouvais pas, je te l’avais dit… » Cristiano Ronaldo a dit une grande vérité : dans le football, les ennemis nous rendent meilleurs. Pas parce qu’ils te montrent que tu te trompes, mais parce que les critiques visent toujours les plus forts. Et Cristiano m’a mentionné dans une célèbre interview, affirmant qu’il lutte aussi contre moi pour être le meilleur. Qu’une personne comme lui dise cela, qu’il me prenne en compte, admire ce que je fais, ça me rend très fier… Moi, je m’en vais avec ça.
![]()
En 2006, quand tu mets un doublé dans le Clásico contre Boca, on découvre en France que tu es né à Brest, ça déchaîne un enthousiasme terrible, on se dit que tu es le futur Trezeguet. Et en plus à l’époque, on te surnomme « le Français » …
Non, mes potes ne m’appelaient pas le Français. Ils savaient que j’étais né en France, mais c’est tout. J’ai dû l’expliquer quinze mille fois, mais on dirait que ça n’a pas été compris. Ce n’est pas que je ne me sentais pas français, c’est juste que j’ai vécu dix mois là-bas, donc…. pfff. Quand on naît dans un pays et qu’on y a vécu dix mois, je crois qu’il n’y a pas besoin de beaucoup plus d’explications. Quand la France est venue me chercher, j’avais vécu dix-huit ans de ma vie en Argentine, et dix mois en France… La décision était plus qu’écrite. C’était une question de logique. Je n’ai pas douté une seule seconde, et je ne regrette absolument pas parce que l’Argentine est mon pays, c’est mon sang, ma nation, et je vais l’aimer toute ma vie.
Domenech est venu te voir ?Oui, il est venu me voir à Madrid. Ça a été dur de lui dire non, parce que c’est toujours compliqué en face à face… J’ai aimé qu’il vienne me rencontrer, et je pense qu’il a apprécié que je sois sincère. Parce que c’est le plus important dans la vie, être sincère. Et la vérité ne fait pas mal. Alors je lui ai dit la vérité, je ne pouvais pas trahir mon cœur.
Tu es venu en France pendant la Coupe du monde 1998, car ton père faisait partie du staff de la sélection argentine. Quel effet ça fait de se retrouver au milieu de tous ces joueurs, de voir cette Coupe du monde, alors que tu as 10 ans ?Il y avait énormément de grands joueurs lors de cette Coupe du monde, des grands champions. Batistuta. Crespo. Je les prenais en exemple, parce qu’ils jouaient à mon poste. Simeone, Zanetti, Almeida, Ortega, « El Piojo » Lopez… C’était une équipe sympathique. En les voyant et en étant là-bas, j’avais encore plus envie d’être footballeur. Quand on est arrivés en France, mon père m’a tout de suite emmené à Brest. Parce qu’il voulait me montrer la ville où je suis né.
Qu’en as-tu pensé ?Brest n’est pas connue pour être la ville la plus belle du monde. Non, bien sûr que non, mais j’étais curieux de savoir où j’étais né. Ce n’est pas la ville la plus belle du monde, mais ce n’est pas la plus moche non plus. C’est une ville normale, populaire, où les gens sont très bons. À Brest, on vit sans doute mieux que dans des villes mieux réputées. Il y a plus de sécurité. Les gens ne sont pas envieux. Et puis, j’ai l’impression qu’ils ne vivent pas en se demandant comment faire du mal à l’autre. Parfois, on vit mieux dans les endroits moins beaux. Il y a plus d’humanité, plus d’honnêteté. Ce Mondial 1998 a été une belle expérience. Voir une Coupe du monde de l’intérieur à 11 ans, ça a été très beau. Je me souviens encore de Ronaldo, le Brésilien. Pour moi, c’est le joueur le plus fort du monde. J’avais un gros faible pour lui. L’avoir connu, c’est encore plus beau. Au Real, j’ai même joué avec lui pendant deux mois. C’était court, mais fantastique.
Ce n’est pas très commun qu’un Argentin ait pour idole un joueur brésilien…En vérité, je ne comprends pas qu’on ne puisse pas avoir Ronaldo comme idole. Si tu n’aimes pas Ronaldo, c’est que tu ne comprends pas le football, et que tu n’es pas capable d’en parler. Demande à cent personnes de te nommer leur héros. Pour moi, la logique voudrait que ces cent personnes disent Ronaldo. Ce n’est pas une question de pays, d’âge, ni une question de génération. Ce n’est pas possible de dire qu’il n’est pas le meilleur attaquant du monde.
Quand tu arrives en Europe, la presse parle de toi comme d’un ailier…C’est vrai, j’ai commencé ma carrière à droite, et ensuite j’ai fait toutes les équipes de jeunes comme numéro 10. Mais quand je suis arrivé en équipe première à River, tous les attaquants se sont blessés et Alejandro Sabella, à l’époque assistant de Daniel Passarella, lui a demandé de me mettre numéro 9. Et c’est comme ça que je suis devenu attaquant.
![]()
Mais tu ne te sentais pas numéro 9 avant ?Ça ne m’a pas non plus totalement changé parce que j’allais déjà toujours de l’avant. C’est un rôle qui a fini par me plaire parce que marquer des buts est la plus belle chose qui soit. Personne n’est plus proche de la beauté que le numéro 9.
À l’époque de YouTube, tu ne fais pas des choses très spectaculaires. Tu te contentes de faire des gestes qui paraissent simples…(Il coupe.) Et qui ne vendent pas.
Oui, qui ne vendent pas.C’est moche que la simplicité ne vende pas aujourd’hui.
Tu as l’impression de ne pas être reconnu à ta juste valeur ?Ce sont les autres qui jugent… Je dis toujours que le jour où je vais arrêter de jouer au football, ce qui arrivera quand je n’aurai plus de passion pour le foot… (Il coupe et réfléchit.) Au fond de moi restera tout ce que j’ai fait, tout ce que j’ai gagné, tout ce que j’ai réussi… Depuis que je suis arrivé en Europe à 18 ans et jusqu’à aujourd’hui, personne ne m’a rien offert. Personne. L’amour que je me suis gagné, dans toutes les équipes où je suis allé, dans chaque ville dans laquelle j’ai joué, l’amour des supporters, des coéquipiers, je l’ai gagné par ma manière d’être, par ma manière de travailler et de mener ma vie. Et personne n’a besoin de me le dire, je le sais au fond de moi.
Cette simplicité, cette manière de déséquilibrer une défense sur quelques appuis, sans faire l’otarie, ce n’est pas un peu anachronique ?Je ne joue pas au football pour plaire à tout le monde. Je le fais parce que c’est ma passion, et pour me démontrer à moi-même et à ma famille que je peux être ce qu’un jour j’ai rêvé de devenir. Je ne peux pas me plaindre. J’ai joué dans un des meilleurs clubs d’Espagne, j’ai joué dans deux des meilleurs clubs d’Italie. Moi, je crois que celui qui travaille, qui ne baisse pas les bras, finit un jour ou l’autre par y arriver. Ça peut prendre trois, cinq ans, mais tu finis par obtenir la reconnaissance.
![]()
Tu l’as aujourd’hui, cette reconnaissance ?Je ne sais pas. Peut-être qu’on me reconnaîtra quand j’arrêterai le football. Ça ne changera rien à ma vie quoi qu’il en soit. Tu sais ce qui pourrait la changer ? Que ma famille me dise :« Tu aurais pu faire plus », et cela ne va pas se passer. Je joue juste pour rendre les miens heureux. J’ai la chance d’être entouré d’amis et de personnes qui m’aiment pour de vrai. Parce qu’il y a des gens qui ne t’aiment pas pour de vrai. Ils t’aiment parce que tu as mis deux buts, et quand tu ne le fais pas, c’est fini. Tu crois que ce sont des gens qui t’aiment ?
Aujourd’hui, on a justement l’impression que certains jouent surtout pour être admirés. Toi, tu dis que tu t’en moques. C’est un peu vieille école, non ?Peut-être que c’est dû à mon éducation. Mon père est de la vieille école. Moi, je ne marque pas trois buts pour qu’on me dise : « Quel champion ! » Parce que si dimanche prochain, je vendange trois occasions, on me dira que je ne suis pas à mon niveau. D’un côté, c’est beau quand les gens changent si vite d’opinion à ton égard, parce que ça veut dire qu’ils attendent énormément de toi, ou que tu les as mal habitués – c’est-à-dire que tu les as habitués à marquer un but par match, comme l’a dit Cristiano Ronaldo il n’y a pas longtemps. Ça m’est arrivé en Italie : je n’ai pas marqué pendant deux matchs, alors j’étais en crise, j’étais fini. Puis je marque, alors je reviens. Non. Je ne suis pas parti, je ne suis pas revenu. Je suis le même. Le même que toujours. Je ne suis pas un robot, je ne peux pas marquer 100 buts par saison. Parfois, tu es bien, parfois tu es moins bien. Ce qu’il faut, c’est trouver l’équilibre.
Comment ?Quand on te fait trop d’éloges, il faut savoir rester calme. Quand on te critique trop, pareil. Il faut trouver l’équilibre juste, pour être toujours constant. Je sais quand je joue mal, ou bien. Après le match à Udine, où on a gagné, mais où je n’ai pas marqué, Buffon a dit quelque chose qui m’a donné la chair de poule. Il a dit que j’incarnais l’esprit de sacrifice de la Juve, et surtout qu’il demanderait à Allegri de montrer mon match 24 heures sur 24 pendant une semaine à toute l’équipe. La chair de poule ! Je savais intérieurement que j’avais fait un bon match, mais moi, mon travail, normalement, c’est de marquer. Là, on a marqué six fois, mais pas moi. Alors qu’on me félicite sans que j’aie marqué me rend doublement heureux. Surtout lorsque cela vient de Gianluigi Buffon. Les critiques, les éloges, je les écoute quand ils sont adressés par des gens qui connaissent vraiment le football.
![]()
Ce rapport ambivalent avec les supporters, que tu décris…Évidemment que ça rend fou de se faire acclamer par 80 000 personnes. Quand le San Paolo m’applaudissait, tout le Bernabéu, et tout l’Allianz, tu as la chair de poule. Quand un stade chante pour toi, après que tu as marqué, tu as la chair de poule. Bien sûr ! Mais tu dois être conscient que si tu joues mal pendant trois matchs, tu entendras des sifflets. C’est vrai qu’un sifflet s’entend au milieu de dix applaudissements. Enfin : ton cerveau retiendra seulement le sifflet. Il faut être préparé pour l’encaisser. Il faut rester debout, bien campé sur ses deux pieds. Parce que si tu n’es pas prêt à y faire face, tu tombes. Et tu peux tomber de haut.
Ce qu’éprouve le tifoso, ce n’est donc pas de l’amour ?
Si, bien sûr que si. J’imagine que c’est parfois par amour que les supporters te sifflent, parce que tu n’as pas marqué pendant deux matchs, alors qu’eux voulaient simplement t’applaudir encore une fois. Je le comprends. En Europe, j’ai reçu beaucoup de critiques et beaucoup d’éloges. Ma vie est comme ça.
La dernière fois qu’une critique t’a été utile, c’était quand ?La dernière fois, par exemple, j’avais mal commencé le match, et mes coéquipiers sont venus me voir, pour me dire qu’ils attendaient plus de moi, que je devais être un exemple positif pour le vestiaire. Ils te disent ça avec des vrais mots : « On veut gagner. Tu dois nous aider à le faire, tu dois nous filer un sacré coup de main. T’es important pour nous. On observe ce que tu fais à l’entraînement parce que t’es un exemple. » Un mec te dit ça. Deux. Trois. Ça veut dire qu’ils le pensent. Qu’ils ne rigolent pas du tout. Alors tu te poses des questions. Qu’est-ce que je veux ? Être ici pour prendre des vacances ou démontrer qu’ils ne se trompent pas ? Qu’ils ont raison de me dire tout ça, que je suis important, que je peux les aider à gagner ? Ce sont des critiques qui te font avancer. Ça me pousse à donner le meilleur, pour leur dire : « Non, vous ne vous trompez pas à mon sujet. »
![]()
Maurizio Sarri a dit de toi que tu étais un peu feignant, et tu as répondu que tu étais partiellement d’accord…« Paresseux », il m’a dit. Il voulait dire que je me satisfaisais trop vite des choses. Il me disait que quand je mettais un but, il fallait que je fasse comme Messi ou Cristiano Ronaldo, vouloir mettre le deuxième, puis le troisième, etc. Moi, je mettais un but et je me relâchais.
Il avait raison ?Je l’avais déjà à l’intérieur de moi cette insatiabilité, mais j’avais besoin que quelqu’un la fasse sortir. Après ce que Sarri m’a dit, j’ai mis 36 buts, donc il devait avoir un peu raison.
Une analyse intéressante de ton jeu : tu es un attaquant qui fait 10 000 calculs à la fois quand tu reçois le ballon…(Il coupe.) Attention, ce n’est pas bon de trop penser…
Pas penser, mais prendre des informations, comme un joueur d’échecs, pour choisir la meilleure option, ou la seule option. Dans ce cas-là, tu ne te trompes jamais. Mais quand tu as plus d’une option, par exemple un penalty, ou un face-à-face, c’est plus compliqué pour toi.Clairement. Exactement. C’est pour ça que je te dis que trop penser n’est pas toujours bon. N’importe quel joueur de foot doit savoir ce qu’il y a autour de lui avant de recevoir la balle, qui tu as dans le dos, où va le défenseur, ce qui va être le plus difficile pour lui, s’il est gaucher ou droitier, savoir comment il défend… Moi, avant un match, je regarde souvent les vidéos des défenseurs pour savoir comment ils jouent, si celui-ci tacle souvent, si l’autre est bon dans les airs, etc.
Mais à quel moment tu décides de ce que tu vas faire, ça se décide à l’instinct ?Avant de recevoir la balle, je sais déjà ce que je vais faire. Ce n’est pas une intuition. Après, le défenseur peut le deviner, le gardien te la sortir, il y a des adversaires, mais moi mon idée, avant que tu me donnes la balle, je l’ai. Ce sont ces deux secondes qui, dans le football, sont fondamentales.
Et quand tu as plus de temps, c’est plus dur ?Totalement.
Pourquoi?Parce que tu vas te mettre à plus penser, à tergiverser. Tu vas avoir trois ou quatre options. Dans le football, ce qui est bon est rapide. Tu ne peux pas prendre trop de temps pour penser.
Ce n’est pas quelque chose de positif de pouvoir penser ?Si, bien sûr que si. Mais dans le football, en tout cas, c’est ma façon de voir les choses, plus tu as de l’espace, plus c’est difficile. Tu penses une chose, tu changes d’idée tout de suite après pour une autre, ça va très vite et, finalement, tu ne fais pas forcément le mauvais choix, mais pas la première chose que tu voulais faire. Pas forcément ce que ton instinct te disait de faire. Quand je reçois le ballon et que je dois décider tout de suite, je préfère.
C’est ce qui s’est passé face à Manuel Neuer, tu as eu trop de temps ?Non. Non, non. La balle est arrivée sur moi et, bon… (Il réfléchit.) J’ai décidé que celle-ci… J’ai décidé de faire ça, et voilà. C’est une balle qui m’est arrivée sans que je puisse y penser avant, donc c’est ce qui s’est passé et… bon, c’est fini. La balle est apparue rapidement, j’ai essayé de décider rapidement et… L’important, c’est de toujours regarder devant soi. Bien sûr que ça fait mal. Mais c’est ce que je te dis : l’important c’est de croire en soi. Et la vérité, une des choses dont je suis le plus fier, c’est d’avoir réussi à rester au haut niveau après ça. Ces moments durs te rendent parfois plus forts. Pour savoir, tu dois vivre des expériences. Des bonnes, comme des mauvaises. Je préfère retenir que je suis un des quatre ou cinq meilleurs buteurs de la sélection argentine, que j’ai joué deux coupes du monde, trois Copa América, que j’ai joué dix ans dans la sélection…
![]()
Ça ne te semble pas une injustice que l’on cherche toujours un coupable pour une défaite ?Le meilleur exemple, c’est le match contre la Lazio : tu mets deux buts, tu rates ton penalty, certes, mais c’est toi le coupable… Et pour toi, quand on veut un coupable, on va chercher qui ?
La star ?Voilà, c’est dit. (Il claque dans les mains.) Plus clair que ça, impossible. Tu as répondu toi-même, j’ai rien eu à dire. On va toujours chercher ce qui vend le plus.
À Naples, ok, mais pas avec l’Argentine.Mais moi, je ne retiens pas ça, je retiens ce qui s’est passé ensuite avec mes coéquipiers, qui m’ont soutenu publiquement. Comme sans doute beaucoup de supporters de l’Argentine qui m’aiment. Le reste, c’est du passé, je retiens qu’on est arrivé en finale, trois fois de suite (toutes perdues, NDLR), ce qui est très, très difficile. J’ai été très heureux avec la sélection, je suis heureux de ce que j’ai fait pour elle.
Quand tu es arrivé à la Juventus, on disait de toi que tu n’étais pas en forme, que tu étais gros. Tu t’attendais à ces critiques sur ton corps ?Ça a été… (Rires.) Ça ne me fait rien qu’on dise que je suis faible, ou que j’ai des kilos en trop. Ça ne me change en rien. J’étais fier et très heureux de la décision que j’avais prise. (Higuaín signe à la Juventus en juillet 2016, un choix mal vécu par les supporters napolitains, NDLR.) Ce n’était pas une décision facile, pas du tout, mais c’est ce que je devais faire. Je suis resté sept ans à Madrid, trois ans à Naples, et en 2017, j’ai joué une finale de Ligue des champions. J’ai marqué 33 buts en 55 matchs. C’était donc la bonne décision. Si je devais jouer au football dans une autre vie, je referais cette carrière.
![]()
À la Juve, il y a cette fameuse culture de la gagne. « Gagner n’est pas important, mais c’est la seule chose qui compte », dit-on ici. Qu’est-ce que tu as appris à Turin ? Qu’est-ce qu’on apprend de plus ici quand on a passé sept ans au Real Madrid ?
River, Real, Juve, ce sont vraiment pratiquement les mêmes clubs. Des clubs habitués à gagner. Naples m’a donné autre chose.
C’est comme si tu étais né pour jouer avec un maillot blanc…(Rires.) C’est vrai, on dirait, non ? C’est beau, hein ? Le blanc, toute la vie… À Naples, le maillot extérieur était blanc en plus, à un moment. Tout en blanc. Et le maillot de la Juve, je l’ai toujours regardé avec curiosité, ou admiration. Je la regardais toujours à l’époque de Zidane, Trezeguet, Del Piero, Nedvěd, Tacchinardi… Des joueurs spectaculaires.
Tu dis que les gens t’aiment ou ne t’aiment pas. Mais l’attaquant, c’est quand même le seul joueur que ses coéquipiers viennent embrasser. Tu dois quand même apprécier ce genre de moments, non ?Oui, évidemment. C’est beau, c’est beau… Quand tu vois Chiellini et Barzagli qui arrivent en courant et te sautent dessus, ces deux bêtes… Et c’est beau aussi quand les gardiens viennent. À Madrid et à Naples, Iker Casillas et Pepe Reina traversaient parfois tout le terrain pour m’embrasser… Qu’est-ce qu’il y a de plus beau que ça ?

Propos recueillis par Pierre Boisson et Lucas Duvernet Coppola, à Turin
Photos : Renaud Bouchez et Iconsport