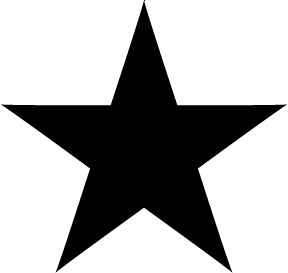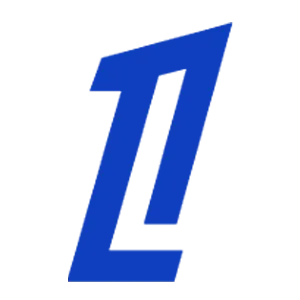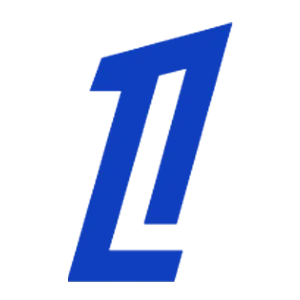- France
- Bordeaux
Fernando Cavenaghi : « Je ne suis jamais redevenu le joueur que j’étais »
Devenu dirigeant d’un club basé à Montevideo, l’ancien goleador argentin révèle que sa carrière a basculé en 2009, le jour où il s’est blessé à un genou sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Une équipe qu’il regrette d’avoir quittée.

À 39 ans, la vie de footballeur te manque-t-elle ?
Franchement, non. Ça fait un moment que je me suis habitué à cette nouvelle réalité. Je n’ai plus la condition physique pour ça ! (Rires.)
Tu cumules depuis début 2021 les fonctions de président et de directeur sportif du Racing Club de Montevideo, en Uruguay. Cette reconversion te comble-t-elle ?
Oui, j’aime ça. Ce n’est pas facile d’être de l’autre côté du comptoir. C’est une chose d’être joueur, c’en est une autre d’être dirigeant. Il y a beaucoup plus d’éléments à prendre en compte, de nombreuses responsabilités. Gérer un club professionnel est difficile, mais je grandis beaucoup, j’apprends tous les jours. Je m’occupe de la section football du club en général, des enfants de 12 ans aux professionnels en passant par l’équipe féminine.
Pourquoi ici à Montevideo ?
J’ai toujours voulu passer de l’autre côté, ça m’a toujours intrigué. L’Uruguay te donne plus facilement la possibilité de travailler dans une société anonyme sportive que l’Argentine. Et on vient encore de le voir avec la Coupe du monde U20, c’est un vrai pays de football, riche en talents. La quantité de jeunes joueurs est impressionnante. Les gens d’ici vivent et respirent ce sport. Ils l’aiment de manière inconditionnelle. En plus de ça, l’Uruguay t’offre une belle qualité de vie, de la tranquillité… Ça réunit tout ce que je recherchais. Le Racing est une institution historique, un club de barrio par lequel sont passés de grands joueurs. On le surnomme « la Escuelita », pour sa fibre formatrice. C’est ce qui m’a le plus séduit : son histoire, son identité populaire, ses supporters…
Il se passe tellement de choses chaque jour : une coupure d’eau, une canalisation qui lâche, un nouveau joueur à accueillir, une ligne qu’il faut tracer sur le terrain… Ça n’arrête jamais, tu ne peux pas t’ennuyer !
Découvrir de nouveaux joueurs, ça te plaît ?
C’est ce que j’aime le plus : aller voir des matchs, des joueurs, essayer de les convaincre de venir dans notre club, leur expliquer notre projet de formation, parler avec les gamins, les conseiller… J’essaye de transmettre mon expérience d’ancien attaquant professionnel. C’est le cœur du projet : former des jeunes, leur donner les outils pour réussir au plus haut niveau. La moitié de notre budget est consacrée à la formation. Et on ambitionne d’être le plus haut possible en championnat, de se qualifier pour des compétitions internationales.
Le club a été promu en D1 dès ta deuxième saison ici, en 2022…
Ça avait failli arriver dès la première, mais on a perdu la finale. On a acheté un centre d’entraînement, on a quatre terrains, un gymnase, des bureaux… J’investis mon propre argent, avec deux amis médecins, les frères Ignacio et Santiago Rossi, que j’ai connus à River Plate. C’est un beau sentiment de voir le club grandir.
Devenir entraîneur ne t’a jamais traversé l’esprit ?
Si. J’ai le diplôme pour exercer, mais aujourd’hui, ce qui m’anime et m’intéresse, c’est d’être à la tête d’un club. J’ai pris des cours en Argentine pour apprendre ce nouveau métier, mais je crois que le travail sur le terrain au quotidien est ce qui m’a le plus enseigné. Il se passe tellement de choses chaque jour : une coupure d’eau, une canalisation qui lâche, un nouveau joueur à accueillir, une ligne qu’il faut tracer sur le terrain… Ça n’arrête jamais, tu ne peux pas t’ennuyer !
C’est plus difficile que la vie de joueur ?
Beaucoup plus. Comme joueur, tu penses à ta condition physique, ta préparation, ton jeu, etc. Mais tu ne te rends pas compte du travail mis en place pour que tu aies tout à ta disposition, pour que tu ne manques de rien, que le déplacement en bus se passe bien, que la nourriture soit bonne, les vêtements lavés et prêts… La logistique est énorme. Le joueur, il arrive, monte dans le bus et va au stade. Il n’a pas de question à se poser.
Tu n’aurais pas aimé faire ce travail à River Plate ?
J’ai une très bonne relation avec Jorge Brito (le président du club), Enzo Francescoli (le directeur sportif) et Leonardo Ponzio (le secrétaire technique), mais l’opportunité ne s’est pas présentée, et j’ai ma vie ici maintenant. Mais je reste proche du club, on a même organisé quelques journées de détection ensemble. Il y a peu de temps, j’étais d’ailleurs au Monumental pour voir le match de Copa Libertadores contre Fluminense (2-0).
Le médecin me l’a dit directement : “Avec cette blessure, ta carrière sera courte.”
Parlons des Girondins de Bordeaux, où tu as joué trois saisons et demie, de janvier 2007 à l’été 2010. Suis-tu encore l’actualité de ton ancien club ?
Bien sûr. La course à la montée s’est jouée à un rien. C’est dommage que ça se soit fini comme ça après tant d’efforts… La place de Bordeaux est en Ligue 1, car c’est un grand club, pour lequel je souhaiterai toujours le meilleur. Et je suis sûr qu’il va remonter. Les supporters, qui m’ont toujours donné beaucoup d’affection, le méritent. La dernière fois que je suis revenu, c’était en mars 2018 pour donner le coup d’envoi fictif d’un match (contre Rennes) avec Pauleta. Et les gens m’ont magnifiquement accueilli. Ça m’a rappelé beaucoup de beaux souvenirs.
Au mercato d’hiver, tu arrives en Gironde depuis le Spartak Moscou pour remplacer Lilian Laslandes, parti à Nice lors de ce mercato. Comment se déroule ton intégration ?
Après la Russie, c’était un grand changement pour moi. Logiquement, il m’a fallu du temps. Bordeaux est un vrai beau club, avec des gens chaleureux. Malheureusement, Ricardo ne m’a pas fait jouer autant que je l’aurais voulu, après une période d’inactivité pour moi à Moscou et en raison de ce processus d’adaptation. Mais la saison suivante, avec l’arrivée de Laurent Blanc et Jean-Louis Gasset, j’ai atteint mon meilleur niveau.
Tu as été l’un des acteurs principaux d’une époque dorée de l’histoire du club…
C’était magnifique à tous les niveaux. Fantastique, vraiment. Collectivement, il y a évidemment tous ces titres (une Coupe de la Ligue avec Ricardo ; un titre de champion de France, une Coupe de la Ligue et deux Trophées des champions avec Laurent Blanc, NDLR). Et personnellement, j’étais heureux d’un point de vue familial, et super à l’aise dans le système de jeu. J’ai marqué beaucoup de buts (47 en 111 matchs). C’était un régal de jouer dans cette équipe. Mais ma blessure au genou droit à Toulouse (défaite 3-0, le 7 mars 2009, NDLR) lors de l’année du titre a changé toute la suite de ma carrière. D’ailleurs, le médecin me l’a dit directement : « Avec cette blessure, ta carrière sera courte. » Le ligament croisé postérieur était rompu, et il ne pouvait pas s’opérer. Malgré tous mes efforts, je n’ai jamais plus joué un match à 100 % par la suite. Ça a été très dur, puisque ça a engendré beaucoup de complications physiques. Finalement, ça m’a poussé à prendre ma retraite très tôt (fin 2016, à 33 ans). Mon corps n’en pouvait plus.
Comment profite-t-on de sa carrière en sachant qu’elle ne sera plus jamais comme avant ?
En redoublant d’efforts, en faisant beaucoup de travail en salle pour renforcer le genou. C’était beaucoup de sacrifices. Et malgré ça, je ne suis jamais redevenu le joueur que j’étais. C’est pour cette raison que je dis que le football ne me manque pas. Mes dernières saisons ont été pesantes.
Le plaisir avait disparu ?
(Il réfléchit.) Il apparaissait par moments. Il m’est quand même arrivé de belles choses par la suite, j’ai gagné d’autres titres. Mais il y a clairement eu un avant et un après. Je n’ai pas songé à abandonner, mais chaque année, ça devenait de plus en plus difficile. L’idée de devenir dirigeant est née durant cette période de ma vie, où j’ai commencé à chercher de nouveaux défis. Arrêter a été comme une libération.

Avant cette blessure, tu traversais le meilleur moment de ta carrière ?
Sûrement. J’étais très bien lors de mes premières années à River Plate aussi (de 2001 à 2004). Mais à Bordeaux, c’est vrai, j’ai fini meilleur buteur du club deux saisons de suite, j’ai connu la sélection à quatre reprises à une époque (en 2008) où il y avait quand même de sacrés joueurs avec Messi, Higuaín, Agüero… On parlait beaucoup de mon possible départ à Tottenham, qui avait fait une offre à Bordeaux avant cette blessure. Mais cet événement a tout changé. Sans ça, j’aurais fait une meilleure carrière, je n’ai aucun doute là-dessus. Mais c’est comme ça. Finalement, je suis super reconnaissant d’avoir vécu tous ces beaux moments à travers le football. C’est beaucoup plus que ce à quoi je rêvais quand j’étais enfant. Je suis très fier de mon parcours.
Pourquoi cette équipe des Girondins était-elle aussi forte ?
On prenait beaucoup de plaisir à l’entraînement, et on avait des joueurs qui traversaient un grand moment de leur carrière : Yoann Gourcuff, Marouane Chamakh, Fernando, Souleymane Diawara, Alou Diarra, Cédric Carrasso… Quand un grand entraîneur assemble de grands joueurs, ça donne une grande équipe. Il y avait une alchimie entre nous, on était très unis, que ce soit sur le terrain ou en dehors. On savait que pour nous battre, il fallait sortir une grande performance. Avec River Plate, c’est l’équipe dans laquelle je me suis le mieux senti.
Lesquels de ces ex-coéquipiers t’ont le plus marqué ?
En tant qu’attaquant, jouer avec Chamakh était fantastique. Il gagnait tous les duels, je traînais toujours derrière lui pour récupérer des ballons. (Rires.) Et je ne parle même pas du niveau spectaculaire de Gourcuff… Quel joueur ! Il était impressionnant.
Avec le recul, mon départ de Bordeaux était une erreur.
Lors de ta dernière saison au club, en 2009-2010, Bordeaux marche sur l’eau, ralliant les quarts de finale de la Ligue des champions après avoir été sacré champion d’automne… puis s’écroule complètement, finissant sixième du championnat. Que s’est-il passé ?
On bat quand même deux fois le Bayern Munich et une fois la Juventus en phase de groupes. On était à la hauteur de ces grands clubs, et on se fait finalement éliminer par Lyon. On fait une première partie de saison impressionnante, qu’on termine avec huit points d’avance sur le deuxième (l’OM). Je n’ai pas d’explication sur ce qu’il s’est passé. Personne ne l’a, je crois. À la reprise, notre solidité s’est effritée, les autres équipes ont pris progressivement de la confiance… C’est incroyable, inexplicable.
Pourquoi es-tu parti en prêt à Majorque, à l’été 2010 ?
Parce que je voulais connaître le championnat espagnol, qui m’a toujours attiré. On regarde beaucoup le Barça et le Real en Argentine. Au bout de six mois, je suis parti de nouveau en prêt à l’Internacional Porte Alegre, au Brésil. J’ai regretté mon départ de Bordeaux. Avec le recul, c’était une erreur. J’étais très bien là-bas, c’était ma maison, j’ai deux enfants qui y sont nés… Quand tu trouves ce bonheur quelque part, tu devrais rester. C’est ce que je pense maintenant, mais à l’époque, je ne voyais pas les choses de cette manière.
En 2011, tu décides de retourner à River Plate, qui vient de descendre en deuxième division. C’est un acte romantique, non ?
(Il sourit.) Jean-Louis Triaud ne comprenait rien ! Il me restait un an de contrat à Bordeaux et je lui ai dit : « S’il te plaît, il faut rompre le contrat, car je veux retourner en Argentine pour aider River Plate à remonter. » Il se marrait. La vérité, c’est qu’il s’est toujours super bien comporté avec moi. Il m’a écouté et m’a compris. J’avais besoin d’aider mon club formateur. River ne m’a pas appelé. C’est moi qui ai demandé à revenir, car je voulais rendre quelque chose à ce club qui m’avait tant donné, dans ce moment le plus difficile de son histoire. River, j’y ai vécu à partir de mes 12 ans. Je m’y entraînais, j’y étudiais… J’y ai passé la moitié de ma vie, j’y ai grandi en tant que joueur et en tant qu’homme. Pour moi, c’était évident.

Comment as-tu vécu cette folle aventure, conclue en apothéose, avec l’aide également de David Trezeguet ?
C’était une immense pression à supporter. On avait l’obligation de gagner tous les matchs 5-0, ce qui n’existe pas dans le football. En tant que capitaine, j’avais une double responsabilité puisqu’il y avait aussi beaucoup de problèmes à gérer en dehors du terrain, concernant le versement des salaires notamment. Grâce au terrain, on oubliait toutes ces galères. Les supporters ont été impressionnants, ils remplissaient le stade à chacun de nos matchs, c’était incroyable. Concernant Trezeguet, la cohabitation s’est très bien passée. On a joué seulement six mois ensemble, puisqu’il est arrivé lors du deuxième semestre. On évoluait en 4-4-2 avant son arrivée, puis on a basculé en 4-3-3, donc j’ai dû m’adapter. J’ai commencé à jouer plutôt sur le côté gauche, alors que David était plus au centre. Finalement, on a réussi à remplir l’objectif ensemble.
Ton entraîneur était un certain Marcelo Gallardo, qui a bouleversé l’histoire moderne de River Plate…
Je l’ai connu comme coéquipier également, en 2003. C’était le capitaine. C’est un coach qui sait clairement ce qu’il veut. Il est très exigeant avec ses joueurs et sait extraire le meilleur de chacun. Les joueurs savent que s’ils ne sont pas à 100 %, ils ne joueront pas. C’est important. Il est brillamment entouré aussi. Son staff est constitué de grands professionnels. J’ai de grands souvenirs de lui. Je suis sûr qu’il réussira aussi dans le prochain club qui le recrutera.
Après la victoire en Copa Libertadores avec River Plate, je me suis dit : c’est bon, il n’y aura rien de plus fort derrière.
Tu étais une sorte de « tueur élégant » sur le terrain, capable de marquer des buts moches à partir de rien, mais aussi de jolis gestes techniques…
(Il se marre.) Un vrai « renard des surfaces » ! (Il le dit en français.) Et j’aimais participer au jeu également, c’est vrai, donc je décrochais pour toucher le ballon. J’aimais marquer, mais je ne pouvais pas non plus rester scotché dans la surface. Il y a de moins en moins de purs 9, qui sont fixés devant. Le football a beaucoup changé. Au milieu, les joueurs du profil de Riquelme ont progressivement disparu aussi.
Quel est le plus beau but que tu aies marqué ?
Peut-être celui que j’ai inscrit du milieu de terrain en Russie, ou celui face à Tampere (Finlande) avec Bordeaux, sur une longue ouverture de soixante mètres de Trémoulinas que je reprends en une touche pour lober le gardien, dans les arrêts de jeu du match (en Coupe de l’UEFA).
<iframe loading="lazy" title="Cavenaghi against Tampere" frameborder="0" width="500" height="281" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/xoyesl?pubtool=oembed" allowfullscreen allow="autoplay"></iframe>
Après des expériences à Villarreal, en D2, puis Pachuca, au Mexique, tu reviens encore à River Plate et soulèves la Copa Libertadores en tant que capitaine en 2015, pour ton ultime match. Est-il possible d’écrire un scénario plus extraordinaire ?
C’est le rêve que j’avais depuis tout petit. En fait, non, ça va même au-delà. Après ça, je me suis dit : c’est bon, il n’y aura rien de plus fort derrière. Imagine-toi un peu : dernier match dans le club de tes rêves, au Monumental, en tant que capitaine… Et tu gagnes ce trophée. C’est la cerise sur le gâteau. Pour tout ce que ça signifie d’un point de vue personnel, c’est le point culminant de ma carrière.
Une carrière que tu as terminée à l’APOEL Nicosie. Un changement de décor total.
Une expérience magnifique, après la pression et la folie de River Plate. Je me suis retrouvé dans un cadre de vie superbe. En matière de football, c’était le plus grand club de Chypre, on jouait la Ligue Europa, on a gagné le championnat. J’ai vécu de très beaux moments là-bas jusqu’à ma nouvelle blessure au genou droit. Je jouais déjà à 50 % de mes moyens, et celle-là m’a tué. Je suis allé me faire opérer à Barcelone, j’ai été pendant neuf mois en phase de récupération pour essayer de rejouer au football. Mais ça n’a pas marché.
Comment as-tu réagi ?
Tranquillement, car dans ma tête, je savais que j’avais tout donné. Si tu réfléchis, à mon âge, je pourrais encore jouer aujourd’hui. Mais quand le corps ne suit plus, qu’est-ce que tu veux faire ? Il n’y avait qu’à accepter.
Fin de série pour les Girondins, accrochés à Tours par MontlouisPropos recueillis par Thomas Broggini, à Montevideo