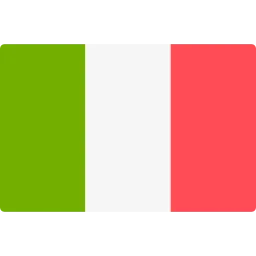Vous êtes un coach atypique, connu pour votre militantisme.
J’étais un militant de gauche, membre d’un mouvement de protestation contre la guerre au Vietnam au début des années 70, Vietnambevegelsen i Norge. C’était un peu notre mai 68 norvégien. La gauche norvégienne est encore très sceptique à propos des États-Unis et d’Israël. Elle a encore de forts positionnements idéologiques par rapport à cela et je me reconnais là-dedans.
D’où vient cet intérêt pour la vie publique ?
J’ai lu beaucoup d’auteurs français quand j’étais étudiant dont Sartre et Camus, principalement en français car les traductions dénaturent toujours un peu l’œuvre. Mes préférés sont Le mythe de Sisyphe et La Chute. Je parle un peu français du coup.
Au début des 90’s, vous prenez la sélection norvégienne en mains, dont la dernière participation au Mondial remonte à 1938…
L’équipe était en gros au même niveau que Malte ou l’Estonie.
Et pourtant, 4 ans plus tard, vous vous qualifiez pour le Mondial 1994 en finissant premier d’un groupe composé de l’Angleterre, les Pays-Bas, la Turquie et la Pologne…
Entre 1991 et 1994, l’organisation défensive a été notre succès le plus important. J’ai organisé l’équipe de manière très stricte, structurée, 100% de défense de zone. L’auteur George Curtis m’a beaucoup influencé. Il avait très tôt écrit un article Flat back four, a entraîné à Rosenborg en 1969 et est un des précurseurs de la défense en zones. Je me suis approprié le concept et je l’ai poussé encore plus loin, en faisant un flat four avec le milieu. Je crois avoir été le premier à le faire.
Concrètement, ça se traduisait comment ?
Mes milieux ne marquaient pas l’adversaire, ne suivaient pas ceux qui n’avaient pas le ballon, juste celui qui l’avait. Notre position sur le terrain est importante, pas celle de l’adversaire. Celui qui a le ballon est le seul opposant avec de l’importance. Avec cette tactique, personne n’a trouvé comment nous battre. Pendant plusieurs années consécutives, on devait être à 0,6, 0,7 but encaissé par match.
Mais le principe de ce marquage de zone au milieu, c’est quoi ?
Réduire au maximum les possibilités de passe du porteur de ballon en se concentrant autour de lui. Un joueur va le serrer de très près et les autres à quelques mètres. Si le ballon est joué sur le coté droit, toute l’équipe se déplace sur le côté droit. Et on commençait dès notre propre moitié de terrain. Physiquement, c’est très exigeant mais l’essentiel, c’est que toute l’équipe bouge ensemble. L’espace entre la ligne de 4 milieux et les 4 défenseurs doit être réduite, mais, surtout, elle doit constamment être la même, quelle que soit la position de l’adversaire.
On le chiffre à combien cet espace idéal ?
2 à 15 mètres maximum. Cela permet d’arriver toujours très vite et d’être près du joueur qui a la balle sans pour autant faire de l’individuel. Avec trop d’espaces, on risque d’être pris de vitesse ou d’avoir face à nous un joueur qui arrive lancé. Contre les grosses équipes, on jouait extrêmement direct, tout vers l’avant. On balançait un peu.
En parlant de jeu direct, comment attaquiez-vous ?
Plus tard dans les années 90, une fois que l’assise défensive était en place, j’ai développé un style très direct et pénétrant. Pas forcément du kick and rush comme les gens le pensent, mais vraiment un foot direct avec des passes uniquement – ou presque – vers l’avant. L’Atlético Madrid s’en rapproche beaucoup aujourd’hui. Ils exploitent les contre-attaques à fond.
Votre conception du jeu, vous la définissez comment ?
Marquage de zone, jeu direct vers l’avant et contre-attaques sont les 3 principes fondamentaux.
Jostein n’était pas très bon footballeur, lent, maladroit, mais imprenable de la tête, c’était sans doute sa seule qualité.
« Jostein n’était pas très bon footballeur, lent, maladroit, mais imprenable de la tête, c’était sans doute sa seule qualité. »
Le système s’adaptait à l’adversaire ? On dit que vous ne changiez jamais de schéma.
Je ne changeais pas les principes de base, mais on jouait un peu différemment selon l’adversaire. Par exemple, contre une équipe forte comme le Brésil, tu as de très fortes chances de te faire punir dans les espaces entre les lignes, entre le milieu et la défense. Donc, contre ces équipes, on jouait de manière encore plus directe pour ne pas se faire intercepter entre les lignes. L’idée, c’était de réduire au maximum les risques.
D’où le kick’n rush ?
On jouait très vite devant, mais cela ne veut pas nécessairement dire long ball. Le long ball, c’est très bien si tu as un attaquant grand et bon de la tête. En l’occurrence, c’était le cas, donc je l’ai fait pragmatiquement. Mais l’essentiel, c’est de s’adapter aux qualités de mes joueurs.
En fait le « long ball » , c’était uniquement à cause de Tore André Flo ?
Oui, mais encore plus avec son grand frère Jostein Flo ! Il mesure 1m97.
Jostein Flo qui jouait ailier en sélection…
Oui, ça a commencé comme une expérience en 93 lors d’un match au Portugal. Je l’ai mis sur le flanc droit de l’attaque. Et nous jouions des balles longues depuis notre arrière gauche, Stig Inge Bjørnebye, qui faisait de très belles transversales. Il devait en adresser le plus possible à Jostein. En fait, cela fonctionnait surtout parce que les latéraux sont petits généralement et moins bons de la tête que les défenseurs centraux. En l’occurrence, je me rappelle que l’arrière gauche portugais était minuscule (rires). On avait fait 1-1 contre le Portugal et on aurait dû gagner ce match et, surtout, Jostein avait toujours le dessus sur son adversaire. Jostein n’était pas très bon footballeur, lent, maladroit, mais imprenable de la tête, c’était sans doute sa seule qualité. Donc on a reproduit cette tactique et on l’a utilisée très souvent, avec Bjørnebye et Jostein Flo. Cela s’appelle le « Flo Pass » .
Le rôle de Flo, c’était de dévier de la tête pour l’avant-centre ?
En fait, Jostein rentrait vers la surface depuis son aile pour jouer le ballon de la tête. À partir de ce moment-là, il avait trois possibilités. L’avant-centre était placé entre lui et le gardien adverse. Il y avait un joueur en soutien derrière sur qui il pouvait remiser et un joueur qui était sur l’aile dans son dos au cas où il n’arrivait pas à jouer le ballon de la tête.
Pourquoi il y avait besoin d’un joueur en soutien ?
Parce que les équipes ont commencé à comprendre cette technique et donc à faire des fautes sur Jostein pour l’empêcher de sauter, genre une poussette ou un coup d’épaule discret. Du coup, le joueur juste derrière, Erik Mykland, notre meilleur technicien, un joueur très fin qu’on appelle ici Myggen (le moustique), récupérait le ballon et pouvait centrer.
Votre formation universitaire a joué un rôle important pour vous, dans votre conception du football ? Vous citez des études comme référence, et on vous appelle le professeur.
J’ai clairement une formation universitaire car j’ai travaillé plus ou moins toute ma vie à l’université d’Oslo pour les sports et l’éducation physique. J’habite d’ailleurs encore en face de l’université. J’ai appris énormément en lisant des articles des études à propos du football. J’étais très proche des idées de Charles Reep, qui est le père de l’analyse de match. Je crois qu’il était militaire de profession. Il a commencé dans les années 50. Quand j’étais sélectionneur, je lui ai rendu visite à Plymouth et je l’ai invité à voir un match contre l’Angleterre. C’était un vieil homme, il avait déjà 95 ans, mais encore bon pied bon œil. J’ai appris beaucoup de lui, comment analyser les statistiques et les archives des matchs grâce à lui. Sur la base des 500 matchs qu’il avait analysés, il a découvert que 80% des buts étaient marqués après 0 à 3 passes. Je crois que c’est le chiffre qui a le plus influencé ma vision du football. Et en moins de 2 passes, c’est 50%.
Charles Reep était un de vos amis ?
Oui, c’était l’un de mes amis, il était toujours brillant à 95 ans. Il a commencé à analyser un match avec un stylo et un cahier ! Il m’a appris beaucoup de choses étranges autour du football. Sur la base de tous les matchs de première division anglaise qu’il avait analysés sur une longue période : si une équipe gagnait 5-0 un match à domicile, elle perdait quasiment systématiquement le match suivant par exemple. Et qu’elle ne marquait jamais plus d’un but. Quand j’étais à Wimbledon, il m’a appelé juste avant un match face à Newcastle. Newcastle avait gagné 5-0 le match précédent contre Watford. Reep m’a dit : « Tu vas avoir un match facile samedi. » Je lui ai demandé pourquoi. Il m’a dit : « Newcastle vient de gagner 5-0 la semaine dernière, tu ne peux pas perdre, c’est mathématique ! » Et on a gagné 2-0. Il avait raison. Depuis, chaque fois qu’une équipe gagne 5-0, je regarde le résultat du match d’après et la théorie se confirme très souvent.
La vision de Charles Reep, c’était vraiment le jeu direct ou le long ball ?
Les deux. D’après ses analyses, l’équipe qui mettait le plus le ballon dans la surface était celle qui gagnait le match presque à tous les coups. Ça paraît logique d’ailleurs. Et la conséquence de cela, c’est qu’il préconisait le long ball.
Pour vous aussi, en disciple de Reep, c’était important ?
Oui, mettre le ballon dans la score box était essentiel. Mais pas forcément avec du kick and rush, mais aller dans la surface de réparation est essentielle, car ces 16 mètres sont la zone dans laquelle plus de 90% des buts sont inscrits, donc il est essentiel d’y arriver.
Beaucoup de gens considèrent que votre Norvège était une équipe ennuyeuse, que répondez-vous ?
Plusieurs fois, j’ai entendu cette critique d’équipe chiante. Mais c’était surtout dû au fait qu’il était très difficile de nous mettre un but. Mais on ne marquait pas beaucoup non plus, car nos joueurs n’étaient pas suffisamment bons offensivement. Contre la France, le 3-3 à Marseille était vraiment une exception. La plupart du temps, on faisait 1-1 ou 0-0. 0-0 devait être notre score fétiche. Notre organisation était sans doute ennuyeuse, mais je préférais un 0-0 qu’une défaite 3-2.
Barcelone serait encore meilleur s’ils jouaient de manière directe, plus vers l’avant. Avec des mecs comme Suárez ou Neymar, ça serait plus utile. Ils font trop de passes superflues.
Mais le jeu direct, c’était aussi pour marquer. Faire autant de 0-0 n’était pas l’objectif ?
Si l’alternative à un 0-0 est de perdre 3-2, alors non, ce n’est pas frustrant de ne pas marquer. Dans les années 90, les gens l’acceptaient, car on ne perdait pas. Les critiques venaient surtout du Danemark où les médias se sont déchaînés contre nous, car ils ne nous battaient jamais, alors qu’ils avaient les frères Laudrup dans l’équipe. Ils écrivaient qu’on était l’équipe la plus chiante du monde. On a perdu contre la Tchécoslovaquie à l’Ullevaal Stadion en 91, et puis on n’a plus perdu un match à Oslo de 91 à 98. Ni en amical ni en qualifications, c’est assez énorme, donc le fait d’être ennuyeux, c’est secondaire.
Mais si tu avais eu sous tes ordres une équipe avec des joueurs plus doués comme le Barça ou ce genre d’équipes, tu aurais adopté une autre tactique ?
Franchement, d’une certaine manière, non. La défense de zone et le jeu direct, j’aurais gardé les mêmes principes. Le tiki taka, pour moi, c’est inutile en quelque sorte. Barcelone serait encore meilleur s’ils jouaient de manière directe, plus vers l’avant. Avec des mecs comme Suárez ou Neymar, ça serait plus utile. Ils font trop de passes, de redoublements de passes et de passes en retrait. Superflues pour moi. je préfère utiliser l’espace quand il existe, surtout quand les adversaires ne sont pas équilibrés, il faut en profiter, casser les lignes et ne pas leur laisser le temps de se replacer. Il faut attaquer plus vite.
J’imagine que pour vous, la possession de balle n’a pas d’importance ?
Absolument aucune. Dans le championnat espagnol, l’Atlético était 13e en terme de possession de balle l’an passé, avec un jeu qui était plus ou moins le contraire de la possession de balle, et ils ont été champions. Il y a plein de choses qui montrent que 70 ou 80% de possession, c’est contre-productif.
Vous n’avez pas peur d’avoir un peu tué la magie du jeu, en vous appuyant essentiellement sur les chiffres et en basant votre tactique sur l’analyse de données ?
Le football, c’est juste gagner. La beauté du jeu, c’est le résultat ! La beauté du jeu est un concept abscons. Le football le plus efficace est en fin de compte le plus beau. Vous vous rappelez de Boklov, le champion suédois de saut à skis ? Il a été le premier à sauter avec les skis écartés. Avant, tout le monde sautait avec les skis parallèles. Quand il a commencé à le faire, tout le monde a dit : « Esthétiquement, c’est horrible, comment peut-il dénaturer son sport ainsi ? » Résultat, aujourd’hui,tout le monde saute de cette manière parce que c’est plus efficace.
Le beau jeu serait donc secondaire ?
Le football, c’est d’abord le soutien à une équipe. Quand tu regardes un match, c’est souvent parce que tu supportes une des équipes. C’est rarement neutre. Les supporters veulent voir gagner leur équipe. Donc le plus beau football, c’est juste le plus efficace, celui qui permet d’arriver à ce résultat, parce qu’à la fin, seul le résultat compte.
La victoire contre le Brésil lors de la Coupe du monde 98, c’est votre chef-d’œuvre comme coach ?
Je crois surtout qu’on est la seule équipe au monde à avoir joué le Brésil plus d’une fois sans jamais perdre. On les a joués 3 fois pour 2 victoires et un nul. La première fois, on les a battus 4-2 à Ullevaal en amical, mais je n’étais pas surpris, car ils arrivaient d’un long voyage donc étaient fatigués et le terrain était pourri. Bref, un alignement de facteurs qui jouaient en notre faveur. Pour le match de Coupe du monde, on avait analysé le Brésil très précautionneusement. Et on a fait un très gros match contre eux, car j’analyse toujours les matchs en fonction des goal chances, des occasions de but, quelque chose de fondamental. Mon travail, c’est de faire en sorte qu’on ait le plus d’occasions de buts, et sur ce match, on en a eu plus que le Brésil. On gagne 6-4 en goal chances Quand tu as plus d’occasions que l’adversaire, logiquement, tu gagnes souvent le match. Mais pas toujours. C’est la part de chance et de hasard en football, c’est assez mystérieux et c’est ce qui fait la beauté du jeu.
Quel était le plan pour battre le grand Brésil ?
Normalement, mon équipe jouait entre 60 et 70% de ses passes vers l’avant. Le football le plus efficace, je l’estime à environ 70%. Contre le Brésil, nous avons joué 65% de nos ballons vers l’avant, le Brésil juste 35%, la différence est essentiellement là. C’est une différence dramatique. Si le Brésil avait joué 65% de ses ballons vers l’avant, ils nous auraient battus largement. Bien sûr, c’est une hypothèse que je ne peux pas prouver, mais j’en suis convaincu.
Votre travail, c’était de créer ces occasions ?
Oui, statistiquement, il y a un but toutes les 3 ou 4 occasions.
Mais ça dépend surtout de la qualité des attaquants, non ?
Pas tant que ça. Sur une base de données importante de matchs analysés sur une saison, toutes les équipes sont dans cette fourchette. Le ratio d’un but toutes les 3 ou 4 occasions se vérifie quelle que soit la qualité des attaquants. La qualité des attaquants crée surtout les occasions, plus encore que les buts. Convertir chaque occasion est impossible. Sur un match, c’est possible, mais sur le long terme, non.
Vous avez écrit un livre, Drillo’s Verden. Il parle de quoi ?
Ça parle de géographie, ma première passion. À même pas 10 ans, je connaissais les capitales de tous les pays du monde par cœur. Puis j’ai poursuivi cette passion : tous les samedis, j’écris un article dans un grand journal norvégien, DagBladet, et cette chronique est un quizz géographique. Il y a deux niveaux : un quizz de niveau moyen pour les gens normaux et un quizz pour les experts. Pour les experts, je pose des questions dont les réponses ne peuvent pas être trouvées dans Google, des sortes d’énigmes ou anagrammes. Par exemple, cela peut être un anagramme avec un nom de pays et une commune norvégienne. Il faut réfléchir.
Lyon : à Textor et à travers