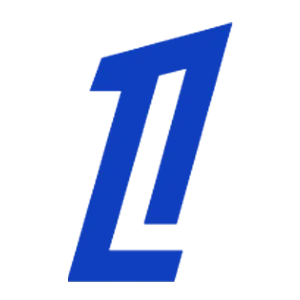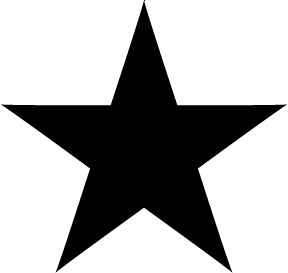Pourquoi écrire un nouveau livre sur George Best, alors que, comme vous le dites au début du Cinquième Beatles, tout a été déjà écrit ?
Cela faisait des années que je souhaitais écrire sur Best. Le cirque qui avait entouré l’arrivée de Beckham aux Los Angeles Galaxy avait réanimé le souvenir qu’un autre joueur britannique au statut de rock star était parti jouer aux États-Unis trente ans plus tôt. Il se trouve que le jour de sa mort, j’ai été désigné pour écrire sa nécrologie dans L’Équipe. J’ai toujours adoré le football anglais, le seul football étranger qui ne m’ait jamais intéressé, et donc j’avais une certaine fascination pour le destin de Best que je n’ai jamais vu jouer, jamais rencontré. Je suis d’ailleurs très jaloux de Jean-Philippe Leclaire, un ancien collègue de L’Équipe, qui avait un jour pissé à côté de lui dans les toilettes de Wembley. Moi, j’ai juste rencontré ses anciennes femmes, son ancien agent et ses anciens partenaires. Je ne voulais pas écrire une biographie classique, parce qu’elle avait déjà été rédigée en anglais. Au départ, je voulais traiter les années américaines et utiliser le procédé du flash-back pour revenir à Belfast, à Manchester United, et finalement ces années sont tellement riches que je suis revenu à un récit assez chronologique. Ce n’est pas un livre sur le footballeur – il doit y avoir à peine quinze pages sur le football – mais tout ce qui entoure sa légende, les femmes, l’alcool, les beuveries, les voitures.
Le cinquième Beatles renvoie aux livres écrits par Nick Tosches ou Norman Mailer sur la boxe, des exercices où les faits servent à construire des mythes et des destins romanesques.
C’est marrant, parce qu’il y a quelques jours, on m’a demandé quels étaient mes dix livres préférés et j’ai cité la biographie de Nick Tosches sur Dean Martin, Dino. Donc je vais pas me plaindre de cette comparaison. Je suis allé voir ce qui se faisait dans le genre, ce qu’avait écrit Jean Echenoz à partir de Zatopek ou Colum McCann sur Noureev. Il y a plein d’exercices modernes qui montrent que la frontière est mince entre la biographie fidèle et le romanesque inspiré de la réalité. Les faits rien que pour les faits ne m’intéressaient pas, mais cela m’intéressait de les mettre en scène. Pas de parler de moi, parce que, quand on est journaliste de sport, on a un peu du mal à se déboutonner. Ce n’est pas naturel, mais j’ai regardé comment on pouvait malaxer une vie pour aboutir à quelque chose de proche du roman. Dans le livre, par exemple, j’ai mis bout à bout des déclarations de George Best qu’il avait pu faire avec dix ans d’écart. Il n’empêche qu’entre les DVD, les matchs sur Youtube, j’ai visionné plus de matchs de George Best que de n’importe quel joueur actuel. Je me suis rendu compte que tous les gens qui avaient écrit avaient plus ou moins eu accès aux mêmes histoires et qu’il était difficile de déterminer la primauté. Donc j’ai probablement volé des choses, mais comme n’importe quel rat de bibliothèque qui a intégré des informations sans être capable de les sourcer de manière précise. À l’arrivée, je n’ai rien inventé.
Est-ce que c’est un livre générationnel ?
Forcément, un peu. Parce qu’il faut avoir un certain âge pour se rappeler son premier voyage en ferry vers l’Angleterre, du frisson de la découverte des vinyles ou des mini-jupes. C’est une époque où on va à Londres pour aller acheter des disques à Tower Records ou des livres à Sportspages, le magasin de Charing Cross spécialisé dans les bouquins de sport. Il n’existait rien de tout ça en France. Aujourd’hui, les mondes sont un peu plus poreux. Si je veux m’acheter un maillot d’un club anglais ou un livre, je le commande et je le reçois deux jours plus tard. La seule chose qu’on ne peut pas se payer aujourd’hui avec un clic, c’est l’atmosphère de ces années. Donc, c’est, quelque part, aussi un livre sur une culture particulière, toute la mythologie de l’Angleterre, le football et la musique.
Est-ce que George Best, de son vivant, travaillait à construire sa propre légende ?
Oui, et c’est un peu son drame. C’est devenu assez rapidement son métier principal. Le football s’est éloigné en périphérie. Il gagnait cinq fois plus avec les médias et les pubs qu’en tant que footballeur. Il avait toujours les poches percées, donc il avait besoin de beaucoup d’argent. Il appelait les journalistes pour leur vendre « une bonne histoire » et pour qu’elle soit bonne, il fallait qu’elle soit drôle, quitte à les inventer ou les voler dans les bars. Ce que Michel Audiard faisait aussi. Il a écrit ses dialogues en écoutant les conversations de comptoir. Pour Best, c’était devenu l’équivalent des « Last dinner circuit » . Ces galas de charité et de bienfaisance où d’anciennes gloires du football racontent des anecdotes drôles de leur carrière. Peu importe que ce soit vrai ou qu’elles changent d’un jour à l’autre, ce qui comptait pour Best, c’était d’avoir une bonne histoire à vendre.
Dans le livre, George Best apparaît un brin cynique, loin de l’innocence enfantine associée au personnage.
Ce n’était pas un cynique absolu, sinon personne ne l’aurait aimé. Il était avant tout un mélange de candeur, de timidité, d’attention. On peut le trouver cynique parce qu’il empile les conquêtes féminines. Mais, malgré le nombre, il tombait souvent amoureux, même si cela ne durait pas longtemps. Je crois que ses périodes de dépression sont liées à la déchéance de Manchester United. À l’époque, les transferts n’étaient pas possibles, il était contraint d’évoluer pour un club qui allait même descendre en deuxième division en 1974. Dans l’équipe, il y avait un gars qui était rémouleur de couteaux. Donc, avec son talent, il devait se dire qu’il n’avait aucune raison d’aller se coucher tôt. Il leur a souvent claqué dans les doigts, mais le terrain était aussi l’endroit où il se sentait le mieux. Best n’était pas préparé à vivre cette vie de rock star. Parce qu’il a été le premier, il n’y a eu aucun footballeur avant. Sa vie ressemblait à celle des Beatles ou des Rolling Stones, sauf que lui n’était pas entouré, il était seul.
Propos recueillis par Joachim Barbier
Vincent Duluc, Le cinquième Beatles, Stock.
Au Paris FC, l’important c’est de prendre son temps