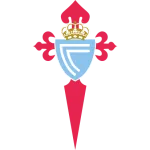- Ligue 2
- J6
- Le Havre-Orléans
Didier Ollé-Nicolle : « L’apprentissage, c’est l’art du rabâchage »

Vainqueur du Paris FC vendredi dernier, Orléans a confirmé cette semaine le déclic en allant se qualifier aux tirs au but en Coupe de la Ligue, à Nancy. En déplacement au Havre, la bande va chercher à enchaîner deux victoires en Ligue 2 pour la première fois depuis février 2018. Large entretien avant le voyage avec Didier Ollé-Nicolle, 56 ans, qui aurait pu retrouver cet été la Ligue 1, dix ans après avoir débarqué à Nice avec l’étiquette d’entraîneur à la mode.
Comment dort-on après une qualification en Coupe de la Ligue aux tirs au but ?Je n’ai pas bien dormi, mais pas parce que c’était la Coupe de la Ligue, ni parce qu’on s’est qualifiés. En fait, je ne dors pas du tout après un match. Il y a dix ans en arrière, c’était différent : l’insomnie, c’était la veille de la rencontre, à cause de la pression, de cette impression d’oublier quelque chose…
Que faites-vous alors ?Je revois le match, par exemple, quand on arrive à récupérer les images. Ce n’est pas toujours facile, et sinon, je tourne en rond, je me refais le match dans ma tête, je commence à réfléchir à la semaine qui arrive… Autant entraîneur est un métier de passion sur le plan humain, autant le rapport au résultat est toujours complexe : quand ton équipe perd, tu broies du noir et tu es à l’envers pendant trois jours ; quand elle gagne, tu es heureux une heure.
C’est impossible de savourer un résultat ?Ce n’est pas évident, même si, après une victoire, on se lève avec le sentiment d’avoir bien travaillé et avec la conscience que le vestiaire sera plus heureux. Savourer, chez moi, c’est une heure, pas plus. Ensuite, on bascule directement dans la prochaine séance, le prochain match, l’instant d’après.
Justement, le terrain : Orléans a connu un début de saison compliqué, avec trois défaites sur les trois premières journées (contre Lens et Auxerre, et à Metz) avant de battre le Paris FC (4-0) vendredi dernier. Aujourd’hui, vous expliquez désormais « connaître » votre équipe. Cet été a été plus compliqué que les autres ? Le soir de la défaite contre Auxerre (0-3, le 10 août, N.D.L.R.), j’ai dit à mes joueurs que cela faisait partie de l’apprentissage, qu’on avait tous déjà vécu des soirées comme ça, et j’ai vu leur regard. L’un de mes joueurs, Yohan Demoncy, m’a dit : « Non coach, on n’a jamais connu ça… » Pour comprendre ça, il faut se refaire le film : quand je suis arrivé à Orléans, en décembre 2016, le club était dernier de Ligue 2. Lors de la trêve hivernale qui a suivi, on a perdu beaucoup de joueurs, mais il fallait installer rapidement un esprit commando dans le groupe pour sauver le club. C’était hors norme : on a fait un mini-stage d’entrée pour se mettre tout de suite dans le travail, le travail et seulement le travail, sans logique de programmation athlétique, rien. On a emmené les joueurs courir en forêt, au bord du lac, les séances ont été doublées tous les jours, tout ça pour aussi supprimer le sentiment de fatalisme qui habitait le vestiaire. Le point de départ, c’est donc une mission d’urgence.
Et une réussite.Oui, parce qu’on a réussi à se sauver au printemps, ce qui nous a permis d’ouvrir un nouveau projet, plus jeune, plus clair, avec une idée de base : on est un petit budget, on est Orléans, on a des joueurs usés qui ne croient plus au projet, il faut changer. Je me suis servi de ce qu’on avait fait à l’époque à Clermont avec Claude Michy, où l’on avait reconstruit un groupe avec des jeunes joueurs issus de la post-formation, donc des mecs qui ont beaucoup de choses à apprendre, mais aussi beaucoup de choses à donner parce qu’ils ont touché du doigt la Ligue 1, sans vraiment avoir l’opportunité de croquer dedans.
C’est quoi le discours pour récupérer ces joueurs-là ?Il faut leur dire qu’on n’a pas l’expérience, qu’on ne sera pas la meilleure équipe du championnat, mais qu’on va bosser et qu’en matière d’évolution, ça va fonctionner. Quand tu as un petit budget, il faut trouver une idée plutôt que d’aller chercher des joueurs vieillissants, qui viennent chercher un dernier contrat et où tu sais que tu ne pourras pas avoir les meilleurs d’entre eux parce qu’ils préféreront jouer à Brest, à Reims ou au Havre… Résultat, tu te retrouves avec des seconds choix. À Clermont (2006-2009), on a réussi à monter une équipe qui a battu tous les records de l’histoire du National, qui est montée en Ligue 2 et qui a failli monter en Ligue 1 derrière avec des garçons pratiquement oubliés : Mehdi Benatia, Poté, Yatabaré, Grougi, Lesoimier, Joris Marveaux. Derrière, ils ont tous fait une bonne carrière en Ligue 1. Ainsi, tu deviens une étape, c’est ce qu’on a proposé l’été dernier et c’est ce qu’on voulait continuer cette saison, mais…
Mais des joueurs sont partis : Yannick Gomis, Ferris N’Goma…Des garçons qui étaient au club et qui ne jouaient pas quand je suis arrivé. On a dû les vendre, alors que ce n’était pas prévu et ça a bousculé la préparation là où l’année dernière on avait réussi à travailler rapidement avec un groupe au complet. On a à peine joué les trois derniers matchs amicaux parce qu’on n’avait pas assez de joueurs et les trois premières journées ont finalement servi de préparation. Le truc, c’est que ces jeunes joueurs découvrent le poids d’une défaite. Quand tu viens du PSG, que tu as eu l’habitude de gagner, que tu t’entraînes avec Pastore, Motta, mais que tu ne joues pas, c’est différent : la Ligue 2, c’est une responsabilité, c’est ça le vrai monde professionnel, et j’ai senti que ça avait été lourd à porter pour certains. Il a fallu dédramatiser la chose et leur expliquer qu’il ne faut pas perdre les pédales pour un match de foot, surtout lorsqu’on a vingt piges. Depuis la qualification en Coupe de la Ligue contre Béziers mi-août, ça commence à prendre, et j’ai l’impression d’avoir trouvé la bonne formule.
C’est quoi le style Orléans ?L’idée est d’avoir une équipe très active dans la récupération, qui va au maximum presser l’adversaire et qui enchaîne rapidement par du jeu court. C’est du football alerte, et à Nancy, mardi soir, tu vois, une personne que je connais très bien m’a dit après le match qu’elle avait retrouvé lors de la rencontre le style de notre équipe, celui que l’on imposait l’année dernière. Ça, ça me fait plaisir.
Comment ça s’entretient, un style ?Avoir des jeunes joueurs est parfait pour ça, car ils cherchent en permanence à progresser, et l’apprentissage, c’est l’art du rabâchage. À 90-95%, notre style, c’est le nôtre. On prépare nos rencontres par rapport à nous, très rarement par rapport à l’adversaire. Je ne peux pas me laisser dicter une rencontre par l’adversaire. Les séances de la semaine te permettent de multiplier les séquences pour se mettre le plus possible dans l’intensité et la jeunesse t’amène naturellement vers ce type de football : un football dynamique. Bien sûr, je n’ai pas toujours pu faire ça : quand j’étais à Raon-l’Étape, où j’ai commencé ma carrière d’entraîneur, ma seule idée était de défendre, d’être costaud derrière, mais parce que je n’avais pas la même qualité technique à disposition. C’était du foot à l’énergie, mais c’est trop dur à vivre, car en match, tu ne retrouves jamais quelque chose que tu as préparé la semaine, tu es toujours dans la bagarre. Aujourd’hui, mon plaisir, c’est d’entendre une personne de l’extérieur dire que quelque chose se dégage de mon équipe : là, tu as le sentiment de servir à quelque chose.

Avez-vous encore le temps de regarder du foot à la télé ?Oui, parce que j’adore le foot et parce que le haut niveau me sert aussi à donner des images aux joueurs. C’est essentiellement de ce niveau-là que tu apprends si tu veux progresser et avec lequel tu peux donner des idées à tes hommes. Tu peux y prendre des références et par exemple, moi, Mehdi Benatia, je l’ai eu lorsqu’il sortait de Marseille, de Tours, de Lorient, où il ne jouait jamais, il s’était fait deux fois les croisés… Je ne lui pas appris à jouer, mais à travailler. Quand on participe à ça, c’est merveilleux.
Un entraîneur ne coupe donc jamais ?Cet été, j’ai regardé toute la Coupe du monde, mais j’ai aussi coupé un peu parce que le foot peut devenir usant. Jusqu’à peu, je pouvais regarder toute la Ligue 1 le week-end, mais aujourd’hui, j’ai besoin d’un peu plus de fraîcheur mentale, de sortir un peu du milieu, pour pouvoir entraîner.
Cet été, vous avez également eu des discussions avec le Téfécé pour revenir en Ligue 1. Ce n’est pas quelque chose qui vous a perturbé ?En général, quand je suis en vacances, au bout de deux semaines, le foot me manque, mes joueurs me manquent, l’entraînement me manque… Et là, j’avoue que je serais bien resté un peu plus en vacances. C’est la première fois que ça me fait ça et ça a été plus dur de repartir, j’avoue. J’avais envie d’aller à Toulouse, de retrouver la Ligue 1, j’y étais même presque déjà psychologiquement, mais ça ne s’est finalement pas fait, c’est comme ça. Le président était d’accord pour me libérer, et finalement, je me dis aussi que cette sollicitation est une forme de valorisation de notre travail ici et de nos idées. Après, dès la reprise, c’était oublié.
Vraiment ? La Ligue 1 ne vous manque pas ?J’ai vécu une expérience formidable à Nice, à un moment où c’était linéaire pour moi. À l’époque, j’avais eu la possibilité de m’engager avec Montpellier, Lens, le Standard de Liège, mais j’avais choisi Nice pour Maurice Cohen, le président, dont j’étais un choix personnel. Dès le départ, on savait que ça serait compliqué : j’avais travaillé sur l’effectif avec Frédéric Antonetti, à qui je venais de succéder et qui était resté pour faire la transition. Malheureusement, on ne pouvait pas garder les joueurs qu’on voulait garder et ceux dont on voulait se séparer étaient vieillissants, mais toujours sous contrat… Si Antonetti a arrêté, c’est aussi parce qu’il savait que ça serait difficile. Le président Cohen m’avait fixé comme objectif la quinzième place et moi, j’étais dans une forme de déni parce que je voulais entraîner en Ligue 1. C’était l’heure, j’étais à la mode, mais je suis tombé à ma première expérience. Je n’en veux à personne, j’ai accepté le deal de départ, j’ai forcément ma part de responsabilité, mais au moment où je me suis fait virer (le 9 mars 2010, N.D.L.R.), Nice était quinzième.
Qu’est-ce qu’il s’est passé concrètement ?Ce qu’il faut comprendre, c’est que je suis arrivé au club une année de CAN : ça concernait quinze-seize joueurs de l’effectif ! Avec les qualifications à la Coupe du monde en plus, tout le groupe partait toutes les deux semaines. En janvier, on a été jouer un match à Montpellier avec huit pros et huit joueurs de la CFA2, dont certains que je ne connaissais même pas… On n’avait pas le choix, il fallait onze mecs pour débuter. Mais au-delà de ça, on avait réussi à monter une équipe difficile à battre : on a battu le grand Lyon (4-1) chez nous, on a gagné au Parc (0-1)… Mais le club était aussi en plein changement, le président Cohen avait été viré par le board en septembre et j’avais décidé de présenter ma démission en solidarité avec l’homme qui m’avait fait venir. Sur le moment, il avait refusé ma démission et m’avait dit : « Non coach, ils vont vous virer, parce que vous n’êtes pas leur choix, mais ne leur faites pas le plaisir de leur faire cadeau de votre contrat… » Je savais que je ne finirais pas la saison, les bons résultats ne faisaient que retarder l’échéance.
Puis, vous avez disparu.Je n’avais jamais connu ça : tu te lèves le matin et tu ne sers plus à rien. Quand tu entraînes, tu es pris en permanence entre les séances, la gestion des joueurs, les médias, les obligations extérieures et d’un coup, le vide. Tu es chez toi, la saison se termine, plus personne ne t’appelle et j’ai développé une forme d’état dépressif, sûrement. C’est pour ça que je suis parti à l’étranger et aussi parce que personne ne m’a contacté en France, il faut être honnête, à l’exception de Bastia, qui était en National. Mais je n’avais pas la pêche sur le moment, j’avais une cicatrice à refermer.

Et comment on s’y prend ?Je suis parti, à Neuchâtel d’abord, grâce à Bernard Lacombe, dont le meilleur ami, Fleury Di Nallo, était l’agent de Mickaël Poté, que j’avais emmené avec moi de Clermont à Nice. Il avait soufflé mon nom au président du Neuchâtel Xamax, qui cherchait un entraîneur français. J’ai vécu une aventure merveilleuse en Suisse, on s’est sauvés avec un bon groupe et le club a disputé en fin de saison une finale de Coupe de Suisse, face au FC Sion, un derby. Je ne suis pas resté, car juste avant la finale, le club a été vendu à des Tchétchènes. Ils m’ont alors proposé un nouveau contrat, avec de très bonnes conditions, mais en échange d’une chose : qu’en finale de la Coupe de Suisse, je change mon staff, que j’accepte des Tchétchènes avec moi sur le banc et que je n’aligne pas mes trois titulaires africains. C’était lunaire ! J’ai refusé et le soir du rachat, je me suis fait virer. C’est certainement ma plus grande fierté dans le foot : d’avoir refusé de plier.
Qu’est-ce qui vous intéressait tant que ça dans l’étranger ?Découvrir une nouvelle culture, une autre langue, voir si je pouvais m’expatrier… Mon expérience à Neuchâtel m’a revivifié et j’ai ensuite pu repartir à 2000%. J’ai aussi connu Chypre, l’Algérie et le Bénin, dont j’ai pris pendant quelques matchs la sélection. Tout ça a été positif. Puis, un jour, entre Alger et le Bénin, je suis revenu en France.
Oui, à Rouen.C’est Thierry Granturco qui était venu me chercher en me proposant un projet sur trois ans, pour reconstruire le FC Rouen… Au bout de la première saison (en 2012-2013, N.D.L.R.), on a réussi à remonter en Ligue 2 et on connaît l’histoire : le club a reçu une pénalité, a été bloqué par la DNCG et pendant une semaine, on ne savait pas encore si on allait évoluer en Ligue 2. On n’a jamais vraiment su ce qu’il s’était passé, mais un matin, entre la première et la deuxième journée du championnat, j’arrive au stade, j’ouvre le journal et j’apprends que le club vient d’être liquidé judiciairement. On est le 15 août et le club est en DH. Et là, tu fais quoi ? J’avais recruté sept joueurs, leurs épouses avaient lâché leur boulot, ils avaient déménagé… La moitié de l’effectif a rapidement rebondi, mais les autres n’avaient plus rien. Moi non plus. Donc je suis resté les entraîner gratuitement jusqu’à ce que le dernier joueur ait trouvé un club.
Vous avez connu une expérience similaire à Colmar ensuite… Orléans, c’est une stabilité totale ?J’ai eu peur en arrivant parce qu’on m’avait dit que le club était stable et au bout de quelques jours, je vois des joueurs partir… Quatre mois après, on nous retire quatre points au classement (pour non-respect des obligations en matière de présentation des comptes et communication d’informations inexactes, N.D.L.R.), alors qu’on avait réussi à sortir le club de la zone rouge… J’ai craint d’être le chat noir. (Rires.) Finalement, on a quand même réussi à se sauver.
Le foot n’a pas changé en vingt-six ans dans le circuit ?Si… Par exemple, cet été, on ne devait vendre personne. C’est ce que je te disais : N’Goma, Gomis, on voulait continuer à bosser avec eux, bâtir quelque chose, construire sur le moyen terme, sauf qu’ils font une saison pleine en Ligue 2 avec nous et ils disparaissent. N’Goma, le matin même, il s’entraînait avec moi et quelques heures après, j’apprends qu’il est vendu à Brest. Il y a sept ou huit ans, ça ne serait jamais arrivé. Résultat, tu apprends à entraîner différemment, à t’adapter un peu plus et c’est pour ça que le week-end, je prends un peu plus de temps pour décrocher, je vais marcher, en forêt… Mais ça ne me fait pas peur. Le monde a changé, mais j’espère toujours revoir un jour la Ligue 1.

Propos recueillis par Maxime Brigand, à Orléans