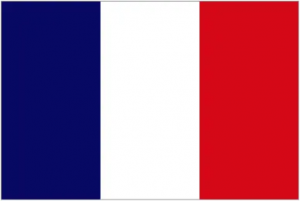- International
Conflit en Ukraine : le football et son double

La FIFA a beau exclure la Russie de tous ses panneaux publicitaires, rien n’y fait. Nous n’avons pas encore trouvé la compétition qui détournera nos yeux de l’apocalypse nucléaire. Faut-il continuer à chercher ?
Rien de plus fragile que le football. Pendant quelques heures cette semaine, nous en avons fait l’expérience. Après le déclenchement de l’invasion russe en Ukraine, il fallait faire quelque chose. Le football ne pouvait pas rester sans réagir. Dans un premier mouvement, la FIFA, reine du monde des apparences, avait d’abord proposé (par habitude peut-être) d’effacer les signes trop visibles de la dérangeante Russie (logo, maillots, hymnes, couleurs, stades) sans en exclure les athlètes. Étrange initiative. Peut-être, pensait-elle, qu’il suffisait de faire comme d’habitude et de transiger un peu sur les apparences le temps que la situation se calme. Le match d’ouverture démarré, on aurait tout oublié, et le tour serait joué.
« Cela ne nous intéresse pas de participer à ce match d’apparences. L’équipe nationale de Pologne ne VA PAS JOUER contre la Russie, peu importe le nom de l’équipe », avait alors réagi Cezary Kulesza, président de la fédé polonaise qui devait affronter les spectres russes le 24 mars en match de barrages du Mondial au Qatar. Sous la pression des puissantes fédérations occidentales et la menace de boycott des rencontres en question (rendant de facto impossible la tenue de la compétition), la FIFA avait fini par doubler la mise. Il fallait sauver la rémunératrice illusion — les compétitions — de la dévastatrice réalité — l’invasion russe. Le communiqué est donc tombé lundi soir à 18h30. Les équipes russes étaient suspendues « jusqu’à nouvel ordre » de tous nos barnums sportifs. L’essentiel était sauf. Le football pouvait continuer de tourner.
Malaise dans nos compétitions
Il avait fallu quatre jours (dont un week-end de championnat) pour que les chefs du football prennent la mesure de la situation et se décident à céder aux pressions de l’opinion publique. Que les choses soient claires. Ces décisions sont parfaitement légitimes. Le propos ici n’est pas d’en contester la valeur, mais plutôt de pointer ce malaise que paradoxalement ces décisions nécessaires ne sont pourtant pas parvenues à dissiper. Car enfin il y avait quelque chose d’un peu gênant à cette irruption générale de vertu. On a toujours un peu de mal — on est devenus fragiles, c’est vrai — à compter sur la FIFA pour défendre le football. Sans vouloir être désagréable, il est devenu difficile de faire à nouveau confiance aux bonnes intentions quand on a été si souvent déçus. Ce n’est pas du dépit, c’est de la prudence. L’argent, la corruption, la laideur des âmes, tout ça, on sait. Mais on avait trouvé une parade pour sauvegarder notre équilibre psychique : ne s’intéresser qu’au terrain, éviter à tout prix de briser l’illusion péniblement consentie. Le temps d’un titre mondial (en Russie) ou d’une Ligue des champions (financée par Gazprom), la duperie mutuelle tenait en une phrase : « Donnez-nous du rêve, nous vous paierons en croyance. » Et pourtant, cette fois-ci, avec l’Ukraine, la mécanique s’est grippée. Les sanctions sont tombées, oui. Mais le malaise demeure.
La guerre qui dérange
On avait accepté le Mondial au Qatar au moins de novembre, le rachat de Newcastle par les Saoudiens, alors pourquoi pas du football sans l’Ukraine et la Russie, après tout ? Pourquoi le malaise, cette fois-ci, n’avait-il pas été dissipé par ces sanctions ? Peut-être parce qu’il ne s’agit plus d’enveloppes cachées, de mœurs privées, d’argent public invisible, de tractations secrètes. Il y a toujours un fond de l’âme humaine prêt à pardonner à la cupidité. Non, l’invasion de l’Ukraine — qui avait patienté jusqu’à la fin de la trêve olympique pour être entamée, rappelons-le — c’est différent. On ne l’a pas entendue un soir sur un Space ou dans la bouche d’un camarade éditorialiste célèbre à la radio. Non, on l’a vue. De nos yeux. Et on est resté sidérés par ce qu’on a vu : des chars, des armes, des dictateurs et, juste après, des larmes, du sang, des morts. Bref, on a vu la guerre. De loin, c’est vrai. Mais la vraie, celle qui fait peur, la guerre mondiale. Nos stratagèmes d’évitement sont efficaces pour lutter contre la corruption — invisible des yeux —, beaucoup moins rodés face à des menaces aussi visibles que dérangeantes. Car, il faut le dire ici, cette guerre dérange le football parce que, à strictement parler, elle le force à modifier les fragiles équilibres sur lesquelles son adhésion repose. La perception de la guerre mondiale bouleverse toutes les autres. Le déni est impossible. Nous n’avons pas encore trouvé la compétition qui détournera nos yeux de l’apocalypse nucléaire.
« J’ai vu, j’ai admis, mais qu’on ne m’en demande pas davantage »
Mais alors, monsieur le philosophe, pourquoi ne renoncez-vous pas au football ? Y a-t-il une indécence supplémentaire à attendre les huitièmes de finale de Coupe d’Europe au moment où, justement, l’Europe prend les armes ? Malheureusement, désolé, les philosophes n’ont pas de réponse à ce genre de dilemmes. Mais une (re)lecture, peut-être, pour mieux en saisir toute la profondeur. Celle de Clément Rosset, penseur niçois mort en 2018 et dont la prose légère enfonce le clou dans l’œil à chaque moment d’égarement. Son concept de « double » peut nous aider à penser l’urgence que nous avons en ce moment à vouloir à tout prix arracher les autocollants et annuler l’existence d’un continent tout entier. Le prix du football, ce n’est plus l’argent public dilapidé, les conflits d’intérêt, l’argent-roi. Ça, c’était le bon temps. Il suffisait de se tenir éloigné du bon endroit au bon moment pour s’épargner les maux de tête.
Non, le prix du football désormais, c’est autre chose : publicités Gazprom retirées, bannissement d’Abramovitch, exclusion des Russes du Mondial 2022, de la Ligue Europa, d’un célèbre jeu vidéo. Il s’agit maintenant, pour les chefs du sport, d’éradiquer une à une les dernières traces du réel dans l’illusion. « Je ne refuse pas de voir, et ne nie en rien le réel qui m’est montré. Mais ma complaisance s’arrête là. J’ai vu, j’ai admis, mais qu’on ne m’en demande pas davantage », écrit notre regretté sage dans Le Réel et son double. Mais que faire alors quand le réel nous « crève les yeux » — comme le dit si bien le français — et l’emporte sur son double de papier ? Que faire quand il est devenu à ce point encombrant qu’il s’invite à tout propos dans nos histoires ? Quel remède existe-t-il à la croyance quand il est devenu inutile de fermer les yeux ? Une seule solution. Celle d’Œdipe. C’est poétique, mais, on vous aura prévenu, c’est aussi très douloureux.
Les Bleuets plient la Pologne, mais terminent deuxièmes de leur poulePar Thibaud Leplat