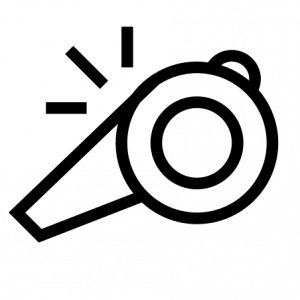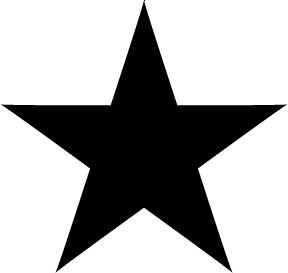Renato, comment ça se passe pour toi en Turquie ?
Bien, même si c’est un mode de vie très différent de celui de la France. L’adaptation n’est pas des plus faciles. Sur le plan sportif, l’objectif de Bursaspor était de terminer dans les quatre premiers en début de saison, pour se qualifier pour la Coupe d’Europe. Bon, on n’est qu’en deuxième partie de tableau, à 6 points de la 4e place et pas si loin de la zone de relégation. Mais en coupe, on a fait 2-2 en demi-finale aller sur la pelouse de Galatasaray, ce qui est plus encourageant.
Il y a plusieurs Argentins dans l’effectif, ça a dû t’aider un peu, non ?
Oui, il y a Fernando Belluschi, très connu en Argentine. Il a joué à River, à Porto, au Genoa, à l’Olympiakos. Il y avait aussi Pablo Batalla, une idole du club, mais il vient de partir en Chine suite à un problème avec l’entraîneur. Sinon, il y a Insua, ancien d’Independiente, de Boca et de Málaga. Mis à part eux, pour pouvoir communiquer, il y a Taye Taiwo et Sébastien Frey.
Tu t’entends bien avec eux ?
Oui, on parle un peu de la Ligue 1, avec Michael Chrétien aussi, qui est là depuis trois ans. Se retrouver avec eux aide à l’adaptation. Je crois que si tu ne parles pas bien la langue locale, tu ne t’adaptes jamais complètement à un pays. Et je ne pense pas réussir à maîtriser le turc d’ici la fin de mon contrat (il a signé l’été dernier pour deux saisons, ndlr). Je ne me sentirai jamais aussi adapté ici qu’en France.
Et le niveau du championnat turc, tu le juges comment par rapport à la Ligue 1 ?
On m’a demandé plusieurs fois de comparer les championnats français et argentin, et c’est très difficile parce que ce sont des footballs très différents. C’est la même chose avec la Turquie. Il y a trois grandes équipes, Galatasaray, Fenerbahçe et Beşiktaş, beaucoup plus puissantes que les autres économiquement. Pour que tu te fasses une idée de l’hégémonie des clubs d’Istanbul, Trabzonspor et nous sommes les deux seules autres équipes du pays à avoir été championnes dans l’histoire du football turc. Cette saison, Galatasaray a sorti la Juve en Ligue des champions, mais ici, ils galèrent quand ils jouent à l’extérieur. D’ailleurs, ils ont 10 points de retard sur le Fenerbahçe. Le footballeur turc est généralement physique, certains sont doués techniquement, mais il leur manque beaucoup de concepts tactiques. Et il ne peut pas y avoir plus de six joueurs étrangers par équipe sur la feuille de match. Selon moi, la Ligue 1 est une marche au-dessus de la Super Lig.
Il paraît que si tu n’étais pas devenu footballeur, tu serais devenu comptable, comme ton père.
L’accord avec ma famille pour pouvoir jouer au foot était de terminer le lycée et de continuer mes études, au cas où je ne perçais pas. J’ai fait un an et demi à la fac de sciences économiques, puis j’ai débuté en première division avec Banfield. J’ai même continué à aller à la fac pendant six mois, mais c’était trop compliqué au niveau des horaires. Je n’avais plus le temps ni l’envie. Grâce à Dieu, je suis devenu pro et je n’ai pas eu à travailler toute ma vie dans un bureau.
Beaucoup de joueurs formés à Banfield ont percé. Vous êtes encore en contact entre vous ?
Oui, il y avait bien sûr Dario Cvitanich, un ami proche, et je reste en contact avec Rodrigo Palacio, avec El Flaco Bilos, qui a joué une saison à Saint-Étienne, Gabriel Paletta de Parme, Cristian Leiva passé par la Belgique. Avec beaucoup de joueurs avec lesquels je jouais là-bas et avec lesquels j’ai passé de très bons moments.
Petit, tu étais fan de River Plate.
Et je le suis toujours. J’allais au Monumental quand je pouvais. J’étais au stade avec mon père le jour du retour en première division. Aujourd’hui, j’y vais plus pour le spectacle que pour voir du beau football, parce que le niveau du foot argentin a beaucoup baissé par rapport à mon enfance. Petit, j’étais vraiment fan. J’étais aussi au stade quand le River de Francescoli, Crespo, Ortega et Sorín, a gagné la Libertadores en 1996 contre l’América Cali. La différence de niveau avec aujourd’hui est énorme. À cette époque, je suivais les joueurs. Mais le football, c’est aussi les supporters, les tribunes, le spectacle.
As-tu vraiment refusé des offres de Boca parce que tu étais supporter de River ?
Pas des offres concrètes, mais ils m’ont fait part de leur intérêt deux ou trois fois, et quand mon agent m’a dit ça, je lui ai dit d’arrêter là les négociations parce que moi je ne jouerai jamais pour Boca.
Et avec l’OM, comment ça s’est passé ?
C’est Salvador Gimenez, le superviseur du club en Amérique du Sud, encore en poste aujourd’hui, qui est venu me voir à Banfield. Tout a été très rapide. Cela a été réglé en dix jours. Pour l’OM, je n’étais pas très cher, c’était un prêt de six mois avec option d’achat. Et heureusement, en juillet 2006, ils ont levé l’option.
Tu savais quoi de l’OM avant d’y aller ?
Rien du tout. Aujourd’hui, on parle plus de la Ligue 1 en Argentine et dans le reste du monde, mais il y a dix ans, on ne voyait rien. Je connaissais juste Monaco parce qu’il y avait Gallardo et Ibarra, mais à part eux, il n’y a pas eu de grands joueurs argentins en France.
Pourtant, deux grandes idoles de River ont joué à l’OM : El Beto Alonso et Enzo Francescoli…
El Beto était le joueur préféré de mon père. Un jour, on s’est croisés sur une chaîne de télé argentine et je l’ai invité à un asado chez moi. Il est venu et on a parlé de tout ça, mais à l’OM, il n’est resté qu’une saison, au cours de laquelle il s’est beaucoup blessé. Enzo, oui, il a laissé une très bonne image à Marseille. Il y a encore une photo de lui dans le couloir du Vélodrome, qui date de la grande époque avec Waddle et tous les autres phénomènes.
Pour ton premier match avec l’OM, face à Metz, tu es élu homme du match par les supporters.
Un match nul, un partout. C’est anecdotique, quand un joueur nouveau arrive, il y a une attention particulière sur sa personne. Franchement, j’ai de très bons souvenirs de l’OM, et je crois que les supporters ont de bons souvenirs de moi. La même chose avec Nice. Je n’ai jamais joué pour les supporters, je n’embrassais pas l’écusson, je n’étais pas démago. Mais laisser une bonne image est quelque chose de très sympa, d’agréable. L’OM est le club qui m’a donné l’opportunité d’aller en Europe. Je dis toujours que si j’avais dû aller en Roumanie pour rejoindre ce continent, j’y serais allé sans hésiter. Je ne savais pas du tout au moment de ma signature que j’arrivais dans le plus grand club de France. Au début, quand je ne comprenais rien à la langue, je ne m’en rendais pas vraiment compte. Mais après, lors de ma dernière saison à Marseille et pendant mes années niçoises, jai pleinement réalisé ce que l’OM représentait en France. Ses supporters, son histoire, c’est bien plus fort que Paris ou n’importe quel autre club.
Paris, tu l’as croisé en finale de Coupe de France. C’est ton plus mauvais souvenir marseillais ?
Non… Enfin si, parce qu’on a perdu cette finale, mais c’était quand même beau d’être là. C’était un match fermé, Dhorasoo nous sort ce but de 35 mètres… C’est le football.
Au Vélodrome, tu plantes un doublé contre Lille dans un match très bizarre.
Oui, on venait de perdre contre Lyon, on était très critiqués mais le stade était plein. Il y a un pénalty-carton rouge rapidement sur Pagis, alors qu’il n’y a pas faute. Un autre dans la foulée pour Lille, avec les fumigènes, on ne voyait rien. Et après, je marque deux fois sur corner. Répondre de cette façon, c’était beau.
À Nice, tu as trouvé plus de régularité.
Oui, j’ai joué deux ans et demi de suite. Ma dernière année à l’OM, quand on perd le championnat contre Bordeaux, avait été bonne aussi. En début de saison, je m’étais fait opérer d’une pubalgie mais après j’avais fini comme titulaire. À Nice, j’étais plus expérimenté, plus adapté à la Ligue 1. Mais les deux premières années étaient difficiles. On jouait le maintien, c’était chaud. Mais l’année dernière, oui, c’était génial.
Nice peut te dire merci pour avoir ramené Cvitanich, non ?
Actuellement, il n’est pas en grande forme. Mais l’année dernière, il a été excellent, sans lui, on n’aurait pas terminé 4e. Là, il est dans un moment plus délicat, mais c’est aussi parce que l’équipe joue moins au football et parce qu’il reçoit moins de ballons.
Et ce bisou que tu as fait à Ibrahimović ?
Les caméras l’ont vu et on en a beaucoup parlé, mais c’est le genre de geste qui se produit systématiquement. Des anecdotes comme ça, je pourrais t’en raconter dix, mais je ne vais pas le faire (rire). Personne ne peut contester Ibrahimović comme joueur, mais ce n’est pas seulement ça, c’est aussi un personnage. Il est très charismatique, moi, il me plaît bien.
Dernière question, tu n’as jamais eu de contact avec la sélection ?
Il y a eu quelque chose à un moment, je ne sais même plus si c’était avec Batista ou Sabella. Je sais qu’un des deux m’avait suivi, mais comme il devait suivre dix joueurs par poste, tu vois ? Mais sinon, non, je n’ai jamais reçu d’appel. Rien. C’est quelque chose qui m’aurait beaucoup plu évidemment. Peut-être que si j’avais connu un sélectionneur, si je l’avais eu à un moment donné dans un club comme les joueurs d’Estudiantes avec Sabella, ça aurait été envisageable. Mais ça n’a jamais été le cas.
Le Barça et le Real reculent sur l’interdiction du port de maillots adverses