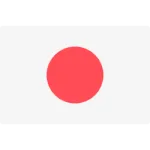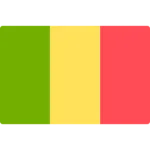- France
- Bordeaux
Cheick Diabaté : « Je ne me considère pas comme un buteur, mais comme un guerrier »

En octobre 2013, alors qu'il faisait la joie des Girondins de Bordeaux, Cheick Diabaté nous accordait un long entretien, malheureusement jamais publié en intégralité. Sa 806e place dans notre top 1000 des joueurs de Ligue 1 est donc l'occasion de dévoiler ce document exceptionnel, dans lequel le grand Cheick se livre comme jamais.
Comment s’est passée votre enfance à Bamako ?J’ai grandi dans une grande famille, au sein de laquelle j’étais l’avant-dernier d’une fratrie composée de neuf frères et sœurs. Dans mon quartier, il était possible de sortir, de jouer au foot dans la rue. Le foot, j’ai toujours aimé ça, même si petit, je ne me doutais pas que je deviendrais professionnel. Lorsque je voyais des joueurs à la télé, je trouvais ça incroyable, je me demandais : « Comment ils font pour être là ? » Dans ma famille, comme nous sommes tous grands, les autres jouaient au basket. Moi-même, il m’arrivait d’accompagner ma grande sœur, Fatoumata, à son entraînement de basket. Je commençais à jouer avec elle et, immanquablement, je me mettais à jouer au foot au bout de quelques minutes.
Comment cela se passait à la maison ?Très bien. Ce n’était pas une famille pauvre, à l’échelle africaine. Dieu merci, mon père avait de l’argent, et nous étions gâtés à la maison. Quant à moi, vu que j’ai le prénom de mon grand-père maternel, ma mère me faisait plein de cadeaux et on ne pouvait pas me frapper, ni m’insulter à la maison. Grâce à ça, j’ai eu une enfance très heureuse. Mes frères me disaient souvent : « Tu penses que tu vas rester à côté de maman toute ta vie ? » Et c’est vrai que j’étais tout le temps avec elle, jusqu’à ce qu’elle décède en 1998. Ensuite, j’ai été élevé par ma tante, que je considère comme une deuxième mère.
Votre père faisait quoi pour bien gagner sa vie ?Il était transporteur, il voyageait beaucoup entre le Mali et la Guinée. En revanche, je suis incapable de vous dire ce qu’il transportait. Ou alors, je serais obligé de vous mentir. J’étais très jeune, je ne faisais pas trop attention à ça.
Au Mali, vous parliez quelle langue ?Le bambara. C’est l’équivalent du malinké pour les Guinéens, et du dioula pour les Ivoiriens. Les Burkinabés le parlent également.
Vous avez appris le français en arrivant en France ?Oui. Tous mes frères et sœurs l’ont appris à l’école, sauf moi. Parce qu’à cause mon grand-père maternel, qui était à fond dans l’islam, je suis allé dans une école coranique et j’ai appris l’arabe. Le Mali est un pays musulman, donc mes parents voulaient avoir au moins un enfant qui apprenne le Coran, comment on fait la prière et tout ça. Du coup, au Mali, je ne parlais pas français. Et bizarrement, je suis le seul de la famille qui est parti travailler en France. Donc lors de ma première année en France, j’avais du mal à m’exprimer. J’étais timide, renfermé.
Vous avez commencé au football à quel âge ?Mes parents me racontaient que quand j’étais bébé, je tapais dans tous les ballons qui traînaient. Et au Mali, on fait du sport après la sortie des classes. Soit du basket, soit du foot. Dans la rue, c’était facile pour moi de jouer. Et j’avais la chance d’avoir le terrain d’entraînement du Stade malien à côté de la maison. J’allais souvent les voir s’entraîner, et cela m’a encore plus fait aimer le foot.
Comment avez-vous atterri au Centre Salif Keita, votre premier club ?Alors que je jouais dans la rue, mes grands frères jouaient sur un grand terrain avec un entraîneur que l’on appelait Gilles. Il organisait des séances d’entraînement pour le plaisir, il n’y avait pas besoin de licence, ce n’était pas officiel. C’était juste quelqu’un qui aimait le foot. Parfois, je les accompagnais, mais j’étais trop jeune pour jouer avec eux. Je les regardais. Un de mes grand frères, lui, faisait tout pour que j’intègre l’équipe, jusqu’à ce que je participe à quelques matchs. On jouait le samedi et le dimanche, il n’y avait pas d’entraînements en semaine. C’est là que j’ai appris le hors-jeu, je ne savais pas que cela existait. La première fois que j’ai joué sur un grand terrain, je n’avais pas de poste. Le terrain était trop vaste, je ne savais pas me situer. En revanche, dans la rue, comme je n’avais pas de force pour défendre, on me mettait devant. Donc ensuite, Gilles m’a fait jouer en attaque, et j’ai marqué quelques buts. En parallèle, des gens répétaient souvent à mon grand frère Djamou que son petit frère était bon au foot. Alors que moi, je ne me suis jamais considéré comme le meilleur. Je m’amusais. Dans la rue, pour faire les équipes, on prend deux personnes qui choisissent un joueur à tour de rôle. Moi, j’étais toujours choisi en premier. Mais je ne me suis jamais considéré comme le plus fort de l’équipe. Et aujourd’hui, c’est encore le cas. Je me mets toujours au milieu. Je me dis que je ne suis ni le plus mauvais, ni le plus fort. Mais sur le terrain, j’ai une force, c’est mon caractère. Je me bats. On me considère comme un buteur, mais moi, je ne me considère pas comme un buteur. Je me considère comme un guerrier. Bref, un jour où je regardais Djamou jouer, il m’a proposé d’entrer en jeu. Et comme c’était des joueurs moyens, qui ne couraient pas vite, je dribblais, je faisais des passes à mon frère, et il marquait. De retour à la maison, Djamou a dit : « J’ai vu jouer Cheick, il est très, très fort ! » Là, toute ma famille m’a dit d’aller au Centre Salif Keita, qui était le meilleur centre du Mali. Et moi, je ne voulais pas y aller. Je savais qu’ils avaient beaucoup de joueurs et j’avais peur de ne pas jouer. Je préférais rester jouer dans la rue pour m’amuser. Mais ils m’ont persuadé et j’y suis allé un dimanche, sans connaître personne. On m’a mis dans une équipe et on a fait un match entre nous.
J’ai mis trois buts, on a gagné 4-3. Mais le week-end d’après, je n’y suis pas retourné, je suis resté jouer dans la rue, parce que l’entraîneur, Idrissa, m’avait fait peur. C’était un homme impressionnant, qui criait beaucoup avec sa grosse voix. Quand je suis rentré à la maison après avoir joué dans la rue, on m’a dit qu’il était venu chez nous. J’ai eu encore plus peur, surtout qu’il habitait dans mon quartier. Un jour, je traînais dehors avec des amis et je le vois qui m’appelle. « Pourquoi t’es pas venu t’entraîner ? », il m’a demandé. Terrorisé, je n’ai pas répondu. « Je veux te voir le week-end prochain à l’entraînement », il a ajouté. J’y suis allé, et ça a commencé comme ça.
![]()
C’est là que Bordeaux te repère ?Non. À 15 ans, en 2003, je suis allé faire un tournoi minime à Nice. C’était la première fois que je venais en France, on est resté deux semaines. Le tournoi s’est bien passé, j’ai fini meilleur buteur avec 4 buts, mais mes parents me manquaient énormément. Cela a été très, très dur pour moi. C’est pour cela que quand j’ai appris plus tard que je devais venir en France, j’ai eu très peur parce que je savais que ce serait difficile d’être séparé de ma famille. Avant de venir en France, j’ai participé en 2005 à la Coupe d’Afrique des cadets en Gambie. Après cette compétition, beaucoup de gens sont venus voir mes parents pour leur dire qu’ils pouvaient me trouver un club. Parmi eux, il y avait un monsieur qui voulait m’emmener en Allemagne, un autre à Auxerre, un à Lille… Moi, ça me faisait peur. Je ne voulais pas partir du Mali. Le monsieur qui voulait m’emmener à Auxerre essayait de me convaincre en me disant : « Cheick, tout est ok, tu vas partir. » Mais quand je le voyais, je me cachais. Ensuite, j’ai connu mon agent, Seran Diabaté. C’est la famille, il vit à Paris, donc j’avais moins peur. Il m’a dit : « Tu vas voir, tu vas venir en France, tu vas faire un essai, tu vas avoir ton appartement, ta voiture… » Je ne le croyais pas, je pensais que c’était n’importe quoi.
Là, je suis parti faire un essai à Lille pendant deux semaines. J’avais 17 ans. C’était très dur, je ne parlais pas la langue, j’étais à l’hôtel… Au premier repas, on m’a servi des pâtes avec de la viande saignante. Je n’avais jamais vu ça. À cause du sang, je n’ai pas pu manger la viande. Tous les jours, on me demandait ce que je voulais manger, mais je ne savais pas le dire. Donc on me donnait tout le temps cette viande que je n’arrivais pas à manger. J’ai pleuré pendant trois jours, et Seran est venu me voir. Je lui ai dit que je voulais rentrer, il m’a dit de persévérer, que j’allais m’habituer. Pour moi, c’était impossible. Je regardais les gens, et je me disais : « Comment ils font pour vivre ici ? Pourquoi ils ne vont pas au Mali, le meilleur pays au monde ? » Je me sentais seul au monde. Au bout d’une semaine, je suis parti à Paris sans savoir s’ils allaient me prendre. Seran m’a dit qu’après Lille, il fallait aller à Bordeaux. Moi, je ne connaissais pas Bordeaux. Je lui ai dit : « Non, c’est bon, je rentre au Mali. Je reviendrai plus tard. » Il m’a répondu qu’il fallait vraiment aller à Bordeaux, que je rentrerais au Mali après. J’ai accepté à la condition que je puisse appeler mes parents tout le temps. J’appelais aussi ma sœur Fatoumata, qui était partie aux États-Unis pour jouer au basket. Au téléphone, je lui disais que je ne pouvais pas rester là, que je devais rentrer. Elle m’a expliqué : « C’était pareil pour moi au début. Tu vas voir, tu vas t’habituer et tu vas même aimer la France. » Je lui ai dit que je ne parlais pas la langue et que j’étais tout seul. Elle m’a dit : « Non, tu n’es pas tout seul, il y a des gens à côté de toi. Va à Bordeaux, et si tu dois rentrer au Mali, je te le dirai. » Donc j’ai accepté d’aller à Bordeaux. Et là, j’ai vu une différence énorme avec Lille. Je n’étais pas à l’hôtel, j’étais au centre de formation, donc je me suis fait des amis et j’ai aimé Bordeaux.
À Bordeaux, votre adaptation s’est faite sans embûches ?Non, parce que j’y ai aussi découvert le froid ! Et par exemple, quand on me parlait, je ne regardais pas. Parce que chez nous, c’est une question de respect. On ne regarde pas les gens dans les yeux. Ça, Patrick Battiston, mon entraîneur, ne le comprenait pas. J’aime bien en parler, parce que je ne veux pas que les Africains soient accusés de manquer de respect. Chez nous, l’éducation est stricte : on ne fixe pas quelqu’un de plus âgé.
Sur le terrain aussi, vos débuts ont été compliqués. Qu’est-ce qui vous a fait tenir le coup ?Lors de cette première saison difficile, je ne jouais pas, mais cela m’a aidé à devenir quelqu’un de très, très costaud mentalement. Cette adaptation compliquée fait que maintenant, à chaque moment difficile, je me dis que ça va aller. Au début de la deuxième saison, je ne jouais toujours pas. Et là, certains joueurs m’ont dit : « Cheick, tu ne joues pas, tu ne signeras pas pro, pourquoi tu ne vas pas ailleurs ? » À ce moment-là, j’ai beaucoup pleuré. Je me disais que si je ne signais pas ici, j’étais perdu. Cela me faisait de la peine pour mes parents, qui pensaient que j’étais bon, alors que je ne l’étais pas tant que ça si je ne signais pas. Je me sentais inutile. Je me regardais dans le miroir et je me disais : « Cheick, tu dois signer pro ! Si tu ne signes pas, t’es un lâche ! » J’ai donc appelé mon agent pour lui dire que je n’allais pas signer à Bordeaux, qu’il fallait trouver un autre club. C’est le seul moment où j’ai totalement perdu confiance. Je n’arrivais même pas à contrôler un ballon, parce que je me disais que cela ne servait à rien. Battiston a accepté de me laisser partir, comme il ne me faisait pas jouer, et je suis allé au Havre. Mais au bout de quelques mois, Battiston m’a appelé pour que je revienne. Je lui ai répondu que non, je restais au Havre. Il m’a dit que j’avais un contrat avec Bordeaux. Alors que pour moi, Bordeaux, c’était fini. Quand j’y suis retourné, l’attaquant de la CFA était blessé, et Battiston m’a mis dans le groupe à la surprise générale. On est partis jouer contre une équipe genre Sanguinet ou quelque chose comme ça. Je suis titulaire, je mets un triplé. À notre retour au centre, j’entendais les gens dire : « Cheick il a mis un triplé ! » Les gens venaient me demander, tellement c’était fou. « Cheick, il ne joue jamais et il a mis un triplé ? » Le match d’après, on joue contre le PSG. On gagne 2-0, je mets un doublé. À partir de là, j’ai marqué lors de tous les matchs que j’ai joués. Je me souviens d’une fois où Jean-Louis Triaud et Laurent Blanc sont venus nous voir jouer. J’avais inscrit un quadruplé. Le lendemain, je lis dans les journaux que je vais signer pro. À partir de là, c’était parti.
![]()
Vous signez à Bordeaux, mais c’est à Ajaccio que vous faites vos débuts en pro…Un jour, Battiston m’a dit que Gernot Rohr, qui venait souvent nous voir jouer, voulait que je joue pour lui à Ajaccio. Moi, je ne connaissais pas la Corse, ça me faisait peur. Donc j’ai fini la saison à Bordeaux, je suis parti en vacances au Mali, et à mon retour, c’est directement Gernot Rohr qui m’a récupéré à l’aéroport pour m’emmener à Ajaccio où j’ai été prêté un an. Là-bas, c’était incroyable. J’ai été mis dans des conditions exceptionnelles. Les gens disaient que Gernot Rohr était mon père. Il m’a trouvé une voiture, m’a montré le restaurant dans lequel je devais manger, m’a présenté à ses amis… Donc je me suis très bien adapté et j’ai fait une bonne saison grâce à lui.
Et les supporters vous surnomment « le Jan Koller d’ébène » …On m’a toujours comparé à des joueurs comme Jan Koller ou Adebayor. Tous les attaquants grands, en fait. Au Mali, on m’appelait Nwanko Kanu. Et la personne qui m’a trouvé ce surnom, moi aussi je l’appelais Kanu en retour. À tel point qu’aujourd’hui encore, tout le monde l’appelle Kanu. Alors que moi, j’ai gardé mon nom : Cheick Diabaté !
Depuis tes débuts professionnels, tu as amélioré quelques aspects de ton jeu, comme le jeu de tête…Je pense que mon jeu de tête a toujours été meilleur que le vôtre…
Vous comprenez les gens qui se moquent de vous ?J’accepte les critiques, si elles sont liées au football. Si cela dépasse le cadre du foot, il m’arrive de m’énerver, de dire des choses… Dans cet état-là, je n’arrive pas à me contrôler. Il est difficile de satisfaire tout le monde. Certains pensent que Cristiano Ronaldo est plus fort que Messi, d’autres l’inverse. C’est comme ça, on n’y peut rien. Le mec qui a chanté sur moi (Julien Cazarre, NDLR), je ne savais même pas qu’il me connaissait. Je fais ma vie tranquillement, je roule dans ma petite voiture… Mais si ce gars-là me connaît, cela veut dire que je ne suis plus n’importe qui. Il ne va pas clasher quelqu’un qui ne sert à rien. Cheick a pris une dimension sans le savoir. Le reste, je m’en fous. Je reste Cheick Diabaté, qui aime le foot et qui prend du plaisir.
Dorgeles Nene : « Avant, je voulais être pilote d’avion »Propos recueillis par Mathias Edwards, au Haillan