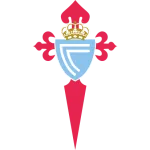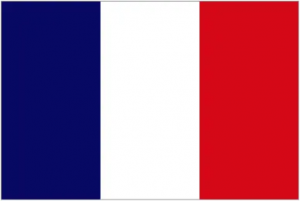- France
- Disparition de Bernard Tapie
Bernard Tapie est encore mort

Personnage hugolien, comme réchappé d'un roman du XIXe siècle, l'ancien président de l'Olympique de Marseille aura connu un destin surnaturel. Sa fureur de vivre, héritée pour partie de son enfance à la Dickens dans le Bourget des années 1950, l'aura conduit à toutes les expériences : vendeur de télés, chanteur yéyé, pilote de F3, repreneur d'entreprises en perdition, patron d'une équipe cycliste, député puis ministre, taulier d'Adidas, comédien, et tant de choses encore. Annoncé à de multiples reprises fini, ruiné, à la rue, insolvable, il s'est toujours relevé jusqu'à ce dimanche matin, vaincu par un cancer métastasé. Bernard Tapie est mort ; pour de bon cette fois.
Tout le monde a oublié ou presque. Dans les travées du Stade de France, le 12 juillet 1998, sur le coup de 23h30, Didier Deschamps arrive au micro de TF1. Les premiers mots du capitaine des Bleus, tout nouveaux champions du monde, sont pour… Bernard Tapie. « On lui doit beaucoup ; à l’OM, on a acquis une mentalité de gagnants. On a touché du doigt ce qu’était la réalité du football de haut niveau », affirme-t-il quand on lui demande ce qui a changé dans le football français. À l’époque, l’ancien président du club phocéen est un paria. Moins d’un an plus tôt, il en a terminé avec sa peine de prison à la suite de sa condamnation dans l’affaire VA-OM pour « corruption et subornation de témoin » . 165 jours d’incarcération à la Santé, puis à Luynes et aux Baumettes de février à juillet 1997. Son entrée dans la maison d’arrêt parisienne a même été retransmise en direct dans les journaux télévisés de 20 heures. Deschamps, Desailly, Barthez et Boghossian savent que le « boss » ne joue pas pour être deuxième. Fin 1983, il avait relancé Bernard Hinault, blessé à un genou et pas sûr de retrouver son niveau, comme on joue au bonneteau. Il avait alors adossé la Vie Claire, une de ses boîtes portées sur le bio, à cette nouvelle aventure cycliste. Deuxième du Tour, le Blaireau avait resurgi des limbes en fin de saison en raflant le Grand Prix des nations et la Lombardie. Pour pimenter le game, il pique Greg Lemond à Renault l’année d’après et offre des salaires princiers. L’Américain gagne un million de dollars sur trois ans, le double d’Hinault. « En plus, je devais toucher un dollar par paire de pédales Look (une autre entreprise de la holding Tapie), je n’ai jamais rien touché. J’ai eu mon salaire et rien d’autre. Bon, je n’avais pas quitté Guimard pour l’argent », dira plus tard le double champion du monde, sans qu’on soit obligé de le croire. En 1985, Hinault gagne le Tour de France, imité l’année suivante par Lemond. Dans les deux cas, le gars du Bourget (Seine-Saint-Denis style) se montre ambivalent, retors, promettant tout et son contraire à ses deux champions, sorte de Gepetto des ténèbres qui agite ses marionnettes. L’arrivée collégiale des deux coureurs main dans la main à l’Alpe-d’Huez le 21 juillet 1986, mascarade dont personne n’est dupe, marquera à sa façon la fin de l’aventure du futur patron d’Adidas dans le vélo. L’année suivante, Hinault part à la retraite, Lemond est victime d’un accident de chasse et Jean-François Bernard, le successeur putatif du premier, finit troisième du Tour, mais Tapie s’en fout. Il est déjà ailleurs.
Au printemps 1987, il a aidé Francis Bouygues, avec qui il a racheté Wonder quelques années plus tôt, à séduire les membres de la Haute Autorité lors de la privatisation de TF1, au détriment du grand favori, Jean-Luc Lagardère. Le groupe de BTP lâche un chèque de trois milliards, et le principal ordonnateur du grand oral devant un jury enamouré a bien entendu préempté un bon paquet d’actions. Il pourra s’y inviter à sa convenance pour dérouler son storytelling les années suivantes. Surtout, il a changé de sport. L’année précédente, il s’est porté acquéreur de l’OM, un chef-d’œuvre en péril qui n’attend qu’un tycoon d’envergure pour vrombir de nouveau. Il réussira là où Lagardère a échoué avec le Matra Racing. Le Tapie de l’époque est comme touché par la grâce. À peine arrivé, en avril 1986, le club phocéen parvient en finale de la Coupe de France, contre Bordeaux, sans qu’il y soit pour grand-chose. « Disons qu’on passe tout de suite dans une autre dimension avec lui, rapportera dépité José Anigo, un des minots de l’époque, quelques années plus tard. Avec ses qualités et ses défauts, même si ce n’est pas quelqu’un que j’apprécie, il a été un vrai détonateur pour l’OM. Il a fait grandir le club à un moment où il venait de plonger. Je ne pense pas que ce soit quelqu’un qui aime le club ou la ville. C’est un politique, qui s’est servi de l’OM comme tremplin pour autre chose. Ce genre d’homme a plusieurs coups d’avance. Il sait que c’est la plus belle gonzesse de la terre, l’OM, que tout le monde va la regarder, va venir la voir. Je ne pense pas que Tapie soit un passionné, même s’il aime le sport. Il a sans doute appris à connaître et apprécier Marseille, mais bon… »

À l’origine, il y a Mikhaïl Gorbatchev
Comme souvent avec lui, ce n’est pas Tapie qui est allé chercher l’OM, mais l’institution des Bouches-du-Rhône qui est venue à lui en quelque sorte. En décembre 1985, il se rend à un dîner à l’ambassade d’URSS, donné en l’honneur de Mikhaïl Gorbatchev (qu’est-ce qu’il foutait là ?). Il y rencontre l’écrivaine Edmonde Charles-Roux, qui est également l’épouse de Gaston Defferre, le maire de Marseille. L’auteure d’Oublier Palerme, résistante à la vingtaine, à qui l’on prête des liaisons avec Orson Welles ou Mouammar Kadhafi, sait renifler les grands fauves de loin. Elle propose illico à l’homme d’affaires médiatique de venir au chevet du club méditerranéen. Deux mois plus tard, l’affaire est emballée. Bernard Tapie, flanqué de Michel Hidalgo pour la caution football, signe un accord de collaboration de cinq ans avec Jean Carrieu, le président d’alors. Ce dernier pense qu’il dirigera encore le club. C’est méconnaître le Parisien de naissance. Tapie a bâti sa fortune en rachetant au franc symbolique des manufactures qui allaient disparaître (Testut, Terraillon, Wonder, La Vie claire, Donnay…) en en coupant les branches mortes et en les restructurant avec une méthode aussi implacable qu’efficace, sans oublier de faire une plus-value en conséquence. Bernard Arnault et François Pinault, deux des hommes les plus riches du pays aujourd’hui, développeront la méthode au centuple.
Le 12 avril 1986, bien qu’épaulé par Jean-Claude Gaudin, président de la région, Jean Carrieu cède devant la pression du maire de la ville et de son protégé. Bien renseigné en amont par « des amis de l’intérieur » , Jean-Pierre Bernès, directeur administratif du club, et Jean-Louis Levreau, directeur des sports du quotidien Le Provençal et futur numéro deux de l’OM, le président du club olympien peut se lancer dans ce qu’il sait faire le mieux. Tapie fait du Tapie. Il vire, transfère, démantèle, réajuste, engage à prix d’or, et force est de reconnaître qu’il a un flair bluffant. Il tente des coups sur des joueurs pas encore confirmés en Europe (Papin, Pelé, Barthez, Desailly), parie sur de jeunes internationaux (Cantona, Sauzée, Deschamps, Bokšić), spécule sur de glorieux anciens en quête de rachat (Giresse, Tigana, Amoros, Völler) et assure, en vieux loup de mer, avec des valeurs sûres (Mozer, Francescoli, Allofs, Förster, Stojković). La légende prétend même qu’il a demandé à Glenn Hoddle, le meneur de jeu de l’AS Monaco : « Quel est le meilleur joueur du championnat d’Angleterre ? » L’été suivant, Chris Waddle enflamme les bords de la Méditerranée. Peu importe s’il faut le créditer de ces recrutements, la tifoserialocale lui en attribue tous les mérites. Les fans marseillais se remettent à rêver. Le gars du Bourget leur concède en retour la gestion d’une partie des virages, manière subtile d’acheter la paix sociale. Outre le scouting, il met la pression sur ses joueurs, titille l’orgueil des siens et manage les ego comme un chef de meute, comme il l’a appris dans ses entreprises et auprès de Hinault et Lemond. Ses entraîneurs sont eux soumis à un tir de barrage permanent à tout propos. Gérard Banide sera viré au bout de la deuxième journée de sa troisième saison. Bien que double champion de France et demi-finaliste de la C1 quelques mois plus tôt, Gérard Gili sera évincé comme un malpropre en septembre 1990, remplacé par Franz Beckenbauer, recruté comme directeur technique, un mois après avoir remporté le titre mondial en tant que sélectionneur de la Mannschaft. Le Kaiser ne tiendra que trois mois, démissionné ou démissionnaire, selon les sources, lui-même suppléé par Raymond Goethals. Avec le Belge, l’OM rentre dans la période la plus fastueuse de son histoire.

Le jardin de la belle-mère de Christophe Robert
L’ancien cornac du Standard de Liège et d’Anderlecht aura lui aussi déploré l’omniprésence du président olympien qui appelle à toute heure, intervient dans la compo d’équipe et à propos de la tactique, en plus de sa mainmise sur les transferts. En trois saisons à l’OM, « Raymond-la-science » n’en commencera aucune, remplaçant au gré du vent et des humeurs du patron Beckenbauer, Ivic et Jean Fernandez. À l’automne 1990, Raymond Goethals se rend à l’hôtel particulier de Bernard Tapie, rue des Saints-Pères, à Paris (6e). Quelques mois plus tôt, il a fini deuxième du championnat avec Bordeaux. « Il a commencé : « C’est toi qui m’as tant fait chier la saison dernière. Je cherche un entraîneur pour gagner la Coupe d’Europe. » J’ai souri : « Ah, oui, laquelle ? » » Il m’a répondu : « Tu me prends pour un con, toi ? » « Pas du tout, président, j’ai déjà joué cinq finales de Coupe d’Europe, quatre avec Anderlecht et une avec le Standard. » » Il répond : « Je sais, mais je veux la plus grosse avec des grandes anses » qu’il montre avec des gestes. Je ne sais pas vous programmer ça. Celui qui peut vous dire qu’il va vous gagner la Coupe des champions, c’est un comique. Parce que non seulement il faut une grande équipe, mais aussi beaucoup de chance. Pas seulement dans les matchs hein, mais aussi dans les tirages au sort… », restituera plus tard l’entraîneur belge. On connaît la suite ; trois titres nationaux (dont celui retiré de 1993 pour cause de corruption à la suite de VA-OM) et deux finales de C1 dont le sacre de Munich. Comme il n’y a jamais loin du Capitole à la roche Tarpéienne comme le prétend la sagesse romaine, Bernard Tapie et l’OM ne vont guère profiter de l’ivresse des sommets, d’être « à jamais les premiers ». Les seuls à ce jour en France. Forts du souvenir d’une partie de garçons-bouchers des Verts à Nîmes, deux semaines avant la finale de Coupe d’Europe des clubs champions à Glasgow en 1976, où les Stéphanois perdent Farison et Synaeghel sur blessure, Tapie et Bernès, son bras armé, décident de passer quelques coups de fil, histoire de « sécuriser » la rencontre contre Valenciennes. Il s’agit de quémander à deux ou trois joueurs adverses (Robert, Burruchaga, Glassmann en l’occurrence) de lever le pied, moyennant finance. La méthode est éprouvée. Les dirigeants l’ont souvent utilisée, notamment contre Monaco, le grand rival au tournant des années 1980-1990. Emmanuel Petit l’a souvent dénoncé dans le désert quand Arsène Wenger ne l’évoquait qu’en privé. À sofoot.com, en octobre dernier, l’Alsacien s’était contenté d’un : « Vous en savez autant que moi. »
Ce 19 mai 1993, veille de VA-OM, Jean-Pierre Bernès, comme un hors-la-loi trop sûr de lui, commet une erreur fatale. Il téléphone à Christophe Robert depuis son hôtel pour négocier les modalités de la remise de l’argent. Les fameux 250 000 francs retrouvés dans le jardin de la belle-mère de l’ancien Nantais. Cet appel sera le premier indice avéré autour d’un faisceau de présomptions. Autre problème, Jacques Glassmann ne mange pas de ce pain-là et le fait savoir. Il le paiera très cher. En ce soir de printemps, l’OM n’avait pas besoin de soudoyer des adversaires pour écarter Valenciennes, mais le destin est, paraît-il, plus fort que les dieux. Il était dit que ce jour-là convoquerait les fantômes du passé avec l’ironie la plus amère. Onze ans plus tôt, le Standard de Liège, coaché par Goethals, dont le capitaine s’appelle Éric Gerets (skipper de l’OM de 2007 à 2009) va « arranger » de la même façon un match de championnat de Belgique décisif contre Waterschei à quelques jours d’une finale de Coupe des coupes contre le Barça. La transaction figurera même dans les comptes du club de la Cité ardente, ce qui permettra à la gendarmerie belge, qui enquête sur autre chose, de découvrir la corruption. Mieux encore, un des hommes qui a le plus contribué à l’ascension de Tapie, qui rabattait des affaires pour la reprise de sociétés exsangues auprès des tribunaux de commerce, qui prenait la lumière à ses côtés lors de reportages télévisés s’appelle Jean-Louis Borloo. Il a été le président du club local de 1986 à 1991. Il est désormais le maire de Valenciennes. Le futur ministre de Chirac et Sarkozy assiste au match à Nungesser et marche sur des œufs.

Les arrangements d’arrière-boutique politicards
En fin politique, Noël Le Graët, le président de la Ligue de l’époque, comprend bien vite tout le parti qu’il peut tirer de la situation. Depuis son arrivée à l’OM, le « sévèrement burné » envoie paître tous les institutionnels de la balle ronde hexagonale (Darmon, l’argentier du foot français, Fournet-Fayard, le président de la FFF d’alors ou Georges Sadoul, l’ancien président de la Ligue). « J’ai toujours su que ça finirait comme ça et je n’ai donc pas été étonné quand les ennuis sont tombés sur moi. Je les avais un peu cherchés, pas vrai ? Surtout, parce que je n’ai jamais fait d’efforts. Dans les affaires, le foot ou la politique, je me suis presque toujours refusé à fréquenter les milieux dans lesquels je travaillais, ça me gonflait. J’ai quand même eu une belle vie, hein ? », livrait-il au crépuscule de sa vie dans une hagiographie faussement iconoclaste de Franz-Olivier Giesbert, intitulée Bernard Tapie, leçons de vie, de mort et d’amour (sic), parue en juin dernier. En vrai, le VRP multicartes de sa propre personne ne s’épanouit que dans le conflit, le rapport de forces comme s’il n’excellait que dans la perspective de pourfendre quelque moulin à vent. Le retour de kick sera à la hauteur. Marseille est privée de Supercoupe d’Europe et d’Intercontinentale en tant que vainqueur de la Champions, Monaco joue à sa place l’épreuve phare du continent, avant d’être rétrogradée deux fois, en 1994, puis l’année suivante. Ce qui vaut toujours à Le Graët une rancune tenace du côté des Bouches-du-Rhône. Bernard Tapie est au bord du gouffre, il le pressent, mais ne l’envisage pas une seconde. Il va payer de facto pour l’ensemble de son œuvre.
Dans le foot d’abord, où il a importé ses méthodes venues du monde de l’entreprise. « Quand nous sommes sur une affaire, nous n’avons plus aucune éthique. C’est une véritable chasse à mort, on est malheureusement obligé de mal se conduire », dira-t-il un jour au Monde. Les dirigeants phocéens n’ont pas attendu la main de Vata et l’élimination en demi-finales de la C1 au printemps 1990 pour influer sur les résultats. Promesses de transfert sur la Canebière (Fournier alors à Sainté), d’argent pour sous-performer (Montanier à Caen, Cabanas à Brest, Sénac à Bordeaux, les Monégasques chaque saison…) se multiplient dans la ligue domestique. Ljubomir Barin, homme à tout faire de l’OM, « s’occupe » en Europe des arbitres ou de la corruption en direct (« les joueurs de l’AEK Athènes concernés devaient entrer sur le terrain chaussettes baissées. L’arbitre les leur a fait remonter », témoignera-t-il au premier procès des comptes de l’OM en 1997). Parfois, on injecte même des anxiolytiques dans les bouteilles d’eau ou le jus d’orange des adversaires (Lech Poznań, CSKA Moscou en Europe ; Rennes en championnat). Cette fuite en avant, qui s’accompagne d’une dérive financière – l’OM doit être en C1 chaque année -, ne peut finir que d’une seule manière : dans le mur. Attaché parlementaire puis factotum de l’ombre de Bernard Tapie pendant 25 ans, Marc Fratani n’en a pas perdu une miette. Lâché par l’ancien patron de Testut en 2013, il a publié il y a deux ans un livre réquisitoire, Le Mystificateur, où il dévoile, implacable, les dessous de la corruption à l’OM, les arrangements d’arrière-boutique politicards, notamment les deals et la rencontre avec Le Pen, ennemi héréditaire supposé, et les sincérités successives de l’ex-ministre de la Ville. Bien sûr, l’ouvrage fleure bon la rancœur et les règlements de compte, mais il accumule tant d’histoires et de détails qu’il en devient dérangeant. Ne jamais abandonner en rase campagne un porte-flingue qui s’est chargé de vos basses besognes. Même topo pour Bernès, un homme qui vendrait sa mère pour un statut social dans le foot d’ici, qui déclarait sous serment lors du procès VA-OM : « Tous les joueurs savaient que le match était arrangé. Demandez à Desailly ou à Deschamps. » Heureusement pour eux, ils n’étaient pas là.

Chemises pastels, Crédit lyonnais et Mitterrand
À la toute fin des années 1980, Bernard Tapie semble tout droit sorti d’un épisode de Miami Vice. Costards marron ou anthracite, chemises pastels, il arbore même parfois ces abominables liquettes bleu ciel à manches courtes avec un col blanc. Rien ne lui est alors interdit. Il s’est lancé en politique avec la bénédiction de Mitterrand, après avoir sondé la Chiraquie, son habitat naturel en dépit de ses origines modestes. Il devient député des Bouches-du-Rhône en janvier 1989, se pointe toutes couilles dehors à un meeting du Front national et malmène Le Pen dans un débat télévisé. À l’été 1990, avant de signer Kaiser Franz à l’OM, il rachète Adidas, qui pèse cent fois plus lourd que sa holding, grâce à des emprunts validés par le Crédit lyonnais, remboursable sur deux ans. La grenouille se veut plus grosse que le bœuf, là où il aurait pu imiter Arnault et Pinault et troquer sa défroque de dépeceur d’entreprises pour devenir un genre d’industriel pérenne. Ça ne l’intéresse pas. Comme Jacques Chirac, il ne vit que pour la conquête du pouvoir, l’exercer l’ennuie, sauf peut-être à l’OM ou au ministère de la Ville. Depuis avril 1986, Tapie rêve d’être le maire de Marseille. Il s’y prend comme un manche. S’embrouille vite avec Robert Vigouroux, le successeur de Defferre comme premier magistrat. Les socialistes marseillais, Michel Pezet en tête, le premier d’entre eux, le détestent en le voyant piétiner leurs plates-bandes. En retour, ils lui savonnent la planche. Jean-Claude Gaudin, qui sera élu, se méfie de lui comme d’une guigne.
À Paris, il fait pareillement l’unanimité contre lui. Sa première journée à l’Assemblée est un cauchemar absolu. Le loup est conspué dans la bergerie. On ne lui pardonne pas de ne pas être du sérail, d’avoir un rapport décomplexé à l’argent et d’être le chouchou de François Mitterrand. « Je ne m’attendais pas à rien d’autre. J’ai connu la même chose et j’ai survécu », le réconforte l’ancien président au téléphone. En mars 1992, il entre au gouvernement Bérégovoy et se voit contraint pour l’occasion de vendre Adidas. Peut-être la plus grande erreur de sa vie puisqu’il est en plus contraint de démissionner deux mois plus tard à la suite de la plainte d’un ancien associé, Georges Tranchant, qui retire sa plainte contre un pactole sonnant et trébuchant. Tapie revient au gouvernement en décembre, mais l’abîme se rapproche. La gauche va perdre lourdement les législatives en mars 1993, son groupe est au bord de la faillite, l’OM va être mis en liquidation judiciaire, et les procédures judiciaires à son encontre s’accumulent. Bientôt, ce sera le procès VA-OM. Mitterrand le sonne de nouveau aux aurores au matin du verdict : « Ne montrez rien, restez impassible. C’est la meilleure chose que vous puissiez leur faire. » Au bout de la procédure, le 3 février 1997, Bernard Tapie va découvrir ce qu’il « redoute le plus, l’incarcération ». « Un autre que lui n’aurait sans doute pas fait de prison pour des faits similaires. Il aurait pu faire de grandes choses, c’est le produit d’une époque », expliquera Eric de Montgolfier, l’impayable procureur de la République que le patron du club phocéen avait tenté d’impressionner en pure perte.

Admiré par les classes populaires et la grande bourgeoisie
Au bout du compte, son charisme, son instinct tribal, sa faconde de banlieusard, son acuité oblique de gars de la rue apte à chaque instant à sentir les coups et les affaires l’auront mené à sa perte. À sa sortie de prison, il aura fait le comédien, récupéré le « magot » du Crédit lyonnais en quelque sorte, acheté, ô ironie, La Provence et fait quelques placements savants. Il s’est également nourri jusqu’à l’ivresse de son propre storytelling, à tel point qu’il finira par croire dur comme fer à ses innombrables mensonges comme s’il avait peur de s’en retourner à sa condition originelle, celle d’un enfant de la classe ouvrière. L’homme a forcé l’admiration pour sa propension irréelle à se battre contre le cancer ou le reste du monde. Quelles que soient les époques, le Parisien du 20e, parti au Bourget à deux ans, a toujours fasciné. Des classes populaires, des banlieusards sous toutes les latitudes, dont notamment certains rappeurs, jusqu’à la grande bourgeoisie. S’est-on jamais interrogé pourquoi un fils de famille suisse, falot et anonyme jusqu’alors, héritier d’une riche famille d’industriels, les Louis-Dreyfus, a-t-il racheté Adidas, avant d’investir à l’OM, puis de le faire revenir au club en 2000 (une façon de tuer symboliquement l’idole ?). « Tapie version 2… C’était autre chose, plus le même mec, il était un peu largué, le monde du foot était allé un peu trop vite pour lui », cinglera Anigo, jamais avare d’une vacherie. Les Marseillais n’oublieront jamais qu’il leur a donné l’occasion d’être fiers d’être ce qu’ils sont. Certains se souviendront de sa gouaille et de sa façon de ne pas s’en laisser compter, qui que ce soit en face. Jean-Paul Belmondo, qui a disparu il y a un mois, a passé toute sa vie à prendre des risques insensés comme pour conjurer l’enfance qu’il n’a pas eue à cause de la guerre. Plus jeune de dix ans, Bernard Tapie a grandi dans les décombres d’un pays en ruine, au sein d’une famille ouvrière, « qui s’interdisait de voir plus haut » dans un deux-pièces de 20m² sans salle de bains. On n’échappe jamais tout à fait à son enfance.

Par Rico Rizzitelli