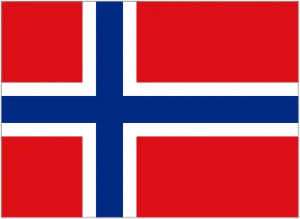- France
- Red Star
- Interview Rui Almeida
« Beaucoup de ceux que j’ai connus en Syrie sont désormais exilés… »

Deuxième partie de l'entretien de l'entraîneur du Red Star. Rui Almeida parle da la caste des entraîneurs portugais, de la Syrie, la Chine ou encore de sa vie parisienne.
En dehors de José Mourinho, quels sont les meilleurs entraîneurs portugais du moment sur la base du rapport résultats/qualité de jeu ?Je distingue trois générations de coachs au Portugal. Je suis obligé d’évoquer le professeur Jesualdo Ferreira pour son travail à Porto, Benfica et tous les autres clubs par lesquels il est passé et avec lesquels il a gagné des titres. Avec lui, tu as Manuel José (Al-Ahly) et évidemment Jorge Jesus. À l’opposé, tu as la jeune génération, celle d’André Villas-Boas, de Paulo Fonseca, de Marco Silva, qui a remporté la Coupe du Portugal avec le Sporting et qui fait du très bon travail en Grèce, il y a aussi Vítor Pereira (Fenerbahçe). On peut aller loin… Il y a une succession de bonnes générations d’entraîneurs au Portugal, et entre ces deux grandes générations, il y a José Mourinho qui est, à mon sens, un cran au-dessus de tout ce beau monde. En tout, il doit y avoir 16 ou 18 excellents entraîneurs portugais aujourd’hui, et si vous remarquez bien, aucun d’entre eux n’a été un grand joueur auparavant, et la majorité d’entre eux ont au moins une licence en poche.
C’est important, car cela veut dire que le football peut s’apprendre.Il y a quelques jours, je lisais une interview de votre Zidane dans laquelle il expliquait qu’il ne se servirait que très peu de ce qu’il a appris en tant que joueur pendant sa carrière d’entraîneur. Vous imaginez, un joueur comme Zidane, qui a atteint un niveau de jeu extrêmement élevé, se remet en cause et dit que ce qu’il a appris sur le terrain ne lui servira plus à rien. C’est révélateur. C’est la preuve que l’on peut toujours apprendre. Que ce soit sur le plan technico-tactique, ou sur celui de la communication, il y a toujours moyen d’évoluer. Surtout que le football ne cesse d’évoluer. Entre deux Euros, seuls quatre ans s’écoulent, mais c’est suffisant pour que des choses, des ajustements, aussi infimes soient-ils, soient opérés sur le jeu. Même d’une Ligue des champions à l’autre, les choses changent.
En France, un individu lambda qui n’a jamais évolué au niveau professionnel pourra difficilement se retrouver sur le banc d’une équipe de très haut niveau. Est-ce une erreur de fermer la porte à d’autres personnes ?Il y a 16 ans, je faisais partie de la direction du cursus de formation (des entraîneurs) et à l’époque déjà, un joueur qui n’avait pas fait partie de l’élite pouvait déjà aspirer à devenir entraîneur. De toute façon, après, une sélection naturelle se fait. Le monde du football fait le tri sur la base de la qualité des uns et des autres, anciens joueurs professionnels ou pas. Si tu es compétent, tu fais ton bonhomme de chemin, tu continues. Si tu ne l’es pas, au revoir, tu trouves une autre voie. Après, est-ce qu’il est juste ou non de ne pas donner accès à ce parcours à tout le monde ? C’est aux personnes compétentes en France qu’il faut le demander. Ce sont elles qui ont le pouvoir de décision et qui décident de cela. En tout cas, au Portugal, ce n’est pas comme ça.
Mais ça ne peut pas être un problème, notamment pour le renouvellement des générations d’entraîneur ? Vous avez parlé de la « dynastie » de coachs portugais, mais en France, ce renouvellement s’effectue plus difficilement. Si plus de gens avaient accès aux cursus en question, la probabilité pour que des gens compétents apparaissent dans le football français serait plus élevée. C’est mathématique… (Il réfléchit) Si l’on remarque bien, vous me corrigerez si je me trompe, à l’échelle mondiale, si l’on prend les meilleurs entraîneurs, peu d’entre eux ont été de très grands footballeurs. On a Guardiola, Ancelotti, Luis Enrique… (il hésite) Maintenant, il y a Zidane au Real Madrid, on va voir ce que ça va donner. Pellegrini n’a pas été un joueur formidable, Antonio Conte n’a pas été un top player et José Mourinho n’a pas connu de grande carrière. Et si l’on regarde les générations antérieures, c’est pareil. Ça ne veut pas dire que c’est le mauvais ni même le bon chemin. C’est une manière de devenir entraîneur. Avec le succès de José Mourinho, il y a clairement une catégorie de nouveaux (entraîneurs) professionnels qui s’est formée et a suivi le mouvement, bien qu’au Portugal, les entraîneurs licenciés existent depuis longtemps. Jesualdo Ferreira et Carlos Queiroz en font partie. Tout ça pour dire que la réussite d’un entraîneur n’a aucun lien avec son parcours en tant que joueur. Ça peut aider, ou pas, dans le domaine technico-tactique, ça aide sans doute un peu plus dans le domaine de la communication, du leadership d’un groupe, mais ce n’est pas décisif. Et ce n’est pas parce que je le dis que c’est vrai. C’est simplement quelque chose de vérifiable.
À quel moment vous êtes-vous dit : « Bon, c’est le moment de laisser mon costume d’adjoint, je suis prêt » Tout s’est déroulé naturellement. Je n’ai jamais eu la phobie de ne jamais être quelqu’un d’important. Quand j’étais sélectionneur de la Syrie, il ne m’est à aucun moment passé par la tête de me dire « Tiens, si j’allais entraîner un club ? » La preuve, c’est que pendant cette expérience, j’ai reçu un coup de fil du professeur pour me proposer de travailler avec lui au Panathinaikos. Je lui ai dit que je ne savais pas trop si c’était une bonne idée de redevenir adjoint, mais que si cela pouvait l’aider, pourquoi pas. Comme il était plutôt manager et que j’avais déjà une certaine expérience, on m’a octroyé des fonctions élargies au sein du club. Ensuite, quand on a été champions avec Zamalek, je me suis dit que c’était le moment de continuer ma vie tout en remerciant le professeur pour tout ce qu’il a fait pour moi.
Question inévitable étant donné que vous avez largement cité son nom. Qu’avez-vous appris aux côtés de Jesualdo Ferreira ? En quoi cette expérience a été si bénéfique ?On en apprend tous les jours avec lui. Tant sur le plan humain que sportif. Si tu veux choisir le chemin de l’excellence, suis les traces du professeur.
Concrètement, comment cela se traduit ?Par de la rigueur dans la préparation des entraînements, des matchs, de l’analyse des adversaires dans le moindre détail… Par sa manière de diriger ses joueurs aussi. Ensuite, et en dépit d’être arrivé à ses côtés avec une certaine expérience accumulée, le fait d’avoir connu deux clubs à l’étranger avec le Panathinaikos et le Zamalek, ainsi que deux grands clubs portugais, le Sporting et Braga, m’ont permis d’avoir une vision de ce qu’était l’organisation et la gestion de grands clubs. Le fait de travailler avec un excellent entraîneur dans des clubs d’élite m’a fait progresser très rapidement parce que j’ai vu comment on structurait une équipe professionnelle, un département de football, j’ai vu ce que c’était d’être l’adjoint principal du professeur et j’ai compris en l’observant quelles étaient les différences avec le rôle de coach principal. Tout ceci a contribué à faire en sorte que je sois plus que prêt au moment de quitter l’équipe technique de Jesualdo Ferreira.
Vous avez évoqué furtivement votre expérience en tant que sélectionneur de l’équipe de Syrie olympique. Que retenez-vous de cette expérience, humainement et sportivement ?En premier lieu, pour les gens qui ne la connaissent pas, vous n’imaginez pas à quel point Damas est une ville fantastique. C’est l’une des plus anciennes villes du monde, la deuxième plus ancienne, je crois. C’est là-bas qu’a été inventé le premier alphabet, l’alphabet sumérien. C’est une ville très intéressante. D’autre part, j’ai joué dans beaucoup d’autres pays du Moyen-Orient. J’ai joué en Afghanistan, en Iran, en Irak, à Oman, en Chine (il sourit). Ça a été une chance. C’était une expérience enrichissante du point de vue culturel. J’ai été très respecté là-bas, j’avais une excellente réputation, car j’ai quasiment amené la sélection olympique aux JO de Londres. Malheureusement, on était tombés dans le groupe du Japon. On avait réussi à les battre à domicile, mais on a échoué à l’extérieur. Mais gagner une seule fois, c’était déjà énorme. C’est comme de battre l’Allemagne pour une équipe européenne. Ensuite, on a échoué à la deuxième place du groupe de play-offs, mais ça a été un plaisir énorme. On a réussi à révéler beaucoup de joueurs, à tel point qu’aujourd’hui, la base de la sélection est celle que j’avais construite il y a plusieurs années.
Le football est important pour les Syriens ?C’est une folie. Une vraie folie. C’est la même chose que… je sais pas… que l’Égypte. C’est pareil. J’ai dirigé la sélection syrienne A. Quand on a affronté l’Irak, il y avait 60 000 personnes dans le stade du centre de Damas. C’était plein à craquer, l’ambiance était dingue.
Vous avez été exposé à la guerre ?Je suis arrivé en septembre 2010, la guerre commence en mars 2011 et je suis parti en avril 2012. J’ai connu la Syrie en guerre civile pendant un an, mais à Damas, tout était relativement tranquille. Je suis juste triste de savoir, quand je prends des nouvelles par téléphone, que 90% de mes anciens joueurs sont exilés en Grèce, en Allemagne et même en Russie… La seule chose que j’ai vraiment ressentie par rapport à la guerre, c’est que tout était devenu politique, même le football, et qu’au lieu de m’entretenir avec le président de la Fédération syrienne, je parlais directement avec le ministre des Sports. Ça explique bien la complexité de la situation. Mais c’est vraiment étrange (il marque un temps d’arrêt). Aujourd’hui, quand on parle de la Syrie, c’est comme si on parlait d’un pays qui n’existe plus, alors qu’il y a trois ans, c’était la dixième plus grande nation d’Asie en matière de football. C’est-à-dire juste derrière tout ce qui est Japon, Corée du Sud, Australie, Iran, Irak…
Et en France, comment ça se passe ?(Il rit) L’adaptation à Paris se passe très bien. On parle de l’une des meilleures villes du monde, d’un centre culturel et cosmopolite mondial. Comme c’est l’année de l’Euro, Paris est le centre du monde. Et puis je suis dans un club qui m’a très bien reçu, qui évolue dans un championnat aussi exigeant qu’intéressant. Donc tout va très bien !
Vous connaissiez déjà la ville ?Oui, oui, je l’avais déjà visitée auparavant. Mais c’est une chose de connaître Paris comme touriste et une autre d’y vivre.
Quelle est la différence ?Quand vous vivez dans une ville, vous la sentez. Vous sentez l’odeur du café, l’odeur du restaurant. Quand on visite une ville en tant que touriste, que fait-on ? Visiter les musées, manger dans deux ou trois restaurants, mais c’est tout. Là, je vis ici, je me balade dans la rue et je sens les choses… L’odeur ambiante est d’ailleurs l’une des choses les plus marquantes quand vous avez une expérience au Moyen-Orient, en dehors des autres détails que j’ai déjà cités. Ce qu’il y a en plus à Paris, c’est que la ville est tellement riche culturellement que vous pouvez toujours trouver quelque chose à faire. Moi qui aime les spectacles, les pièces de théâtre et le cinéma, je suis servi, même si je n’ai pas vraiment de temps libre depuis que je me suis installé ici (il rit).
Et l’apprentissage de la langue ?(Il inspire profondément) Ça va mieux. J’ai réussi à atteindre un niveau qui me permet de communiquer correctement avec mes joueurs et de leur transmettre mes émotions, parce que c’est aussi quelque chose de très important quand vous apprenez une autre langue en tant qu’entraîneur.
Vous parliez un peu plus tôt de votre attrait pour la culture, le théâtre, les musées… C’est important pour un entraîneur d’avoir des connaissances qui sortent du simple cadre du football ?Plus nous sortons de notre zone de confort, mieux nous nous portons. C’est mon opinion. Sortir de cette zone, ça peut être lire des livres que nous ne connaissons pas, suivre des cours sur des sujets qui nous sont inconnus, faire des formations dans des domaines qui nous sont étrangers… Tout ceci fait de nous de meilleures personnes et nous aide à faire face et à comprendre certaines situations, surtout pour quelqu’un comme moi qui dois gérer 25 personnes dont certaines sont de cultures, d’origines différentes. Cela peut aider à comprendre certaines réactions, certains doutes et certaines réflexions des uns et des autres parce qu’ils sont d’une éducation différente. Je pense que c’est très important pour un entraîneur d’avoir cette curiosité-là et cette envie d’apprendre.
Dernière question, vous avez déclaré dans une émission de radio portugaise qu’entre monter en Ligue 1 et gagner la Ligue des champions, vous choisiriez…(Il coupe) Sans hésitation la montée de division ! Bah… Tout simplement parce qu’on ne peut pas gagner la Ligue des champions, vu qu’on ne la dispute pas. Ça n’aurait aucun sens de vouloir la gagner. On ne peut pas gagner la C1, mais en revanche, on peut monter de division. Donc le choix est vite fait. (Il rit). L’objectif du Red Star est de se maintenir. Au-dessus de ça, qu’y-a-t-il de plus ? La montée. Rien d’autre. D’où ma réponse…
Ligue 2 : Le Red Star et Reims se neutralisent, Montpellier loupe le cochePropos recueillis par William Pereira, à Saint-Leu-La-Forêt.