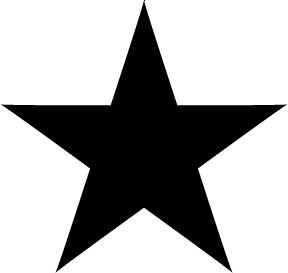- CDM 2018
- Qualifs
- France-Luxembourg
Aurélien Joachim : « Ça n’a pas été une promenade tranquille »

Griezmann, Giroud et les autres ont beau faire peur à toutes les défenses du monde, le meilleur buteur du groupe A se nomme Aurélien Joachim. Le Luxembourg, les douches froides à Sofia, les cours au collège, Molenbeek... L'attaquant luxembourgeois vide les tiroirs avant de se présenter face à Hugo Lloris. Qu'il a déjà couché au match aller, d'ailleurs.
Je suis en train de parler au meilleur buteur du groupe A, devant Giroud, Griezmann ou Emil Forsberg. Chapeau !C’est clair que c’est pas mal, et ce, malgré le fait que j’ai raté le match contre les Pays-Bas (1-3) à la maison, car j’étais blessé (il était aussi absent au retour pour suspension, ndlr). Marquer quatre buts en cinq matchs, ça n’arrive pas souvent, donc ça fait plaisir.
Quand vous avez marqué contre la France, vous avez fait la célébration « salt bae » . Il vous fait marrer, ce boucher turc ? (Rires) Non, ça c’était pour un copain à moi qui m’avait dit : « Si tu marques contre la France, tu fais ça ! » Donc c’était plutôt une dédicace !
Quand on joue pour une petite nation, est-ce qu’on s’inspire de ce qu’a fait l’Islande au dernier Euro ?Oui, ça montre que dans le football d’aujourd’hui, les petites nations sont de plus en plus fortes. Pour les grandes nations, ça devient difficile, on voit moins de scores larges comme il y a quatre ou cinq ans. L’écart de niveau devient de plus en plus petit.
Dans l’histoire des meilleurs buteurs du Luxembourg, vous vous approchez de Léon Mart (qui a inscrit 16 buts entre 1933 et 1946, contre 11 pour Joachim). Si tout se passe bien, vous n’allez pas tarder à aller le chercher !Franchement, j’en ai aucune idée ! (Rires) Moi, j’ai 31 ans, je prends encore du plaisir, et si, au passage, j’arrive à marquer plus de buts que celui qui en a marqué le plus, je serai content. Mais bon, ce n’est pas mon objectif principal. Je veux d’abord prendre du plaisir et profiter des dernières années.
En ce moment, vous êtes le capitaine porte-bonheur de votre équipe. Dès que vous avez le brassard, le Luxembourg gagne…Oui ! C’est pour ça, j’hésite à le prendre dimanche ! (Rires)
Mais pourquoi le coach ne vous le donne pas à chaque match ?Ah, je pense que ça doit rester quelque chose de spécial ! Normalement, c’est Mario Mutsch notre capitaine, moi je n’ai pris le brassard que quand il était blessé.
Vous avez fait toute votre formation de footballeur en Belgique. Pourquoi ?J’ai toujours habité en Belgique, mais j’allais à l’école au Luxembourg et mes parents travaillaient au Luxembourg. J’ai commencé le foot assez tard, vers douze ans, et j’ai grimpé les échelons petit à petit.
Quand on vient du Luxembourg, est-ce compliqué de se faire repérer au-delà des clubs du Benelux ?Moi, j’ai joué en Belgique jusqu’à mes dix-huit ans, puis je suis parti une saison en Allemagne. Et j’ai connu une blessure, j’ai arrêté un an, et j’ai dû reprendre mes études. J’ai repris le football petit à petit au Luxembourg et je suis passé pro à 25 ans par hasard, donc je n’ai pas vraiment eu un parcours normal. Mais sinon, je pense que le problème, ce n’est pas de rester jouer en Belgique, ou d’aller en France. C’est de passer le cap pro, c’est ça qui est le plus difficile pour un joueur luxembourgeois. Peu importe dans quel championnat, c’est le plus difficile je pense. Avec les résultats qu’on a en ce moment, c’est une bonne vitrine pour tous les joueurs du Luxembourg.
Vous dites que vous êtes passé pro « par hasard » . C’est-à-dire ? C’est surtout la blessure qui m’a empêché de jouer pendant un an. Il a fallu que je retombe sur mes pattes, donc j’ai passé mon diplôme de STAPS en Belgique, puis je suis retourné jouer au Luxembourg. Ensuite, je suis parti à Dudelange, on a été champions, on a joué les qualifications pour la Ligue des champions. J’ai marqué huit buts en sept matchs, donc on est venu me chercher pour aller jouer en Hollande, en première division. Et puis c’était parti.
Il paraît qu’au Luxembourg, c’est parfois plus avantageux financièrement de bosser dans une banque que d’être footballeur pro à l’étranger. Cela expliquerait le fait que beaucoup de jeunes ne persévèrent pas. C’est vrai ?C’est sûr même ! Avec mon premier contrat pro, je gagnais moins que ce que j’avais au Luxembourg en travaillant ! Et à vingt-cinq ans, il n’y en a pas beaucoup qui auraient continué, mais moi, je l’ai fait.
Malgré ce parcours animé, ça fait douze ans que vous êtes régulièrement appelé en sélection. Pourquoi les coachs ont continué à vous faire confiance ?Il y a deux ans où je n’ai pas joué en sélection, parce que l’entraîneur qui était en place à ce moment-là (Guy Hellers) voulait que je laisse tomber mes études pour me concentrer sur le football. Je lui avais dit non, que mes études étaient plus importantes que la sélection. Et quand l’entraîneur qu’on a maintenant (Luc Holtz) est arrivé, il m’a dit que je pouvais suivre mes cours et venir aux stages avec l’équipe. À partir de ce moment-là, je suis revenu.
Une fois vos études de STAPS terminées, vous avez travaillé comme professeur de sport ?Oui, j’ai pris un mi-temps. J’étais professeur, et j’allais m’entraîner à Dudelange. J’étais prof en collège-lycée, c’est enrichissant de transmettre son savoir à des jeunes gamins, de voir leurs progrès, c’est quelque chose de bien.
Bon, revenons aux éliminatoires de la Coupe du monde. Le Luxembourg a joué contre la Bulgarie. Ça vous a permis de retourner à Sofia, où vous avez joué une saison avec le CSKA. Ça vous a fait plaisir de retrouver cette ville ?Oui ! J’ai passé une saison là-bas, et le CSKA, c’est quand même un club à part, on a connu des hauts et des bas, mais c’est une ville où je me plaisais bien. Donc aller là-bas pour le premier match des éliminatoires et marquer, c’était un bon retour à Sofia ! Mais c’est dommage qu’on ait perdu à la dernière minute…
Les gens d’Europe occidentale sont parfois un peu dépaysés quand ils arrivent dans les pays de l’Est. Quand vous avez mis les pieds au CSKA, vous n’avez pas eu cette impression ?Non, j’avais une voiture là-bas, un appartement, j’habitais au centre, je connaissais la ville, je roulais sans GPS. Je me sentais bien, je n’ai jamais eu de problèmes.
En revanche, vous avez passé une saison là-bas à une époque où le club était dans une situation catastrophique. Les caisses étaient vides, le CSKA était au bord de la faillite…(Rires) On a tout vu, hein ! Pour recevoir mon premier salaire, j’ai attendu deux mois. On a été en stage en Turquie sept semaines en hiver, on n’a pas été payés sur les quatre derniers mois, c’était… On était premiers à la trêve, puis ensuite on a tout perdu. Il n’y avait plus d’eau chaude, plus de lumière dans le vestiaire. Le bus, ils ne l’avaient pas payé… C’était incroyable.
Ensuite, vous partez à Burton, en D3 anglaise, et c’est à nouveau compliqué. C’est Jimmy Floyd Hasselbaink qui vous a fait venir, mais quand Nigel Clough l’a remplacé sur le banc, il vous a vite fait comprendre qu’il ne voulait pas de vous.Surtout que je m’étais blessé lors de mon dernier match avec le CSKA. Le club a fait faillite à la fin de la saison, je n’avais plus de contrat, donc c’était un peu galère pour trouver un club après ça. J’ai fait un test à Burton où Jimmy Floyd Hasselbaink m’a voulu. Mais je suis arrivé en août, j’avais raté toute la préparation. L’équipe a bien tourné au début de saison, c’était difficile. Et dès que Nigel Clough est arrivé, j’ai compris que c’était terminé… Tous les étrangers, il les a mis un peu… Ça se voyait que c’était terminé.
Il ne venait même pas vous parler, vous donner des explications ?Non. À un moment, je venais de jouer contre l’Espagne, je suis revenu, et il m’a dit : « Tu n’es pas dans le groupe. » Et ce n’est même pas lui qui est venu me le dire, il a envoyé un adjoint . Mais le président est resté correct, il m’a payé la fin de mon contrat et voilà, on s’est quittés.
À l’époque, vous utilisez des mots assez forts. Vous parliez de dépression, d’envie d’arrêter de jouer… C’était vraiment ce que vous ressentiez ?Quand tu travailles la semaine à l’entraînement, que tu donnes tout, et qu’on ne te donne jamais ta chance, à un moment donné, mentalement, ça devient difficile. Même quand je jouais et que je marquais avec la sélection, ça ne changeait rien. Alors que c’est la League One ! Ce n’est pas non plus la Premier League, hein. Donc je suis parti, je suis allé en D2 belge où j’ai eu du temps de jeu, on a été champions et le club n’a pas eu sa licence pour jouer en D1 !
Oui, vous parlez du White Star Bruxelles. C’est un club situé à Molenbeek et vous y arrivez en 2016, en pleine paranoïa post-attentats, à une époque où l’on parle de cet endroit de façon très péjorative. Vous la ressentiez, cette atmosphère pesante ?Oui, c’est en plein Molenbeek ! Moi, j’étais à l’hôtel, au milieu, tranquille. Après, dans les médias, ils exagèrent aussi toujours un peu. Ce n’était pas non plus Bagdad.
En fait, on a l’impression que vous vivez votre carrière sur le fil du rasoir, comme si elle pouvait s’arrêter demain.C’est clair qu’avec Sofia et l’Angleterre, puis le White Star qui n’a pas eu sa licence alors qu’on devait jouer en première division, ça n’a pas été une promenade tranquille !
Vous n’êtes pas fatigué après toutes ces galères ?Non. Jouer au foot, c’est pour le plaisir. Même si les trucs à côté ne sont pas toujours drôles, ça reste le plus beau métier du monde. Maintenant, je suis bien au Lierse où c’est ma deuxième saison. Et puis ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort !
On pourrait presque résumer en disant que vous avez attendu la saison dernière avant de connaître votre première saison normale, sans soucis extrasportifs. Il était temps !C’est sûr. Mais là où je suis maintenant, ce n’est pas un club à problèmes. Tout est toujours payé à temps, ils sont corrects.
Enfin, il y a quelques mois, le médecin de ton club a quand même fait une belle boulette en t’injectant un mauvais médicament. Il s’est passé quoi ?J’avais reçu un coup dans le genou, et le cartilage avait un peu souffert. Il fallait me faire une piqûre pour recouvrir le cartilage, mais il y avait des hormones animales dans le produit et j’étais allergique. Mon genou a gonflé, gonflé… Ils ont dû le pomper, et après ça a été, mais c’est pour ça que j’ai raté le match à la maison contre la Hollande. Les médecins m’ont dit qu’ils n’avaient jamais vu ça avant, et un autre médecin m’a dit qu’il n’utilisait plus ce produit depuis des années parce qu’il avait eu quelques cas similaires.
Vous avez dit un jour : « La D2 hollandaise, c’est mieux que la D1 luxembourgeoise. » C’était il y a quatre ans. Est-ce que ce constat est toujours vrai aujourd’hui ? Je pense que si un jeune veut progresser, c’est mieux pour lui d’aller jouer en D2 hollandaise que de rester en D1 au Luxembourg, ça c’est sûr.
J’ai envie de terminer en prenant des nouvelles de votre demi-frère, le cycliste Benoît Joachim, qui était un des lieutenants de Lance Armstrong au début des années 2000. Comment va-t-il ?Il s’est lancé dans l’immobilier, il a ouvert une agence. Il s’est mis au triathlon aussi, il galère en natation, mais bon, en vélo il est bon donc ça s’équilibre !
Le mot de la fin, juste avant de jouer contre les Bleus ?On va y aller tranquille. On a pris trois points contre la Biélorussie comme on voulait, c’était le plus important. Après, contre la France, ça reste un match de gala pour nous. On n’a rien à perdre, si on prend n’importe quel joueur chez lui, il vaut autant que toute notre équipe, donc bon. Nous, on vient pour prendre du plaisir, qu’on se mette à onze derrière ou à onze devant, ça ne change rien !
Un ancien de Ligue 1 nommé sélectionneur du LuxembourgPropos recueillis par Alexandre Doskov