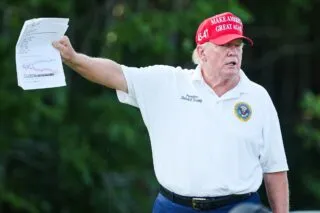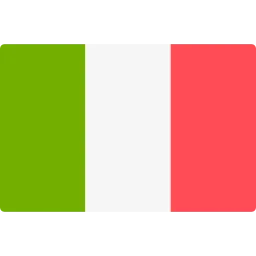- Italie
- Napoli
Alessio Forgione : « Dans mon club, j’étais le seul dont le père n’est jamais allé en prison »

Après Napoli mon amour, paru en 2018, l’auteur napolitain Alessio Forgione revient avec Crier son nom, une chronique de la vie ordinaire dans un quartier chaud du Naples de la fin des années 1990. Au travers du portrait d’un anti-héros anonyme, on (re)découvre cette fatalité propre à la cité parthénopéenne, dans laquelle le football n’est jamais très loin.
Dans Crier son nom, tu racontes l’histoire de Marocco, un gamin du quartier défavorisé de Soccavo, qui passe sa vie entre le foot, le deal de shit, les mauvaises notes à l’école et une fille dont il tombe amoureux. Quelle est la part d’autobiographie dans tout ça ? Comme Marocco, j’ai joué numéro 6 quand j’étais jeune, au Pro Calcio Napoli, où sont notamment passés Paolo et Fabio Cannavaro. Comme lui, j’ai également fait un essai infructueux à la Salernitana, j’ai été dans le même lycée… En gros, je connais tous les éléments dont je parle. Mais pour autant, dire que Marocco c’est moi, ce serait mentir. Contrairement à lui et ses potes, je n’ai jamais vendu de shit ou cambriolé un appartement. En revanche, je sais comment on fait. Parce que ça fait partie des sujets de discussion normaux au quartier, je n’ai pas eu besoin de faire de recherches sur Google.
Le numéro 6, c’est un peu le poste de Marocco qui, sur le terrain, fait d’abord briller les autres plutôt que de prendre la lumière.C’est un mec timide, pas assez courageux pour tenter une frappe lui-même et qui se cache en faisant la bonne passe à l’attaquant. Un peu comme moi, effectivement. J’étais mediano, celui qui récupère la balle et la passe au mec bon devant. Ce que je préférais, c’était l’idée de faire partie d’une équipe. Quand tu joues au foot, tu dois penser collectif, parce que c’est impossible de gagner seul. Il n’y a que Maradona qui y arrive. Mais je n’ai jamais rêvé de passer pro. Ce qui me plaisait le plus pendant mon temps libre, c’était de lire et de jouer de la guitare.
Tu es né en 1986. À quoi ressemblait le Soccavo de ton adolescence ?Au club de foot, j’étais le seul dont le père n’est jamais allé en prison. Je n’ai jamais eu l’opportunité de traîner avec des fils de médecins, juste avec des enfants de criminels. Là où j’ai grandi, vendre de la drogue, c’était quelque chose de normal. C’est triste à dire, mais c’est la réalité. Quand Marocco vend des barrettes de shit avec son pote, ce n’est pas pour devenir Pablo Escobar, c’est juste pour s’acheter un scooter. Même chose avec les gars qui cambriolent un appartement. L’un des personnages du roman le fait pour emmener sa nana à la pizzeria. C’est une manière de dire que quelque part, on est obligé d’en arriver là pour se permettre de vivre des petites choses toutes simples.
Qu’est-ce qui a fait la différence pour que tu n’en arrives pas à de tels extrêmes ?Ma famille. Mes parents n’ont jamais abandonné en ce qui concerne mon éducation. J’allais jouer au foot avec des enfants de criminels, mais quand je rentrais à la maison, mon père m’expliquait certaines choses : qui était une bonne fréquentation ou non, pourquoi il fallait être assidu à l’école, parler italien… Comme pour le père de Marocco, la question du respect était très importante : la question n’était pas comment imposer le respect, mais comment en donner aux autres. C’est très important et c’est ça qui fait toute la différence.
Tout au long du récit, on en revient perpétuellement à la question de la fatalité : peu importe ce que tu fais, quelque chose de mauvais finira par t’arriver. Comme si c’était inhérent aux quartiers populaires de Naples.Je suppose que c’est le cas. Pour moi, Crier son nom est un livre sur l’éducation. Par exemple, si tu viens d’un quartier chaud, que tes parents n’ont pas le temps de s’occuper de toi, qui va t’élever ? Pas l’école, pas les politiques, pas la police, mais le quartier. Marocco joue au foot, mais je ne l’imagine pas devenir pro. Il joue parce que tout le monde joue au foot et comme il n’est pas mauvais, il pourrait prétendre à toucher quelques compensations financières. Mais il n’a rien de spécial, ce n’est pas comme s’il pouvait devenir quelqu’un à travers le foot. Avant de devenir écrivain, j’ai travaillé comme marin sur un bateau de croisière, puis comme barman à Londres. Parce qu’avec mes deux diplômes en sciences politiques et en sociologie, je ne trouvais aucun boulot dans ma ville. Mon départ s’est fait par désespoir. Et à Naples, nombreuses sont les personnes qui n’ont aucune perspective d’avenir.
![]()
Cela tranche un peu avec la hype touristique qui entoure actuellement Naples.C’est bizarre, parce que rien n’a changé là-bas, en tout cas pour nous, les gens normaux. La seule différence, c’est qu’avant, on faisait les poches des touristes, et aujourd’hui, on se fait du fric avec ce qu’il y a dans leur poche. C’est devenu du vol légal. Et quand je dis « on », ce n’est pas moi. Je ne possède ni bed and breakfast, ni pizzeria, donc je n’ai pas plus d’argent sur mon compte en banque à la fin du mois. Dans le centre-ville, il n’y a plus que des restaurants et des bars pour les touristes. Ils nous ont pris notre espace, et je ressens bien plus de pauvreté qu’il y a quelques années, c’est devenu très compliqué de se loger. Pareil avec le boulot. À la limite, tu vas encore pouvoir facilement trouver un job de serveur, comme quand tu étais étudiant. Sauf que là, tu as deux diplômes et tu te retrouves quand même à faire le boulot que tu avais pour payer tes études. Et donc, puisqu’on parlait de fatalité, on finit par croire en ce destin maudit qui est le nôtre. Le concept de « bonne chance », on ne le connaît pas à Naples. Nous, on a la « ciorta », le destin, qu’il soit bon ou mauvais.
Quelles ont été les réactions à la sortie de ton roman ?Cela dépend de qui on parle. À Soccavo par exemple, une dame m’a reproché un jour au marché de parler du quartier comme d’un bidonville alors que, selon elle, « on a des arbres ». Et oui, c’est vrai, on a des arbres, mais c’est tout. Soccavo fait partie d’un triangle d’arrondissements de l’Ouest de Naples dans lequel vivent 170 000 personnes et où il n’y a ni cinéma, ni librairie, ni théâtre, ni même une place où on pourrait se retrouver pour bavarder. Donc comment ne pas devenir cinglé ? C’est putain d’injuste. Après, d’autres m’ont dit : « Ah c’est bien, ça parle de nous. » Certains m’ont même confié que c’était le premier bouquin qu’ils lisaient de leur vie et que, du coup, c’était leur préféré. (Sourire.)
Et en dehors de Naples ?La plupart de mes lecteurs sont généralement issus de bonnes familles, ont fait de bonnes études, et moi, je leur sers un bouquin qui ne parle absolument pas de ça. Dans le texte, les personnages parlent italien, mais en vrai, ce n’est pas le cas, ils parlent napolitain. Ils sont ignorants, pauvres et ils ne lisent pas. En Italie, les gens s’attendent généralement à lire quelque chose qu’ils connaissent déjà, au moins en partie, et ça, ça ne me plaît pas, je préfère lire quelque chose que je ne connais pas encore. Mais il s’est quand même bien vendu, et beaucoup de lecteurs ont ressenti de l’empathie vis-à-vis du personnage de Marocco, mais aussi de celui de sa mère, qui a quitté la maison quand il était enfant. Elle vient de Pescara, elle est tombée amoureuse d’un Napolitain, a eu un enfant avec lui, mais elle finit par s’enfuir sans laisser d’adresse. C’est un peu l’illustration des gens qui ont abandonné l’idée de pouvoir survivre à Naples.
Tu évoquais la question de la langue, il est important de préciser que le napolitain est bien plus qu’un dialecte.Absolument. Ma copine vient de Bologne et, pour plaisanter, je dis qu’elle me sert de prof d’italien, parce que ma langue maternelle, c’est le napolitain, pas l’italien. C’est celle que j’emploierai pour m’exprimer de la manière la plus naturelle. Ce n’est pas comme à Rome, où les gens utilisent des mots spécifiquement locaux dans leurs phrases. À Naples, le napolitain est davantage parlé que l’italien et la musique napolitaine est bien plus populaire que la musique italienne. On a une identité vraiment marquée, différente du reste de l’Italie. D’ailleurs, ça peut paraître bizarre, mais pendant la Coupe du monde, on supporte l’Argentine, pas l’Italie. Quand la Nazionale a gagné l’Euro 2020, on a juste dit « OK »… Et si tu vas à Milan par exemple, tu auras l’impression d’être dans n’importe quelle grande ville européenne. À Naples, ça ressemble davantage à l’Afrique du Nord. Mais ça ne me dérange pas pour autant. Le seul problème, c’est qu’on ne part pas avec les mêmes chances dans la vie.
Le texte de ton livre est ponctué de citations extraites de chansons de Franco Battiato, un artiste sicilien. Pourquoi lui et pas un chanteur napolitain ? Parce que tout ne tourne pas autour de Naples. On est des humains, chacun avec nos différences, et c’est important de prendre en compte ce qui se fait de bien ailleurs. Battiato, j’aime ses paroles parce qu’elles sont très tristes, mais en même temps, il cherche toujours une solution pour se sortir de son désespoir. Dans mon quartier, tout le monde n’écoute que de la musique napolitaine, le reste, ils s’en foutent. Marocco, il aime lire, et ça, déjà, ce n’est pas commun. J’étais pareil à son âge : je lisais, je parlais italien, et d’ailleurs, pour ça, on me surnommait l’Italiano. Marocco est un pur produit de son quartier, mais il ne se résume pas à ça : il l’accepte, mais il veut aussi pouvoir s’en échapper.
Cette violence liée à la condition napolitaine, on la retrouve aussi dans les tribunes de foot. On connaît par exemple le chant des tifosi de la Juventus à l’encontre de ceux du Napoli : « Ô Vésuve, lave-les avec le feu » . Ce ne sont pas que les supporters de la Juve. Toutes les tribunes italiennes du Nord haïssent les Napolitains, et tout le monde chante ce putain de chant. Même dans un match random comme Vérone-Fiorentina, on va la chanter. Ce qui est étrange, c’est que lorsqu’on entend des cris de singe contre un joueur noir, on est censé arrêter le match – en tout cas, les instances sont censées faire quelque chose. Mais quand ce sont des chants anti-Napolitains, on ne fait rien, c’est comme si c’était normal. En même temps, si tu passes un entretien d’embauche à Milan, le recruteur va partir du principe que comme tu es napolitain, tu es forcément peu sérieux, rude, vulgaire… C’est peut-être en partie vrai, mais ça ne veut pas dire pour autant que tous les Napolitains sont comme ça !
Tu es abonné au Napoli ?Non, les billets sont hors de prix. Même pour une place en Curva Nord, il faut lâcher 40-50 euros. Donc je regarde le plus souvent les matchs à la télé avec des potes et quelques bières. Pour la Serie A, on fait ça chez moi, pour la Coupe d’Europe, chez un autre, parce que là aussi, les abonnements sont super chers, et il en faut plusieurs pour pouvoir suivre toutes les compétitions.
![]()
C’est quoi ton rapport au club ?J’ai commencé à le suivre à l’époque où se déroule l’histoire de Marocco, à la fin du XXe siècle. Je me rappelle encore le coup franc de Baggio qui nous envoie en Serie B. C’était vraiment la merde, et en plus, il régnait un climat ultraviolent au San Paolo. Aujourd’hui, je me vois comme un supporter extrême. Je n’aime pas tellement le président De Laurentiis, même s’il nous a ramené plusieurs bons joueurs. Cavani est incroyable ; Higuaín, il est merdique, mais il était incroyable ; Insigne, Coulibaly, Hamšík, Mertens, idem, incroyables. Le problème, c’est qu’on n’a pas su les garder. Je ne suis pas forcément fan de ce qu’on appelle le football moderne, mais quand un mec récolte un million de likes quand il poste un truc sur Instagram, c’est qu’il engendre de l’argent, il faut faire avec. Si Insigne veut cinq millions, donne-lui ses putains de cinq millions, en plus tu les as ! Aujourd’hui, il joue à Toronto, mais il aurait pu continuer à Naples. Tant pis, c’est comme ça.
La fameuse ciorta napolitaine, encore elle. Attention, je prends beaucoup de plaisir à regarder l’équipe actuelle, on dirait qu’ils sont en train de recommencer un projet à zéro, avec plein de jeunes joueurs comme Khvicha Kvaratskhelia, lui aussi il est incroyable. Mais combien de temps on va le garder ? Même question avec Oshimen ! On ne sait pas vendre. De Laurentiis voulait 70 millions pour Fabian Ruiz, il l’a vendu 25. Kalidou Koulibaly, c’était 100 millions, il est parti pour 40 à Chelsea. En gros, il fait ses affaires, mais il ne peut pas gagner comme ça. Gagner, c’est dangereux parce qu’aujourd’hui, ça implique d’investir beaucoup d’argent, et les supporters de Naples commencent à en avoir marre de ne jamais gagner le Scudetto depuis 32 ans et de devoir se contenter des places qualificatives pour la Ligue des champions. Mais au fond, moi, je m’en fous de gagner des titres. Je crois que le plus important, c’est de bien jouer et de donner le meilleur de nous-mêmes.
Est-ce qu’il ne vous faudrait pas un nouveau Maradona pour enfin en finir avec cette image de perdants magnifiques ?Si, sûrement, mais aujourd’hui, il jouerait pour le PSG ! (Rires.)
Propos recueillis par Julien Duez
À lire : Crier son nom, éditions Denoël (2022), traduit de l'italien par Lise Caillat.
Crédit photo : Garault