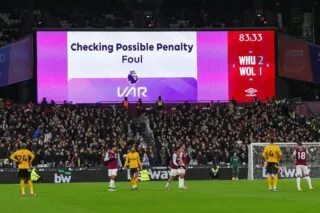- Europe
- Superligue
Agnelli, la Juve et le prix du mépris

En assumant d'incarner le projet de Superligue européenne, Andrea Agnelli a sévèrement entaché l'image d'un club qui, il y a cinq ans encore, avait exorcisé les démons du Calciopoli en s'affirmant comme un modèle de réussite gestionnaire. Un choix en forme de trahison, pour une institution dont la direction gomme tragiquement les spécificités identitaires, année après année.
Andrea Agnelli était prêt. Au royaume des conciliabules, des maîtres chuchoteurs, des officines secrètes et des traîtres en costume, il fallait un roi. Un type qui voulait bien porter la couronne d’épines. Faire office de bouc émissaire, Andrea Agnelli s’y était résigné. Il fallait bien quelqu’un pour assumer de porter ce projet de Superligue. Quelqu’un pour « sauver le football » comme dira son binôme madrilène Florentino Pérez, autre grande figure de cette « révolution » . Finalement, Andrea Agnelli n’a encore rien sauvé du tout. Et surtout pas la Juventus, un club qu’il avait rehaussé à des hauteurs inespérées, avant de tout détruire méthodiquement, en l’espace de quatre ans.
Vieille Dame salie
De 2010 à 2017, l’actuel président de la Juve avait tout simplement transformé la Vieille Dame, club décliniste ravagé par le scandale du Calciopoli, en exemple à suivre. Ses Bianconeri cochaient toutes les cases. Une base des joueurs italiens ? Check. Une défense et une science tactique admirées et révérées ? Aussi. Un mercato visionnaire, piloté par un Beppe Marotta en état de grâce ? Un maillot avec des rayures ? Des joueurs expérimentés, à la personnalité affirmée ? Une domination sur le plan national ? Des parcours épiques en C1, ponctués de défaites en finale ? Oui, oui, oui, oui et encore oui. Telle était la Juventus d’Andrea Agnelli. Une Juventus qui ressemblait à la Juventus. Jusqu’au jour où Andrea Agnelli a décidé que ça ne suffisait plus. Qu’il fallait que son club soit davantage comme les mastodontes anglais. Comme le Barça. Comme le Real. La vérité, c’est que, quatre ans plus tard, la Juventus, finaliste de la C1 en 2016-2017, ne ressemble plus à grand-chose.
À vrai dire, elle est tellement méconnaissable qu’elle a décidé de se désolidariser de sa base, la Serie A, pour piloter la création d’une compétition fermée. La Juventus a méprisé le championnat italien, ce trésor national grâce auquel elle a construit l’immense partie de sa renommée, de sa gloire opulente, là où l’AC Milan aura davantage fait des joutes continentales la matrice de son succès et de son prestige. La légende du club piémontais n’est évidemment pas toute blanche, mais les scandales d’antan n’en restaient pas moins de sombres affaires conclues sous le manteau. Des combines honteuses, que les magouilleurs voulaient garder loin de la lumière des projecteurs, à l’image du Calciopoli lui-même. La Superligue n’avait, elle, pas vocation à rester un projet souterrain, et Andrea Agnelli l’aura pilotée au grand jour, certain de la légitimité légale, mais aussi morale de son coup d’état sportif, qui siphonnait le peu d’équité qui existait encore au sein du foot européen.
« Politiquement, nous avons été anéantis »
Pire encore, il aura associé à jamais le nom de la Juventus à son initiative. Un club dont il aura changé le logo, retiré un temps les rayures du maillot, et qu’il aura appauvri financièrement et sportivement, notamment en autorisant le recrutement déraisonnable de Cristiano Ronaldo. Un club dont l’entraîneur, Andrea Pirlo, immense joueur au demeurant, a rétréci à vue d’œil, en qualifiant la Superligue de « projet d’avenir », un projet que son homologue Pep Guardiola n’avait pourtant pas hésité à fracasser publiquement. Un club qui, par le biais d’Agnelli, est pour beaucoup le porte-étendard du projet de Superligue, une initiative que le président de la Juve aura structurée et lancée sans consulter ses propres supporters. Ce mercredi, l’un d’eux écrivait sur les réseaux sociaux : « Avant, nous avions une équipe. Un vrai club. Un président qui avait la Juventus dans le sang et qui ne pensait pas à créer des ligues semblables à ce qu’on peut voir dans un jeu vidéo. Politiquement, aujourd’hui, nous avons été anéantis. »

Comment ne pas être anéanti, en effet, quand l’on lit les déclarations d’Andrea Agnelli, fils d’Umberto Agnelli, neveu de Gianni Agnelli, dans La Repubblica de ce mercredi, recueillies avant que le projet de Superligue ne coule soudainement : « Ce qu’on essaye d’organiser est la plus belle compétition au monde… Les plus jeunes veulent voir des grands événements. Créer une compétition qui simule ce qu’ils font sur les plateformes digitales – comme FIFA – signifie se rapprocher d’eux et faire face aux compétitions de Fortnite ou Call Of Duty, qui sont leurs centres d’intérêt… Le football n’est plus un jeu, mais un secteur industriel et il lui faut de la stabilité. » Quid des solutions alternatives ? D’une baisse des salaires, des commissions d’agents, des droits TV, des indemnités de transferts, des revenus de sponsoring ? D’une déflation économique qui, en réalité, permettrait au football et aux footballeurs de retrouver plus de prise, de contact et d’affect avec une société dont ils se sont tristement éloignés ? Andrea Agnelli ne touchera jamais mot de tout ça. Plus que le football, Andrea Agnelli voulait probablement sauver les millions du football. Aujourd’hui, on peut en tout cas douter qu’il soit encore le mieux placé pour diriger la Juventus et préserver l’essence d’un club qui va probablement dans le mauvais sens.
Par Adrien Candau