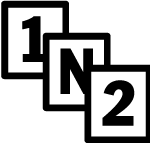- Amérique du Sud
- Uruguay
- Mort de Alcides Edgardo Ghiggia
À la poursuite des poteaux maudits

C'est l'histoire d'une catastrophe nationale : soixante-quatre ans avant l'édition 2014, en 1950, le Brésil perdait sa première Coupe du monde organisée sur son sol dans son antre du Maracanã. Dans la foulée, Moacir Barbosa, le gardien de la Seleção, affirmait avoir fait un barbecue avec les buts maudits. Sauf que ceux-ci ont ensuite réapparu mille kilomètres plus loin. Que s'est-il passé ? Enquête sur les pas d'une malédiction.
Une photographie en noir et blanc, aux bords rongés par les souris. Alignés côte à côte devant leurs gros camions Mercedes, trois hommes prennent la pose comme pour un portrait de famille – vaguement souriants, un peu gênés, comme pressés d’en finir. Est-ce leur patron qui tient l’appareil ? Le message semble clair, en tout cas : cette flotte automobile a fait de beaux voyages. Et même un voyage historique. C’était il y a une éternité, en janvier 1960. Geraldo Tardelli, l’homme à gauche sur cette photo, main sur le capot et jambes croisées, parcourait mille kilomètres aller-retour entre Muzambinho, dans le Minas Gerais, et Rio de Janeiro. Un trajet de dix-sept jours, sans bitume, d’un Brésil à un autre : d’abord la terre rouge des plantations de café, puis la brume des lagunes d’Alfenas, les mille cinq cents mètres d’altitude de la Serra da Mantiqueira, avant de redescendre dans les orangeraies de la Baixada Fluminense, jusqu’au sable de Copacabana. Une aventure dont l’importance ne se situe pourtant pas dans l’itinéraire, mais dans la cargaison.
Parti à vide, Geraldo Tardelli revient avec, à l’arrière de son camion, un morceau d’histoire de son pays. Six bouts de bois de Laponie, de différentes dimensions, peints en blanc et parsemés de crochets : les cages du stade Maracanã, là où le Brésil, le 16 juillet 1950, a encaissé les deux buts qui l’ont vu perdre sa Coupe du monde à domicile, contre l’Uruguay. Des bois maudits. Mais qui, pour Geraldo Tardelli, n’ont pas plus d’intérêt qu’une vieille photographie. Depuis qu’il a rangé son camion, Tardelli, dit Sapo, « le Crapaud » , passe ses journées au bar de son fils. Un établissement installé à l’entrée de Muzambinho, dans un garage. Un billard, deux ventilateurs, un frigo, une télévision, deux étagères sur lesquelles s’empilent les bouteilles de cachaça, des toilettes qui ne ferment pas et, dehors, trois tables avec des chaises en plastique jaune. Geraldo Tardelli est assis sur l’une d’elles. La TV derrière lui retransmet France-Nigeria, un événement pour lequel son petit-fils s’est teint les cheveux en vert. Mais Tardelli est occupé à autre chose : il dispute une partie de truco, la belote sud-américaine, contre un jeune du quartier. Des capsules de bière servent de mise. Les buts du Maracanã ? « Je suis fatigué, dit-il. Je n’ai rien à dire. »
Barbecue et chiens battus
Le Crapaud n’est pas le seul à tenir sa langue. Soixante-quatre ans maintenant que le Brésil refuse de parler de cette affaire. Soixante-quatre ans qu’à défaut de pouvoir la tuer, il essaie de la cacher sous le tapis, le plus loin possible. Si chaque pays a, dans son histoire, connu son 11-Septembre et son Titanic, alors le Maracanaço est la plaie ouverte du Brésil. Un traumatisme impossible à dépasser, au point qu’en 2014, alors que la Coupe du monde revenait à Rio pour la première fois depuis 1950, il s’est trouvé des gens pour protester contre le fait que la finale se joue au Maracanã. Trop risqué. Trop douloureux. Et toujours présent. Le pays n’a pas oublié que ce 16 juillet 1950, 200 000 personnes, soit un dixième de la ville de Rio, assistèrent au but de Ghiggia qui donna à l’Uruguay une Coupe du monde qui devait marquer l’entrée du Brésil dans la modernité et que tous pensaient avoir gagné avant même de la jouer. Mais les champions du monde, ce furent les autres : Uruguay 2, Brésil, 1. La suite ? Un silence qui fait taire une ville entière. Et bientôt le pays. Car tout change d’un coup. La façon dont le Brésil voit son football, et la façon dont le Brésil se voit lui-même. C’est la naissance du complexe du vira-lata, le complexe du « chien bâtard » , théorisé par le grand dramaturge brésilien Nelson Rodrigues : « L’infériorité avec laquelle les Brésiliens se positionnent eux-mêmes volontairement face au reste du monde. »
Le Brésil, si fier d’avoir construit le stade le plus grand du monde, le Brésil qui découvre la démocratie, le progrès économique, les voitures américaines, et aime se voir comme une nation émergente, ce Brésil-là ne vaut en fait pas mieux qu’un pays de deux millions d’habitants. Il est toujours le tiers-monde. On raconte que c’est ce jour-là que le Roi Pelé vit son père pleurer pour la première fois de sa vie. Tout ce qui rappelle cette défaite sera désormais marqué du sceau de l’infamie. À commencer par Moacir Barbosa, jugé coupable du fiasco. Le gardien noir ne revêtira plus qu’une fois le maillot national, vivra comme un paria, et sera même interdit de rendre visite à la Seleção pendant la préparation de la Coupe du monde 1994. Sa morale de l’histoire, telle qu’il la donna en 1994 : « Au Brésil, la peine maximale pour un crime est de trente ans. Moi, je paie depuis plus de quarante-trois ans pour un crime que je n’ai pas commis. » Les buts subissent la même sentence. Il ne faut laisser aucun témoin. Les quatre grands clubs de Rio – Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco da Gama – exigent leur retrait du stade. En tournée avec la sélection bulgare au Maracanã en 1958, le sélectionneur Georgi Pachedzhiev réitère la plainte. De telle sorte que lorsque Geraldo Tardelli serre son frein à main devant le Maracanã ce jour de janvier 1960, débâche son camion, charge les montants préalablement démontés en trois tenants et repart, il ne conduit pas simplement les buts du Maracanã à Muzambinho : il les emmène vers l’oubli. Barbosa lui-même, par exorcisme, pourra désormais raconter une autre histoire, qui arrangera tout le monde : ces maudits montants, il les a brûlés pour allumer un barbecue. « Mon père était un grand fêtard, il organisait beaucoup de churrasco, donc les gens y ont cru, témoigne aujourd’hui Tereza Barbosa, la fille adoptive du gardien. Et puis, tout le monde voulait que cette histoire s’arrête. »
Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée. Elle a juste été transférée ailleurs, dans un Brésil inconnu des touristes et des cartes postales. Muzambinho, Minas Gerais, terre de café et de production de lait, un endroit où, en 1960, « on ne portait même pas de chaussures. Ou alors seulement le dimanche, pour aller à l’église » , explique Celso Sales. Comptable à la retraite, ce dernier reçoit dans l’entrée de sa maison, sur l’avenue du Dr Americo Luiz, là même où sont arrivés les buts un matin de janvier 1960. Un vestibule aussi froid qu’une salle d’attente de dentiste, seulement décoré de deux natures mortes et d’un immense crucifix. S’il existe quelqu’un capable d’expliquer pourquoi les maudits montants sont arrivés jusque dans cette ville oubliée, c’est bien lui : Celso Sales est le fils de José Otaviano Sales, l’homme à l’origine du transfert. Entraîneur de l’équipe locale, ce cordonnier est, à l’époque, un ami proche d’Urias Antonio de Oliveira, le responsable des stades de Rio. « Là-bas, personne n’en voulait. Pour eux, l’objectif était de les éloigner, de les faire disparaître. Quand mon père a appris ça, il a sauté sur l’occasion » , raconte Celso. Pourquoi une ville a-t-elle accepté ce que le reste du pays considère alors comme une malédiction ? Le fils Sales, 13 ans à l’époque, resitue : en 1960, même dix ans après l’événement, le mot Maracanaço ne signifiait pas grand-chose à Muzambinho, où la télévision n’est arrivée que vers 1970 et où on ne voyait alors des matchs que des extraits, au cinéma, avec une semaine de retard. « Pour nous, le fait de jouer dans les buts du stade le plus grand d’Amérique du Sud était plus important que la défaite. Tardelli avait appelé le village la veille pour nous prévenir de son arrivée. On l’attendait depuis 10 heures du matin sur l’avenue principale, et on avait préparé une fête. De la viande grillée, des feux d’artifice » , se souvient-il. Le cortège se déplace ensuite quelques centaines de mètres en contrebas, vers le terrain municipal où sont hissés les buts, leurs filets et un bout du grillage du Maracanã. Loin, très loin de Rio.
Dans la solitude des champs de café
Cinquante-quatre ans plus tard, la pelouse du stade de Muzambinho jaunit sous le soleil du Minas Gerais. Carlinhos, le jardinier, déplace mètre carré par mètre carré le seul dispositif d’arrosage que la mairie a bien voulu lui mettre à disposition. Une opération qui lui prend une semaine au total. Et qui ne sert à rien, dit-il. « Quand j’attaque la dernière moitié du terrain, l’autre a déjà séché… Mais c’est comme ça ici : les hommes politiques n’ont rien à faire du foot, hormis en période d’élections. » Surprise : de part et d’autre de la pelouse, les buts ne sont ni carrés, ni en bois de Laponie. « Les cages du Maracanã ne sont plus là depuis longtemps, glisse Carlinhos. Ils ont été démontés dans les années 70, parce que les joueurs en avaient marre, ils voulaient jouer avec des poteaux ronds. Alors ont les a envoyés vers un autre terrain de la ville, en périphérie. » Sauf que sur l’autre terrain : rien non plus. Juste des chiens errants. Cette histoire serait-elle bidon ? Pour en avoir le cœur net, il faut retraverser la ville et pénétrer dans un atelier sombre, mangé par les toiles d’araignées. Laercio Sandy est un homme a priori éloigné du football : il est luthier, spécialisé dans la fabrication des violãos, ces guitares à dix cordes sur lesquelles se joue la samba. Mais il a des choses à montrer. « Appelons mon frère » , dit-il avant de fermer son atelier et de faire démarrer sa Golf Gol 1986. Une piste de terre rouge et de poussière serpente entre les bananiers et les plants de café. Dix kilomètres plus loin, son frère, Antonio Carlos Sandy, producteur de café, accueille au milieu de nulle part. Une église à l’abandon, des vaches qui paissent, le bruit assourdissant d’un homme qui fait des tours de motocross, suivi par ses chiens. Et un terrain de foot. C’est là, dans ce décor à mille lieues du Maracanã, que les buts mythiques ont été vus debout pour la dernière fois. « On les a récupérés en 1980, atteste Antonio Carlos en montrant du doigt les poteaux ronds qui les ont, depuis, remplacés. La ville a voulu s’en séparer parce que les poteaux carrés étaient devenus désuets. Notre père, Nivaldo Sandy, les a alors rapportés en camion et les a installés ici, dans le champ. »
À l’époque, le terrain est encore en terre, le gazon vient tout juste d’être semé. Nivaldo Sandy possède une équipe de football qui porte son nom et qu’il dirige lui-même. Ses joueurs s’entraînent le vendredi en fin d’après-midi, jouent le dimanche contre les autres équipes amateurs de la région. Pendant près de vingt ans, les poteaux carrés agonisent entre les champs de café. À mesure que la peinture blanche s’écaille sous la pluie, leur lourd passé s’efface des mémoires. Puis, une nuit de 2001, l’orage emporte ce qui reste. L’eucalyptus qui surplombe le terrain est touché par la foudre. Une branche se décroche, tombe sur l’un des buts, le casse en deux. Antonio Carlos Sandy n’a pas oublié le matin qui a suivi. « Quand on s’est réveillés, on a vu le but détruit. Mon père était très triste. C’est moi qui me suis chargé de dégager la branche. On les a balancés dans le champ, derrière. » Antonio Carlos Sandy invite maintenant à le suivre jusqu’à sa ferme. La télé retransmet Allemagne-Algérie. Un fromage maison et le café de la plantation sont posés sur une grande table en bois. Derrière, dans l’arrière-cuisine, une poutre d’un mètre de long est suspendue sous les tuiles. Un peu de blanc, des extrémités rongées par la pourriture : ce qui reste des buts du Maracanã. « Les voilà, confirme l’agriculteur. Avant, je laissais le morceau dans mon entrée, mais les gens d’ici ont commencé à savoir qu’il était chez moi. J’ai eu peur de me le faire voler, alors je le cache, maintenant. » Le but épargné par la foudre, lui, a connu un sort plus ambitieux : il est exposé à la maison de la culture de Muzambinho. Une petite maison de plain-pied, deux pièces avec des photos pixellisées d’anciennes gloires locales accrochées au mur, et une salle où les cages en bois, vernies et remises en état, occupent tout l’espace. Une étude conduite par l’Université fédérale de Lavras, dans le Minas Gerais, a récemment certifié que ces poteaux étaient bien ceux du Maracanã. Pour pas grand-chose : peu de visiteurs passent par là, à part deux Uruguayens « mariés avec des femmes d’ici » , rigole Celso Sales.
Le retour de la malédiction
Et c’est tout ? Non. Restent aussi deux cubes de dix centimètres sur dix. « Des chutes » , explique leur propriétaire, qui les a récupérés des mains du charpentier ayant effectué la restauration pour la maison de la culture. Lui aussi habite près de l’endroit où les poteaux mythiques furent déchargés en 1960. Un petit appartement « de célibataire » , dit-il en même temps qu’il se présente. Fernando Magalhães enlève le coupe-ongles et les médicaments qui encombrent son canapé, range les drapeaux brésiliens qui parsèment son salon, laisse aboyer le chien du voisin. Il n’était pas né en 1950, mais le Maracanaço est son obsession. « Dès que le Brésil joue au Maracanã, j’ai peur » , dit-il. À écouter cet historien de formation, toute cette histoire de Maracanaço est pourrie depuis le début. « Le jour de la finale, au moment des hymnes, Barbosa a remarqué que le drapeau du Brésil avait été monté à l’envers. Un symbole de malchance. Depuis, tout va de travers. » Y compris à Muzambinho. Car dès le moment où Geraldo Tardelli a ouvert les bâches de son camion sur la place centrale, l’esprit du Maracanaço s’est mis à souffler sur la ville. Ce jour-là, le club local organise pour l’occasion un match amical contre l’équipe carioca d’Olaria, en tournée dans la région.
Évidemment, la fête tourne à la déroute. 12-0 pour les visiteurs, et des événements étranges. Trois gardiens jouent ce match côté Muzambinho. Le premier encaisse six buts, et sort. Le second en prend quatre, dont un coup franc qu’il ne voit même pas atterrir dans ses cages : il est borgne. Le troisième, réputé alcoolique, mange le reste, et déclenche le courroux de la star adverse, l’attaquant Jaburu. « De rage, notre gardien a fini par envoyer la balle directement dans les pieds de Jaburu, en lui disant : « Tiens, toi qui es si fort, frappe. » L’autre a levé la balle, a fait trois jongles, et lui a tiré dessus le plus fort possible, en visant la poitrine. Le goal s’est évanoui » , se rappelle Amir Aquino, ancien gardien de but de Muzambinho lui aussi, présent au match en ce jour historique. Fernando Magalhães en est persuadé : ni la distance, ni le temps n’ont rompu la malédiction. « Dès que j’ai récupéré les bouts, les choses ont commencé à mal tourner pour moi, laisse-t-il planer. Je me suis retrouvé sans travail et j’ai perdu ma femme après six ans de mariage. À partir de ce moment-là, j’ai essayé de les éloigner, en les cachant dans le grenier. » Du reste, l’historien ne croit pas aux coïncidences : selon lui, ce n’est pas tout à fait un hasard si les buts du Maracanaço se sont retrouvés à Muzambinho. « Muzambinho est un mot africain dont on a perdu la signification, glisse-t-il, mystérieux. Mais il existe un mot, « Muzambo », qui est un rite pratiqué par certaines tribus africaines pour expulser les esprits des maisons et rappeler leurs ancêtres. Il y a deux cent cinquante ans, ce village était un quilombo, un endroit où les esclaves noirs fugitifs venaient se cacher. »
« C’est comme si on cachait ces buts »
Amir Aquino, lui, a travaillé à la Banco do Brasil pendant trente ans. Suffisant pour s’offrir une maison bourgeoise, avec porte de garage automatisée, cuisine américaine et table du salon en verre. Dans son large canapé recouvert d’épais coussins, l’ancien gardien de Muzambinho ne croit pas à ces affaires de malédiction. Selon lui, la leçon à tirer de tout cela est nettement plus simple : ces buts qu’on repousse toujours plus loin, c’est tout bonnement la fable d’un pays qui ne sait pas quoi faire de son passé. « Le peuple brésilien n’a pas de mémoire. Ni de ses bons, ni de ses mauvais moments. Ici, ce n’est pas l’Europe : on est en Amérique. Il n’y a pas d’histoire, juste de la géographie et des paysages. » Assise à ses côtés, la femme d’Amir intervient : « Ce but qui reste debout n’aurait jamais dû se retrouver dans la maison de la culture d’une petite ville comme la nôtre. C’est comme si on le cachait. Il devrait être dans un musée national, au Maracanã, à Brasilia ou à São Paulo. » Au lieu de quoi, soixante-quatre ans après les faits, le futur de ces reliques dépend en grande partie de trois personnes : un professeur névrotique et deux frères désintéressés. Fernando Magalhães montre ses deux petits bouts de bois, serrés dans des sacs plastique. « Maintenant que le Mondial est revenu au Brésil, je crois que le moment est venu pour moi de m’en débarrasser » , dit-il. L’un d’entre eux est signé par Alcides Ghiggia, le buteur de la Celeste de 1950, que le professeur est allé voir chez lui, en Uruguay. Le second ressemble aux restes d’une épave. Il le soupèse dans sa main, esquisse un sourire. « J’ai déjà prévenu mes copains du bar d’en face : à peine la Coupe du monde achevée, j’en ferai un barbecue, en hommage à Moacir Barbosa. » Chez les Sandy, en revanche, on ne s’est pas encore mis d’accord. Antonio Carlos, le producteur de café, veut garder le but chez lui, afin d’honorer la mémoire de son père, qui les avait fait venir. Laercio, le luthier, a une autre idée en tête : « J’aimerais prendre le bout de bois que mon frère a chez lui pour le transformer en petite guitare » , prêche-t-il dans son atelier. Derrière lui, la radio grésille. Laercio reprend : « À mon avis, il ne sert à rien de donner autant d’importance à un symbole de tristesse. Moi, cette tristesse, je préférerais la transformer en samba. » Laquelle ? « Une chanson de Zeca Pagodinho. Par exemple Deixa a Vida me Levar. » En français : Laisse la vie m’emporter.
Article publié dans le So Foot#118, Le bilan du Mondial, en juillet 2014.Par Pierre Boisson, Lucas Duvernet-Coppola, Cristian Pereira et Stéphane Régy, à Muzambinho / Photos : Renaud Bouchez