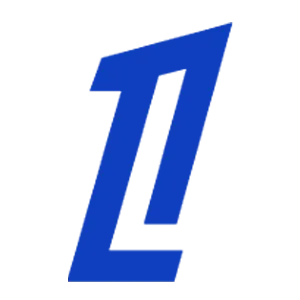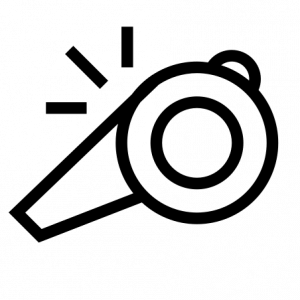- Rétro
- Drame de Furiani
30 ans du drame de Furiani à Bastia : « Je vois l’apocalypse à Furiani »

Du paradis à l'enfer. D'une affiche de rêve en demi-finales de Coupe de France face à Marseille et sa palette de stars à 19 morts et 2357 blessés. Le 5 mai 1992 à Furiani, il n'y a pas seulement cette maudite tribune qui s'est écroulée. Le quotidien de centaines de famille a changé pour toujours. Ce jour-là, le football a tué et ouvert une lutte de presque trois décennies pour les victimes. Trente ans plus tard, cinq victimes directes ou indirectes rouvrent la plaie, pour ne jamais reléguer ce drame dans les abysses de l'histoire.
Casting
Antoine Di Fraya : capitaine du Sporting Club de Bastia. A perdu un ami de 18 ans le 5 mai 1992.Mamadou Faye : milieu du Sporting.Josepha Guidicelli : présidente du collectif des victimes. A perdu son père à Furiani.Karine Grimaldi : supportrice bastiaise. A perdu sa sœur de 15 ans à Furiani.Didier Grassi : commentateur bastiais sur une radio locale, membre du collectif des victimes.
***
Comme si c’était hier
Karine Grimaldi : Trente années ça paraît beaucoup, mais c’était hier. J’ai passé plus de vie en fauteuil que valide… Je vais bientôt avoir 50 ans, c’est énorme. Heureusement, je suis encore là pour le raconter. Ma famille a été anéantie.
Antoine Di Fraya : La sensation de ce drame est toujours présente. Trente ans, c’est incroyable… Tout ce que nous avons vécu à Furiani est au fond de nous. Je n’ai pas le sentiment qu’autant d’années sont déjà passées. Je suis de Bastia, j’ai perdu un ami de 18 ans lors de ce match, des amis ont été blessés, il y a toujours quelque chose qui nous y ramène.
Mamadou Faye : Cette tragédie a affecté tout le monde. Quand on l’a vécu en direct, ça hante l’esprit…. Le traumatisme est là. Je n’ai jamais regardé les images de ce match, je ne peux pas remuer le couteau dans la plaie. Mais il faut en parler pour ne pas oublier.
Didier Grassi : Souvent, les gens comparent ça au 11-Septembre, parce que chacun sait ce qu’il faisait à ce moment-là. Je me souviens minute par minute de la journée du 5 mai. Il y a juste un moment qui a totalement disparu de ma mémoire, c’est après la chute, pendant 2-3 heures, il y a un trou noir. Des photos montrent que je suis conscient, mais je ne me souviens de rien.
***
Une affiche de rêve
Faye : C’est comme si cette année, Bastia recevait le PSG en demi-finales de Coupe. Marseille, c’est ce qu’il se faisait de mieux en France à cette époque. Vice-champion d’Europe, champion de France, Papin, Boli, Moser, Waddle… la grosse cylindrée. C’était un rêve pour nous.
Di Fraya : On avait très peu de chances de se qualifier, mais ce n’était pas infaisable non plus. La ferveur, les médias, on n’avait pas l’habitude de vivre ça. On sentait tout un peuple derrière nous, j’étais arrêté à chaque fois par des gens quand je me baladais dans la rue.
Grimaldi : Je n’étais jamais allée au stade. Sur l’île, ce match était un événement énorme, personne ne voulait rater ça. Tout le monde voulait y aller.
Faye : On voulait emmener tout le monde au Parc des Princes, comme onze ans plus tôt. (Bastia avait remporté l’édition 1981 face à Saint-Étienne, NDLR.)
Guidicelli : Mon père, Pierre-Jean, était technicien à la radio RTFM. Ce jour-là, il ne devait pas y aller. Il devait suivre le match depuis le studio. Mais vu qu’il était passionné, il a demandé à changer avec sa collègue.
Grassi : À travers ce match, le Sporting renaissait de ses cendres. On végétait en D2 depuis des années, là on retrouvait le haut de l’affiche face à l’une des équipes phares de France et même d’Europe. Le matin du match, j’étais sur la place Saint-Nicolas pour le départ d’une étape du Tour de Corse en rallye. C’était une journée parfaite.
***
Une journée presque parfaite…
Grimaldi : On est à quatre avec ma sœur Santa et deux amis. J’avais pris des billets pour la tribune Est, celle qui était debout. Je quitte mon poste de coiffeuse dans l’après-midi et je passe prendre ma sœur au lycée. On se présente à la tribune Est vers 16 heures.
Grassi : J’arrive très tôt, vers 14 heures. Trente minutes plus tard, on prend l’antenne à la radio, on propose aux joueurs de Bastia de choisir des chansons qu’on va passer à l’antenne. Je suis dans la dernière rangée, où on a installé des tables pour les journalistes pour travailler convenablement, mais ça n’est vraiment pas le cas.
Di Fraya : Deux heures avant le match, le stade est déjà quasi plein, on sent qu’on va être poussés d’une manière phénoménale. On entre pour s’échauffer, toute l’île est derrière nous. En face, c’est le grand Marseille. Les Marseillais s’échauffent sur un petit bout de terrain, et Pascal Olmeta s’embrouille avec des supporters. C’est chaud.
Faye : On se dit qu’il est impossible de perdre devant un tel public. Sur le papier, il n’y a pas photo, l’OM est largement au-dessus, mais tout est réuni pour faire un coup. En quarts, on avait éliminé Nancy à l’extérieur. Avec Marseille, on a onze hommes en face de nous, il faut se surpasser.
![]()
Grimaldi : L’ambiance, j’en ai presque la chair de poule. C’est trop beau, dingue. Je n’avais vu ça qu’à la télé. Avoir un tel regroupement à Bastia, c’est inimaginable. On réunit toute la Corse en un point, on est juste heureux.
Grassi : À l’époque, il y a 240 000 habitants en Corse, on est 18 000 au stade. Personne n’avait connu ça sur l’île. La folie nous a fermé les yeux autour de cette fameuse tribune.
Faye : Ça a été une connerie de la monter pour faire plaisir à tout le monde.
***
La tribune de la mort
Di Fraya : Toute la semaine, on s’est entraînés à Furiani et on l’a vu se monter. La précédente (de 750 places) avait été cassée, et l’ambition des dirigeants était de profiter de ce match pour faire venir un maximum de gens. Après, on ne savait pas non plus qu’il y avait eu autant de demandes et qu’à la fin, on a rajouté une nouvelle structure à la structure existante.
Faye : Sans cette tribune, Furiani était déjà un petit Marseille, ça aurait été bouillant quoi qu’il arrive.
Grassi : De façon objective, quand le tirage a lieu et que Bernard Tapie a envisagé de jouer le match au Vélodrome en reversant la recette à Bastia, c’était inenvisageable. Il fallait jouer à Furiani. Et quand cette tribune est construite, on ne se pose aucune question. Des gens m’ont dit après-coup : « Mais comment, à 28 ans, t’as pu croire que ça allait tenir ? T’étais con ou quoi ? » On avait juste confiance.
Di Fraya : L’armée était venue pour monter la tribune durant la semaine. C’était impossible d’avoir un doute, il y avait une société du continent qui était habituée de ces chantiers. On n’avait pas à s’inquiéter.
Grassi : C’était présenté comme le même type de tribune qui avait été montée à Albertville pour les Jeux avec un stade pour 30 000 personnes. Sauf que l’on comprendra bien après que ça n’était pas vraiment la même, notamment parce qu’il y avait eu une grève des dockers dans l’acheminement des matériaux. Les années 1990, c’est le début du foot-fric, et cette histoire est aussi une histoire d’argent, il fallait vendre le plus de billets possible.
Grimaldi : Quand je voyais ce qui se construisait, ça m’interpellais parce que je trouvais ça haut, mais c’est tout, d’autant plus que je n’étais pas censée aller dans cette tribune. Sauf que notre tribune était pleine et qu’on a été envoyées vers celle-ci. Je ne me pose pas de question, on suit le mouvement. En arrivant au pied de la tribune, il était impossible de se mettre en bas, car les places étaient numérotées, au milieu il y avait trop de drapeaux pour voir quelque chose, du coup on file tout en haut. J’ai encore l’image en tête de notre arrivée en haut, les gens paraissaient si petits.
![]()
Grassi : C’est là où je me dis qu’on était quand même déconnectés de la réalité parce qu’il y avait des jeunes militaires et des gamins du Sporting qui continuaient à serrer des boulons et qui mettaient des planches alors qu’on était déjà au stade. Mais il y a une telle euphorie de la rencontre. On charrie même quelques collègues journalistes marseillais qui disent ne pas se sentir en sécurité, car les supporters bastiais étaient trop près d’eux.
Grimaldi : Si j’avais eu l’ombre d’un doute, je ne serais jamais montée. Pourquoi certains iraient et pas moi ? On ne se pose pas toutes ces questions-là.
***
La vie qui chute
Faye : Je suis tellement absorbé par l’ambiance que je traîne à la fin de l’échauffement. Je suis spectateur du spectacle. Je ne sais pas quand nous allons revivre un tel bonheur, il faut profiter jusqu’à la dernière seconde. Quand le speaker dit aux gens de ne plus taper des pieds, je trouve dingue d’entendre ça, on n’est pas au théâtre quoi, les gens mouillaient le maillot pour nous.
Grassi : Quand le speaker dit ça, je ne l’entends que d’une oreille, j’étais surtout sur la fin de l’échauffement des joueurs.
Grimaldi : Je ne tape pas du tout des pieds, je pensais que c’était juste le bruit qui gênait le speaker.
Di Fraya : Les Marseillais sont déjà rentrés aux vestiaires, nous on est encore sur le terrain. Et il y a ce bruit assourdissant.
Grassi : Je suis debout, j’ai le micro à la main. Il y a un groupe corse qui s’apprête à entonner l’hymne corse. Là, j’ai un sentiment d’aspiration vers le sol. Je tombe de 15 mètres. C’est le trou noir.
Grimaldi : Je me sens aspirée, j’ai les cheveux qui arrivent devant mon visage et il y a un choc. Je suis au sol, j’ai du mal à respirer avec une barre en fer dans le dos, je ne me demande pas si je peux me relever ou non, il y a un tel bruit de ferraille, tout le monde crie.
Faye : Toute la partie du haut de la tribune s’affaisse. Mais je me dis que ce n’est pas si terrible que ça. C’est impossible d’imaginer une telle catastrophe, 19 morts, etc. Dans mon esprit, le match va se faire. Je pense de suite à mon frère, Assane, qui est venu du Sénégal pour me voir jouer. Je m’approche rapidement de la tribune. À ce moment-là, je vois l’apocalypse à Furiani. Le bruit est indescriptible. Des barres de fer qui transpercent des gens, du sang qui gicle, j’ai un sentiment de désolation énorme.
Grimaldi : Je demande immédiatement où est ma sœur. On me met un blouson sur moi, et quelqu’un part en courant avec. Aussitôt on me met la main sur le visage et l’on me dit que ma sœur va bien, qu’elle sera évacuée. Quelque chose ne va pas, je le comprends…
Faye : Et moi, je ne vois toujours pas mon frère. Je pense directement au Heysel, il faut libérer les supporters pour qu’ils viennent sur la pelouse.
Di Fraya : Ils sont tétanisés, tous agglutinés contre les grillages. En allant voir derrière la tribune, je comprends que c’est la catastrophe et que le match n’aura pas lieu. C’est terminé. On bascule de joueur de foot à secouriste. Heureusement qu’on est là, on ouvre les grillages immédiatement, ça avait été mis à la va-vite et attaché avec des fils de fer. Je pense que dans ce grand malheur, on a ce sang-froid pour enlever ça et éviter un drame supplémentaire.
Faye : Tout le monde est débordé. Les joueurs deviennent des pompiers, on déplace les gens et on les transporte à l’hôpital. Les Marseillais viennent aussi nous aider. Les pompiers nous balancent des infos sur le bilan.
Di Fraya : J’apprends qu’il y a des morts seulement plusieurs heures après l’accident.
Grassi : Pendant trois heures, c’est le trou noir. Je ne vis pas les moments les plus horribles du drame, et c’est aussi pour ça que psychologiquement, j’ai été un peu épargné. Les premières images qui me reviennent, c’est lorsque je suis allongé sur une planche en bois de la tribune avec d’énormes douleurs sur mon côté gauche. Il y a des corps de partout, des hélicoptères, ça ne crie pas, mais ça s’active. Jean-Pierre Papin met sa veste de survêtement en boule sous ma tête, Bernard Tapie me dit 2-3 mots. C’est lunaire ce qu’il se passe. Et puis il n’y a pas de portable à l’époque. Les proches nous recherchent. Partout.
![]()
Faye : Dans ma tête, j’ai plein de choses qui passent. Comment peut-on en arriver là pour un match de football ? Je ne retrouve toujours pas mon frère. Vers 3 heures du matin, on va à l’hôpital pour donner notre sang.
Grassi : Je suis d’abord transféré à l’aéroport de Bastia, puis à Marseille. Ma femme me cherche, elle ne me retrouvera que le lendemain grâce à un reportage sur France 2 où j’ai témoigné.
Faye : Quand je rentre chez moi, ma femme, qui allait accoucher trois semaines plus tard, est en larmes. Je m’assois dans le canapé, c’est impossible de fermer l’œil. Je n’apprends que le lendemain où est mon frère. Il a été transféré à Grasse et souffre de multiples fractures. Tous les jours qui suivent, on va à l’hôpital au chevet des victimes.
Grimaldi : Je suis évacuée à Bastia, c’est très difficile. Ma sœur est retrouvée au matin à la morgue… Je revois mes parents après une radio et je suis emmenée en avion à Marseille à la Timone où je suis placée en réanimation.
Grassi : Le 7 mai, je prends connaissance de la presse, de l’ampleur du drame, je comprends que je suis un miraculé. Des gens à côté de moi sont décédés. À un moment ou un autre, je vais retrouver une vie normale.
***
Une lente reconstruction
Guidicelli : Mon père n’est pas décédé sur le coup, il a été transféré à Marseille, il a subi quelques opérations et il est décédé.
Grimaldi : Personne ne me dit que ma sœur est décédée. C’était interdit parce que j’avais de graves problèmes pulmonaires, il ne fallait pas un choc supplémentaire. J’étais sous oxygène constamment. Quand mes parents arrivent à Marseille, on leur dit que seule ma tête continuera à bouger. Le chirurgien leur explique : « On a fait tout ce qu’on a pu, votre fille est bleue, et maintenant, c’est à elle de voir si elle vivra ou pas. » Finalement, je survis et je passe trois semaines en réanimation.
Di Fraya : J’avais envie d’arrêter le football. C’est humain. J’étais fixé sur le moment.
Faye : Le football ne passe pas au second plan, mais bien après. Je n’y pensais plus du tout. Moi aussi, je voulais que ça s’arrête, j’étais tellement affecté. Je n’avais plus envie de jouer au ballon, la joie de vivre était partie. On les connaissait, ces victimes… Quelques jours auparavant, tu les voyais en ville, et elles ne sont jamais revenues de leur passion.
![]()
Di Fraya : Je suis passionné, mais si je n’avais pas la famille qui me soutenait pour repartir sur un terrain, je n’y serais probablement jamais reparti. Mais il fallait se relever, c’est le sort de l’humanité qui subit des drames, mais continue à avancer.
Grassi : J’ai passé deux mois à l’hôpital à Marseille. J’avais un traumatisme crânien avec pas mal de plaies sur le visage, une fracture du bassin, une triple fracture du coude gauche, des plaies aux jambes et une rupture des ligaments croisés du genou droit. Il m’a fallu trois mois pour remarcher. J’ai encore été opéré en 2018, j’ai une prothèse au genou.
Grimaldi : À la sortie de réanimation, je pars en rééducation à Marseille où l’on me dit : « Vous allez travailler pour retrouver de l’autonomie, conduire une voiture, mais vous serez toute votre vie en fauteuil. » Là, c’est la claque. Et j’apprends peu après par une psychologue le décès de ma sœur Santa. Mais je l’avais senti lorsque l’on m’avait mis la main sur le visage au stade. Mes parents ont eu une force incroyable de ne pas me le dire avant. Je passe quatre ans et demi en rééducation et l’on m’a opérée des mains pour réapprendre à m’en servir.
Grassi : J’ai découvert aussi le syndrome du survivant. Pourquoi eux et pas moi ? Ça ronge. Pendant 20 ans, je ne me suis presque pas exprimé publiquement sur le sujet.
Faye : Ça a été très dur de reprendre le foot. Finalement, la saison repart. Psychologiquement et physiquement, c’est compliqué, en plus on passe quasiment toute la saison à Mezzavia (à Ajaccio).
Di Fraya : On retrouve notre stade huit mois plus tard, face à Nancy. Autant dire que c’était extrêmement fort. On était tout en noir.
Faye : On s’est changés dans des Algeco. C’était impensable qu’on rejoue un jour ici. Mais il ne fallait pas que les victimes soient mortes pour rien, on devait jouer au football dans ce lieu. Dans l’au-delà, les victimes nous regardaient. Ça m’a aidé à surpasser cette peur. Quelques jours plus tard, il y a le premier anniversaire du drame, avec seulement une croix, la stèle n’était pas encore là.
Di Fraya : Dans les tribunes, il y avait beaucoup de pudeur dans l’ambiance, c’est très difficile à décrire. Mais on a su gagner, 3-0, et les gens étaient heureux.
Guidicelli : Je ne suis jamais retournée au stade. Avec ma sœur, on a été beaucoup protégées par ma mère et mes grands-parents. On ne parlait pas vraiment de la mort de mon père. Je savais que ça réveillerait des douleurs, je ne voulais pas en parler.
Grimaldi : Un mois après le drame, j’aurais dû valider mon diplôme de coiffeuse et reprendre le salon de mes parents. Ça n’a jamais pu se faire. La barre en fer que j’avais dans le dos m’a probablement provoqué le coup du lapin et brisé cette cervicale, ce qui m’a paralysée. Mes quatre membres ont été touchés, je n’ai plus l’équilibre du tronc.
Guidicelli : À l’adolescence, j’ai posé des questions. Avec le temps, j’ai surtout vu qu’on était qu’entre nous le 5 mai. Ça tombait un peu dans l’oubli. Il fallait un collectif pour se défendre.
***
Que justice soit faite
Guidicelli : C’est ma mère qui lance le collectif. Elle a fait une lettre ouverte, car les gens se préoccupaient plus de l’avenir du club et des personnes inculpées que des victimes. Beaucoup de personnes l’ont rejointe. Ils défendaient plusieurs axes : un véritable procès, que le stade soit reconstruit, mais pas au même endroit, car il était enclavé et les secours avaient du mal à arriver, qu’un centre de rééducation soit créé. Évidemment, on n’a rien eu.
Grimaldi : J’avais de la colère. J’aurais pu faire des malheurs. J’avais une haine d’avoir été brisée et ma famille aussi. À Furiani, on a saccagé nos vies. On nous disait que c’était involontaire, personne ne reconnaissait sa responsabilité, ça a accentué la colère. En 1994, je suis allée au procès, je voulais défier le regard de ceux qui avaient esquinté ma vie. Ils n’ont pas eu le courage de me regarder. Il n’y a jamais eu de justice. Il aurait presque fallu plus de morts pour que ça fasse avancer les choses.
Faye : Dans la presse, à la télé, on voyait cette colère monter.
Grimaldi : On jette la pierre sur la Fédération, mais à Bastia, tout le monde n’est pas net. Aujourd’hui encore, la recette du match n’a pas été remise. On a été menacés, il ne faut pas l’oublier. Des Corses aussi ont provoqué ce drame.
Guidicelli : L’échelle de responsabilité est multiple, du préfet aux dirigeants du Sporting en passant par le constructeur de la tribune.
![]()
Grassi : Concernant le 5 mai, au début je n’ai pas de position figée. Il y avait eu une finale de Coupe de la Ligue ce jour-là en 2001, je n’avais pas regardé, mais c’est tout. Je ne peux pas imaginer aller le matin me recueillir et le soir voir des gens faire la fête.
Grimaldi : Il ne fallait pas que cette histoire reste uniquement sur l’île.
Grassi : Il y a aussi probablement l’aspect religieux, on est des latins. Notre rapport à la mort est différent des autres régions. Le 5 mai, c’est pour se recueillir.
Faye : On respecte particulièrement les morts. La Corse, c’est très particulier, ça a sa culture, ses traditions, sa langue, ça n’a rien à voir avec ce qu’il se passe ailleurs. Ce rapport à la mort est culturel.
Guidicelli : De base, c’est François Mitterrand juste après le drame qui avait donné sa parole pour l’absence de match le 5 mai, tout le monde l’avait pris pour acquis. Mais voilà qu’en 2012, la Fédération programme la finale de la Coupe de France ce jour-là. J’écris immédiatement des lettres aux instances du football, sans retour, puis une autre à Chantal Jouanno, ministre des Sports, qui me répond.
Faye : C’était indécent de faire ça.
Grassi : Il y a un déclic, et le collectif se relance. Après une mobilisation et ce courrier à la ministre, la Fédération décale finalement la finale, mais la Ligue en profite pour y mettre cinq matchs de championnat. C’était du foutage de gueule.
Guidicelli : Frédéric Thiriez s’est emparé de la date. Il n’en avait que faire de la catastrophe, de la mémoire des victimes, alors que c’est la plus grande catastrophe du football français.
Grassi : Il y a eu une pétition qui a recueilli 40 000 signatures, les politiques locaux se mobilisent, et ça prend de l’ampleur. Lors d’un Le Havre-Bastia, on rencontre Jean-Pierre Louvel, le président de l’UCPF (le syndicat des clubs de Ligue 1 et Ligue 2). Deux heures de discussion et il comprend notre demande. Il nous dit : « Venez à Paris rencontrer les présidents de club, ce n’est pas illogique. » On y va, on sent que certains sont réticents, ils confondaient la démarche du club qui faisait parfois la Une des journaux de la mauvaise manière, de celle du collectif des victimes. Et le soir même, on rencontre pour la seule fois Frédéric Thiriez dans un bar à côté de la LFP.
Guidicelli : Ça se fait en catimini, on nous dit que ces matchs le 5 mai sont liés au logiciel qui programme la saison, aux diffuseurs qui ne peuvent pas changer la date. On contacte beIN Sports, France 2, Canal+, tous nous disent qu’il n’y a aucun souci à ne pas diffuser ce jour-là. On nous disait aussi : « Vous en Corse, vous ne jouez pas si vous voulez, ailleurs on jouera. »
Di Fraya : C’était uniquement de la politique de faire durer ça aussi longtemps. Il y a des intérêts qui dépassent l’entendement. Tout ça aurait pu être fait en un an. On n’est pas idiots, on sentait qu’il y avait beaucoup d’enjeux et qu’il y avait un rapport de force. Le sport était dépassé.
Grassi : Thiriez nous écoute, mais pas plus, on sent qu’il n’est pas convaincu. Ce n’était pas important pour lui. Je lui dis : « Est-ce que ça pose un problème si on communique sur cet entretien ? » Lui ne voulait pas. Finalement, peu après, la décision est prise qu’il n’y ait plus de matchs de championnat ce jour-là. Nous, on pense que ça va être pérennisé, et en fait, ce n’est pas le cas… En 2019, cinq rencontres sont programmées le 5 mai.
Guidicelli : En 2015, Thierry Braillard, alors ministre des Sports, avait fait poser une plaque au ministère et il a précisé qu’il n’y aurait plus de matchs le 5 mai si ça tombait un samedi. Bon, c’est ridicule, mais c’est déjà une avancée. En 2019, avec tous ces matchs le 5 mai, on voit le soutien dans toute la France.
Grassi : À Nantes, Paris, Marseille, on voit des banderoles pour interdire définitivement les matchs le 5 mai. Il y a une prise de conscience nationale.
![]()
Guidicelli : C’était incroyable. On passe un stade supérieur, et nos élus corses amènent jusqu’à l’Assemblée nationale un dépôt de loi. Même s’il y a eu un gros lobbying de la FFF pour que cette loi ne soit jamais discutée.
Grimaldi : Il aura fallu 28 ans pour avoir une loi, vous imaginez ?
Grassi : Quand le vote a lieu, à l’Assemblée, on y est avec le collectif. Ce n’est pas le vote qui m’a fait venir les larmes aux yeux, mais plutôt la prise de parole des députés. On a souvent des images négatives de nos élus, mais là chacun qui s’est exprimé connaissait le dossier et l’avait bossé. Je pense notamment à Marie-George Buffet et des élus de tout bord. Les gens avaient compris ce qu’il s’était passé.
Grimaldi : Furiani, ce n’est pas politique, on n’avait pas à être dans le viseur. C’est avant tout un événement sportif qui a mal tourné. Mais dans le foot, il y a de l’argent à gogo, il faut faire en sorte que ça convienne à tout le monde. Dans une autre activité, ça aurait probablement été plus vite.
Grassi : D’ailleurs, la Fédération française de football n’a jamais reconnu sa part de responsabilité dans cette affaire. À l’époque, Noël Le Graet était à la Ligue, et Thiriez responsable du cabinet d’avocat de la Fédération… Je n’affirme rien, mais c’est étonnant.
***
Trente ans plus tard
Guidicelli : La loi a apaisé tout le monde. Maintenant, on commémore comme il se doit. J’ai pu mener ce combat pour mon père et l’ensemble des victimes. Ça prend aux tripes.
Grassi : Après la tragédie, c’était un peu tabou de parler de ce drame, la société a été secouée. Aujourd’hui, les jeunes autour du Sporting ont intégré cette tragédie. Avec le collectif, on intervenait il y a peu au centre d’entraînement d’Ajaccio. On parlait des différentes tragédies dans les stades, et ça parlait à des jeunes de 17-18 ans, c’est très important.
Guidicelli : Notre plus belle victoire, c’est que les jeunes et les gens sur le continent se soient approprié ce drame. On passe aussi souvent dans les établissements scolaires pour ne pas oublier. Le travail de mémoire est indispensable.
Grassi : Personnellement, j’ai encore des cicatrices au visage, quasiment tous les jours à un moment ou un autre il y a quelque chose qui vous rappelle ce drame. Ça peut être très furtif ou plus long.
Guidicelli : Même sans avoir été au stade, j’ai la peur du vide. Je ne peux jamais me mettre en hauteur.
Grimaldi : Encore aujourd’hui, si l’on vient derrière moi et que l’on fait basculer mon fauteuil par surprise, je ressens immédiatement ce qu’il s’est passé à Furiani. Tout comme le bruit de ferraille. Le corps humain peut mettre des choses de côté, mais pas tout. Heureusement, mes proches ont été là pour m’aider à me battre au quotidien. Je l’ai aussi fait pour ma sœur. J’ai appris à conduire, j’ai fait des activités sportives, je suis allée à la neige. Je comble le manque pour ne plus penser, mon caractère s’est accentué. Cogiter, ça m’aurait tuée.
Di Fraya : Je ne suis plus le même qu’avant le 5 mai 1992. Je suis bastiais, j’étais capitaine à l’époque, j’habite presque à côté du stade, beaucoup de choses nous ramènent à cette journée. On a vu une solidarité nationale naître autour de ce match. Un drame peut arriver n’importe où.
![]()
***
5 mai 2022
Guidicelli : C’est la guigne, mais Marseille joue ce 5 mai (en demi-finales retour de Ligue Europa Conférence, NDLR). C’est un match européen qui n’entre pas dans le cadre de la loi française. À Bastia, on ira tous se rassembler à la stèle. On ne se voit pas tout le temps durant l’année, mais ce moment est important. Avec un regard, on se comprend, on se réjouit de se retrouver, même si on n’oubliera jamais le drame.
Grassi : Le collectif va se réunir à 16 heures. Il y aura d’innombrables dépôts de gerbes, une prise de parole et une messe à la cathédrale de Bastia.
Grimaldi : Plus le temps passe, moins c’est facile de se rendre à la stèle. En plus, j’ai perdu mon père il y a un an, même si le drame l’a tué en réalité. C’était un vivant mort… Les douleurs physiques sont plus fortes, certaines personnes nous quittent, c’est dur. Je ne suis jamais retournée au stade. Je n’irai pas non plus au match organisé avec les anciens du Sporting.
Faye : J’ai ce droit et ce devoir d’être à Furiani ce jeudi. On doit ça aux victimes. Les quelques jours qui ont précédé ces 30 ans ont été intenses. L’homme que je suis a changé. Depuis ce 5 mai 1992, je vis chaque jour comme si c’était le dernier.
Grande annonce pour l’avenir du VélodromePropos recueillis par Florent Caffery