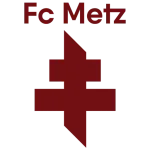- Rétro
- Il y a 40 ans, la Coupe du monde 1966
- Culture Foot
1966 : l’Angleterre pop-foot-mode au top !

Moore, Hurst, Banks, Ball, Peters, Hunt… and the Charlton Brothers ! Les héros du people sont éternels quand le soleil brille sur Londres, que les filles sont belles et que les Scarabées bourdonnent. En juillet 66, ce n’est pas que le foot british qui était champion du monde. Le reste aussi l’était. Wembley 66, ou les dernières flamboyances combatives d’un Empire qui s’adonnait à l’hédonisme d’avant la décadence…
Sunny afternoon. The Kinks. « On avait eu trois gros hits en 1966, raconte Ray Davies, mais je reste émotionnellement attaché à cette chanson parce qu’elle était n°1 en juillet 66. Et on sait tous ce qui s’est passé à ce moment… » Le samedi 30 juillet, à Wembley, Bobby Moore brandissait le trophée Jules Rimet au ciel bleu d’une fin d’aprèm ensoleillée éternelle… Ce jour-là, les Kinks doivent se produire à un festival à Exeter. Mais ils restent barricadés dans la chambre de Ray : « Et comme il y avait eu une prolongation, on est arrivés en retard sur scène, mais le public ne nous en a pas voulu. C’était un jour grandiose… Quand on a gagné la Coupe du monde, ce fut un moment magique. C’était comme si ça devait arriver et c’est vraiment arrivé ! » Qui d’autre que les Kinks, quintessence de la british pop, pouvaient mieux évoquer la victoire des Three Lions ? Fan d’Arsenal, Ray Davies apprit même que ses héros du 30 juillet s’écoutaient souvent Sunny Afternoon durant cette World Cup at home. Une belle petite revanche pour Ray et ses Kinkys : ce titre mondial doublé d’un hit n°1 dans les charts était aussi un peu une réponse à l’interdiction de se produire aux USA, prononcée un an plus tôt alors qu’ils tournaient aux States. De façon cruellement injuste, à cause de ce bannissement, les Kinks ne participèrent pas tout à fait à l’autre sensation planétaire du moment : la British Pop Invasion. Too bad ! Car l’année 1966 fut le summum de la conquête définitive de la pop anglaise aux États-Unis, un territoire commercial et culturel quasi impossible à pénétrer auparavant… En passant la route 66, la tornade GB tsunamiesque avait fait plier l’Amérique : Beatles, Rolling Stones, Animals, Who, Manfred man, Troggs, Them, Yardbirds, Spencer Davis Group, Small Faces… À coups de hits géniaux, d’albums inspirés, de rage électrique et de gigs enflammés, les rockers anglais (et les Mods) avaient redonné l’avantage à l’Empire contre son ancienne colonie. Et la leçon était totale : par le British Blues Boom, c’était aussi les p’tits Anglais blancs qui réapprenaient aux p’tits Américains les racines black de leur propre musique populaire ! En 66, l’Union Jack estampille aux quatre coins du monde la geste héroïque des héros pop des temps modernes. Ce foutu drapeau anglais est partout ! Les Who se taillent même des costards avec…
L’apogée du made in UK
Plus que l’Angleterre, l’Union Jack est en fait l’emblème de Londres, London, épicentre bouillonnant de toutes les cultures, de toutes les modes… La plupart des groupes rock qui en viennent ou qui y vivent véhiculent les nouvelles tendances vestimentaires absolutely crazy. La mod touch tient encore le haut du pavé et attire l’Europe entière à Carnaby Street. Tous les week-ends, les jeunes gens d’Amsterdam, de Paris ou d’Allemagne y convergent pour s’approvisionner en fringues démentes et en disques rares. Et puis, on n’y fait pas le voyage pour rien : « À nous les p’tites Anglaises ! » Car dans les swinging sixties, ce sont les London Girls qui incarnent désormais l’idéal féminin. En rupture avec les canons « pneumatiques » d’Hollywood, Cinecitta ou Paris (Marylin, Sophia, Brigitte), la maigreur un peu androgyne de Twiggy fixe les nouveaux codes d’un esthétisme toujours en noir et blanc, mais qui vire de plus en plus aux teintes flashy, bientôt psyché. C’est de Londres même que la styliste Mary Quant a lancé les mini-jupes qui affolent les mâles. Cette évolution de la jupe minimale qui, au départ, devait permettre aux femmes de courir plus librement « pour attraper le bus » (sic) devient révolution sensuelle quand elle est portée par la longiligne Twiggy ( « Brindille » , en angliche), par la fine Dorothy Mc Gowan (Polly Magoo) ou par la diaphane Jane Birkin. La futur girl-friend de Gainsbarre apparaît pour la première fois dans le film culte de cette année folle, Blow up. Comme pour la musique pop, le cinéma se met à l’heure anglaise et les plus grands réalisateurs déboulent à Londres. Désireux de capter les ondes électrisantes de la Swinging London, Antonioni met en scène une intrigue policière entrecoupée d’un concert furieux des Yarbirds où Jeff Beck brise une guitare sur son ampli. Blow Up sortit la même année que Fahrenheit 451 de François Truffaut, tout comme les deux chefs-d’œuvre de Roman Polanski, Répulsion (1965) et Cul de sac (1966).
Tous tournés à Londres, ces grands films restituent encore à merveille l’extraordinaire et génial mélange des genres que la capitale anglaise avait généré. Et étrangement, les p’tites Françaises s’y distinguent avec une classe toute « parisienne » . Françoise Hardy est tombée pile à la confluence des nouvelles tendances : jeune, jolie, élancée, chanteuse et mannequin, ses mini-robes Courrèges sont la réponse la plus audacieuse aux modèles de miss Mary Quant. Catherine Deneuve, révélée en Angleterre dans Répulsion, a épousé le grand photographe pop David Bailey, et le couple vit en proche banlieue londonienne. Les égéries frenchy côtoient Beatles et Rolling Stones dans les boîtes les plus déjantées. On roule encore anglais à l’époque : les Rolls et les Bentley sont adoptées quand même par les jeunes rock stars qui détournent avec provocation les fastes surannés de l’Empire. Mais c’est bien sûr la Jaguar Type E qui symbolise le mieux la fureur de vivre des Swinging London. Rock & Foot, toujours : Mick Jagger et George Best n’oublient jamais de poser devant leurs bolides Type E décapotables. La British touch impose un style, un art de vivre. Le made in UK est hype : le foot, la pop, la mode, le cinéma, les bagnoles, la Tamise, Big Ben, Westminster, Oxford Street, Hyde Park, les Bobbies, les Horde Guards… Il fallait donc bien qu’une série TV culte ramasse tout ce folklore local qui touche à l’universel. Ce sera The Avengers (Chapeau melon et bottes de cuir, en français), un mix parfait des « old traditions » (Patrick Mc Nee, alias John Steed, gentleman chapeauté et parapluié) et de modernité sexy (Diana Rigg, alias Emma Peel). Un monument d’humour british d’un Londres idéalisé, à la fois tumultueux, mais déjà muséifié…
Quand un Gunner rend hommage à un Hammer
Mais en juillet 1966, le vrai héros anglais n’est ni John Steed, ni James Bond, ni Doctor Who, ni Mick, Paul ou Eric… Le preux chevalier de Sa Gracieuse Majesté Queen Lizzy 2 s’appelle Bobby Moore. Élevé en triomphe par ses gars en tunique rouge, il brandit l’or de la statuette au bleu du ciel. Sa blondeur resplendit au soleil de Wembley. Sunny afternoon forever… L’Angleterre n’a jamais plus gagné la Coupe du monde, et Bobby Moore s’en est allé… « J’ai rencontré Bobby deux-trois fois, car les footballeurs et les pop stars se rencontraient alors souvent à l’époque, se souvient Ray Davies. Je ne le connaissais pas bien, mais c’était un grand leader. C’était un grand bonhomme d’une parfaite dignité, un grand joueur et un exemple pour tous. » L’hommage d’un Gunner à un Hammer. La classe.
Les grands défis de la saison de Kylian MbappéPar Chérif Ghemmour