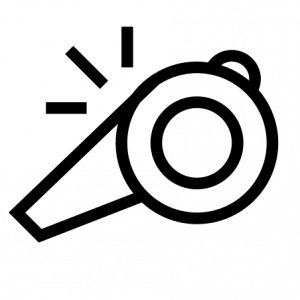- Espagne
- Bilbao
Aritz Aduriz : « J’ai hâte de commencer le reste de ma vie »

Une page se tourne : auteur de plusieurs golazos avec l’Athletic Bilbao, Aritz Aduriz a décidé de raccrocher définitivement les crampons, à 39 ans, sans même attendre de disputer la finale de la Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Rencontre avec un monument de la Liga pressé de voir ce qui se cache vraiment derrière le concept de « petite mort ».
Est-ce que le football a privé le ski d’un champion en puissance ? (Rires.) Ça, on ne le saura jamais. Mes parents, qui étaient moniteurs de ski, m’ont toujours dit que je me débrouillais plutôt bien. À 12 ans, j’ai même été vice-champion d’Espagne de ski de fond. J’ai toujours aimé la montagne. Quand j’étais petit, on allait souvent se balader en famille dans les Pyrénées. On faisait du trek, du ski… Néanmoins, j’ai toujours été obnubilé par le football. J’ai toujours pris plus de plaisir avec un ballon dans les pieds. Au fil du temps, le football a même dévoré toutes mes autres passions. En devenant pro, je n’ai pas souvent eu l’occasion de rechausser mes skis. Ma planche de surf, pareil, ça fait des années que je ne suis pas monté dessus. Ce sont des sports extrêmes incompatibles avec un statut de footballeur professionnel. Du coup, je me suis mis au golf : je ne suis pas très bon, mais ça fait beaucoup de bien au mental. La concentration et le calme qu’exige la petite balle blanche m’ont permis d’oublier celle que je voyais tous les jours.
Tu as commencé le football là où l’ont fait Arteta et Xabi Alonso : sur la plage de la Concha à Saint-Sébastien. C’était comment ?Quand tu viens de Saint-Sébastien et que tu es en club, les premiers vrais matchs que tu disputes, c’est sur cette plage. Quand la marée est basse, la plage devient énorme et le sable très dur. C’est l’endroit idéal pour taper dans un ballon et se mesurer aux autres. Je me souviens que la première équipe qui arrivait le matin devait installer les cages et marquer les lignes pour toutes celles qui joueraient derrière elle. L’équipe qui jouait en dernier était, elle, chargée de tout démonter. En partant, il fallait laisser la plage telle que nous l’avions trouvée à notre arrivée. C’était un système plutôt sympa. À cet âge-là, le football c’est merveilleux. Je fais partie d’une génération qui passait son temps dehors. (Rires.)
T’as l’impression d’avoir l’âme d’un footballeur de rue ?Oui, je suis un produit de la rue, comme tous les amateurs de foot de ma génération. Quand j’étais jeune, les consoles de jeux vidéo n’avaient rien à voir avec celles qu’il y a aujourd’hui, alors on passait notre temps dehors. On jouait dans les parcs, dans des terrains vagues, dans les places. On se servait des bancs publics pour faire les buts et quand il n’y en avait pas, on se contentait de mettre deux pulls par terre. Jouer pour l’amour du geste, juste pour le plaisir, c’est du football à l’état pur. Si t’aimes vraiment ce sport, tu dois avoir joué dans la rue. C’est là que se trouve toute son authenticité.
Aujourd’hui, les jeunes intègrent les centres de formation très vite. Est-ce que tu ne trouves pas qu’il leur manque ça, un peu de foot de rue ?Tous les joueurs devraient avoir cet esprit qu’on retrouve dans le football de rue. Plus jeune, la seule chose que je voulais, c’était courir derrière un ballon. Je cherchais d’autres gamins pour jouer et quand je n’en trouvais pas, je tapais sur le ballon contre un mur. On a tous fait ça, pas vrai ? Les jeunes d’aujourd’hui ont la même passion pour le football, mais ils la vivent différemment. Ils ont beaucoup plus de choses pour s’entretenir. D’ailleurs, si on avait eu tous ces portables, toutes ces consoles et tous ces réseaux sociaux, peut-être que nous aussi, on serait moins sortis de la maison.

Tu as passé une grande partie de ta carrière à l’Athletic Bilbao. Est-ce que tu as l’impression d’être devenu une icône du club ?Pas du tout. Quand je me promène en ville, c’est vrai que je reçois beaucoup de marques d’affection, mais icône c’est un mot très fort… Ce club a été construit grâce à des joueurs fantastiques qui ont laissé une vraie empreinte. Moi… je n’aime pas le mot icône. En tout cas, je n’aime pas qu’on me qualifie de cette manière. Je suis juste un mec normal qui a eu la chance de pouvoir jouer dans le club de son cœur. Je suis un privilégié. Et je continue à le penser malgré le coronavirus. Il est clair que j’aurais aimé dire adieu au football en gagnant la finale de Coupe du Roi contre la Real Sociedad, mais je n’ai pas regrets. Je ne peux pas me plaindre alors que des gens meurent et sont malades à cause de ce virus. Avec le coronavirus, le football a cessé d’être important. Et c’est normal. Ce qui compte vraiment, ce n’est pas ma retraite, mais que tout revienne très vite à la normale pour tout le monde. Et pour ça, il faut soutenir le personnel soignant. On doit tous une reconnaissance éternelle à ces gens-là.
Tu n’aurais pas pu faire une saison de plus ?J’ai déjà beaucoup de kilomètres au compteur, j’ai livré énormément de batailles sur le terrain, et mon corps en a souffert. Quand j’enchaîne les matchs, les entraînements, c’est compliqué… Certains matins, en me levant, il m’est arrivé de me dire : « Aujourd’hui, je ne vais pas pouvoir m’entraîner, c’est impossible. » Mais j’ai toujours réussi à déplier mon corps, à le remettre en route pour aller à l’entraînement. Là, j’ai 39 ans, je suis encore capable de mettre des jolis buts, mais prolonger ma carrière serait une grande erreur de ma part. J’analyse mieux le jeu qu’il y a dix ans, mais mon corps a de plus en plus de mal à faire ce que lui dicte mon cerveau. Donc je préfère que ce soit moi qui décide d’arrêter plutôt que ce soit le football qui me pousse vers la sortie. Je suis très fier que ça se passe comme ça. Beaucoup avant moi n’ont pas eu cette chance.
Quelle a été la clé de ta longévité ?Le plaisir. Si tu ne t’amuses pas, si tu n’es pas bien dans ton club et que tu ne t’identifies pas à lui, c’est plus difficile, je pense. Les entraînements, les matchs, il faut tous les vivre comme si c’était les derniers. Bon évidemment, il faut prendre soin de son corps, mais pour synthétiser : si le moral n’est pas bon, le physique ne le sera pas non plus.
Tu as peur de la petite mort ?J’en avais peur il y a quelques années, mais plus maintenant. Je ne saurais pas dire quand, mais il y a eu un moment où mon esprit s’est libéré de toutes les craintes concernant l’après-football. J’ai fait du mieux que j’ai pu durant ma carrière. J’ai essayé de tout donner, tout le temps. J’ai la conscience tranquille, c’est le moment d’arrêter. J’ai hâte de commencer le reste de ma vie, de tourner la page. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, peut-être que je continuerai dans le football, mais avant de choisir la voie dans laquelle je me sentirai bien, j’ai envie de prendre du temps pour moi. Un peu de recul sur les choses, ça ne fait jamais de mal.

Qu’est-ce qui a changé le plus depuis tes débuts ?Le monde d’aujourd’hui n’est plus celui d’il y a quinze ans. À mes débuts, il n’y avait pas de portables, pas de réseaux sociaux, pas d’internet. Là, on est hyper connectés, hyper informés. En l’espace de quelques années, nos vies ont beaucoup changé. Le football, aussi… Aujourd’hui, il y a tellement d’argent dans ce milieu que n’importe quel jeune qui fait quatre choses correctes devient un produit intéressant. Se retrouver dans une position sociale privilégiée aussi jeune avec des gens qui vous tapent dans le dos pour vous féliciter toute la journée, ça peut faire perdre la tête.
Tu t’es révélé sur le tard. Comment tu l’expliques ?J’ai peut-être mûri trop tard, mais j’ai réellement explosé quand j’ai senti que les entraîneurs me faisaient vraiment confiance. Le premier coach avec qui je me suis senti vraiment bien, c’est Xabi Estebanez. Avec lui, j’avais fait une saison spectaculaire avec les jeunes de l’Athletic Bilbao. Malheureusement, il est mort d’un accident de vélo. Après ça, je n’ai pas su faire fructifier mon capital confiance. Il m’a fallu du temps avant de retrouver un coach qui croyait vraiment en moi. Carlos Terrazas à Burgos (en 3e division) et Sergije Krešić à Valladolid (en 2e division) ont fait partie de ceux-là. À Majorque, Gregorio Manzano m’a également fait me sentir important. Je n’oublie pas Ernesto Valverde. C’est l’entraîneur avec qui j’ai passé le plus de temps. Avec lui, j’ai vécu mes meilleures saisons.
Et Bielsa ?C’est l’entraîneur qui m’a probablement le plus appris. Avec lui, j’ai beaucoup progressé, mais aussi énormément souffert. Il est tellement exigent, tellement extrême, qu’il arrive à sortir des choses enfouies en toi que tu ne soupçonnais même pas. Il m’a clairement fait passer un cap. Grâce à lui, je suis devenu un autre joueur.
Il est complètement fou ou pas ?Bielsa n’est pas fou, c’est un génie du football. Vraiment. Le souci, c’est que son intransigeance, poussée à l’extrême, ne peut pas s’inscrire sur la durée. À un certain moment, ça en devient insoutenable.
![]()
Tu as marqué plus de la moitié de tes buts après tes 30 ans… (Il coupe.) Je suis agacé par les gens qui affirment que le sens du but est juste une question d’instinct. Il y a peut-être des joueurs qui ont plus de flair que d’autres, plus de facilités, mais marquer un but, ça s’apprend. J’en suis la preuve vivante. Je n’en ai pas mis suffisamment pour me rapprocher du titre de Pichichi, mais bon, avec Messi c’est compliqué pour n’importe qui. Je ne sais pas s’il y aura un jour un autre joueur comme lui, ça me semble impossible. Lui et Cristiano Ronaldo sont deux monstres. Aucun être humain n’est capable de mettre cinquante buts par saison comme ils le font. Ce qu’ils font, c’est surhumain.
Justement, ce ne sont pas des avants-centres de métier. Est-ce que le n°9 est en passe de devenir une espèce menacée dans les prochaines années ?Avec le tiki-taka et Guardiola, certaines équipes ont commencé à jouer avec des neuf et demi, mais je ne considère pas avoir été une victime de ces systèmes. J’aurais aimé être convoqué un peu plus en équipe d’Espagne, mais si je ne l’ai pas été, c’était parce que je n’étais pas au niveau des joueurs qui étaient convoqués en sélection. Selon moi, les équipes auront toujours besoin d’un homme obnubilé par le but. Le football se décante par les buts. Si tu n’as personne pour en mettre, tout finit par se diluer. Il y aura toujours des attaquants, j’en suis certain.
Si un gamin veut devenir attaquant, qui doit-il avoir comme référence ?Il y a beaucoup d’exemples à suivre, en réalité. Moi, quand j’étais petit, j’adorais Van Basten. Puis Ronaldo et Romário sont apparus, et évidemment ce sont devenus des références pour n’importe quel type qui voulait marquer des buts. J’aimais beaucoup le style de Romário. Il a mis plus de mille buts sans jamais utiliser la force. Pour marquer, pas besoin de tirer fort, il suffit juste de placer le ballon. Le but, ce n’est pas une question de muscle, mais d’adresse. C’est ce que je me suis toujours efforcé d’expliquer aux plus jeunes.
Pourquoi n’avoir jamais tenté une expérience à l’étranger ?En fait, je n’ai jamais vraiment caressé l’idée de jouer à l’étranger. Et contrairement à ce qu’on raconte, Zubizarreta ne m’a jamais appelé pour signer à l’OM. J’ai parfois été attiré par l’idée de jouer en Premier League, c’est vrai, mais je n’ai jamais sauté le pas. J’étais très bien à l’Athletic Bilbao. Porter ce maillot m’a toujours comblé de bonheur. Être là où on est heureux, c’est le plus important, non ?
Propos recueillis par Aquiles Furlone, à Bilbao
Photos : Markel Redondo et Icon Sport