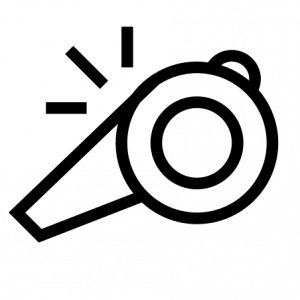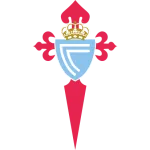- Rétro
- Coupe de la Ligue 2000
- FC Gueugnon
Alex Dupont : « La médaille est toujours dans mes toilettes »

Les Forgerons étaient aussi des pionniers. Première équipe de L2 vainqueur de l’épreuve, en 2000, le FC Gueugnon fut aussi la première formation à venir à bout du PSG en finale de Coupe de la Ligue. La compétition va disparaître cette année, le club a déjà été liquidé (en 2011), mais toujours est-il que l’histoire des deux entités restera à jamais liée, tant l’exploit fut inattendu et colossal. C’était il y a vingt ans. L’occasion de prendre des news du guide des Jaune et Bleu de l’époque, « sir » Alex Dupont.
Alex, déjà, comment ça va ?Eh bien écoute, je me déconfine comme un mec de 65 balais. Bon, ça me permet de me sentir jeune, cette histoire, puisqu’il paraît que ça touche surtout les plus de 65 ans. Je fais gaffe. Normalement, à cette période, je suis au Sénégal, j’ai une baraque là-bas, à Saly. C’est une idée de Bruno Metsu à la base, mon pote d’enfance. Il m’avait dit : « Écoute, on a passé toute notre jeunesse ensemble, qu’est-ce que t’en penses de faire pareil pour notre retraite ? » J’ai dit : « C’est pas con. » Voilà comment j’ai atterri là-bas. Malheureusement, il nous a quittés, ce con-là. Je reviens habituellement en France, sur la Côte d’Azur, entre juin et fin octobre. Mais là, quitte à avoir le COVID, je préférais être soigné en France, tu comprends.
Une partie de l’année sur la Côte d’Azur, l’autre au Sénégal. Vous, le Dunkerquois d’origine, ne supportez plus le froid et la pluie ?C’est une excellente question, je te remercie de me l’avoir posée. Mais en posant la question, t’y as répondu. Dunkerquois d’origine, en effet, et faut dire que là où j’ai entraîné, ce n’était pas toujours le soleil. C’étaient les Ardennes, c’était la Bourgogne, la Bretagne. Bon, j’ai fait quelques mois à Ajaccio, sinon, tout s’est passé souvent au nord de la Loire. Donc j’ai pensé : « Pour ma retraite, ce ne serait peut-être pas con de tenir compte du climat. » Je me suis installé à La Turbie où je vois de temps en temps Didier (Deschamps) au padel.
Comment vous occupez votre temps libre ? Je reste profondément attaché au foot, je ne croyais pas trop à la retraite, sauf en y étant contraint. J’avais l’occasion de continuer, mais pour cela, il m’aurait fallu un projet qui me tienne à cœur : une Ligue 1 ou une équipe africaine, hélas ça ne s’est pas présenté. Reste que je me ferais bien une CAN, je t’avoue. J’ai fait la Coupe du monde 2018 avec le Maroc, en tant que superviseur, parce qu’Hervé Renard m’a sollicité. J’ai supervisé les adversaires dès que le groupe était connu : l’Espagne, le Portugal, l’Iran. Ça m’a fait voyager, j’ai vu des matchs de très haut niveau et j’ai pu aller en Russie superviser les adversaires une dernière fois. Ça, c’était sympa. Je suis dans l’âge de la transmission aujourd’hui, je donne un coup de main à l’académie à trois kilomètres de chez moi, au Sénégal. Maintenant, même si le foot reste mon oxygène, j’ai une autre existence. Il existe une autre vie que le football. C’est une raison pour laquelle je passe une partie de ma vie sur l’eau l’été. J’ai un bateau, je suis dunkerquois, donc je suis un enfant de Jean Bart, tu te doutes bien. Être sur la flotte, j’adore ça.

Bon, l’objet initial de l’interview, ce sont les vingt ans de votre victoire en Coupe de la Ligue avec Gueugnon. Vous avez célébré ça avec les anciens ? Oui, c’était vachement sympa. On s’est vus deux fois, via Zoom, pendant le confinement, à l’initiative de Bouzin et Boniface. Avec tous les joueurs, une grande majorité. J’ai raté Amara Traoré, mais je l’avais vu entre-temps au Sénégal. À part quatre ou cinq, il y avait quasiment tous les joueurs. C’était l’occasion de chambrer, et de se faire chambrer évidemment. Confinement oblige, on n’a pas pu se revoir sur Gueugnon ou faire un match de gala. Le club renaît de ses cendres en N3, les anciens comme Christophe Trivino (le père de Richard, N.D.L.R.) sont très présents. J’ai aimé ce club, laborieux, bosseur, avec une vraie mentalité ouvrière. Quand je suis arrivé, ma mission, c’était de développer l’esprit d’équipe, appliquer la valeur du travail, comme à la chaîne, en gros. Culturellement, il y avait un mélange de foot corporatif et professionnel. Historiquement, les mecs allaient à l’usine et allaient s’entraîner. Comme tu le sais, c’est la capitale mondiale de l’inox. Uginox, puis après Arcelor. À notre époque, bien sûr, l’effectif était entièrement professionnel, mais l’usine était partie prenante sur un plan financier. Les anciens joueurs s’étaient reconvertis là-bas.
On a l’impression que c’est un peu le genre de ville qui correspond à vos valeurs : Gueugnon, Sedan, Brest, Dunkerque. Il y a un patrimoine un peu commun…Ouais, c’est vrai. Quand Georges Bernard m’a sollicité, j’étais dans une phase où j’avais envie de changer d’air. J’avais jamais quitté ma ville en 45 ans. J’ai joué à Dunkerque en pro, dirigé le centre de formation, puis l’équipe première pendant de nombreuses années. J’avais la sensation non pas d’être arrivé au bout du chemin, mais qu’il fallait aussi voyager. Je suis arrivé à Charleville, liquidation judiciaire du club au bout de trois-quatre mois, le club disparaît. J’ai fait six mois à Boulogne dans la foulée, et après, j’ai été sollicité par les Gueugnonnais. Je devais certainement correspondre au profil du mec qu’ils recherchaient, à la culture du club. Pour l’entraîneur que j’étais, c’était un cadre où je trouvais mon compte.
Quand vous repensez à cet exploit en Coupe de la Ligue, c’est quoi le moment clé ?Le match clé, c’est celui qui s’est le moins bien passé footballistiquement : la demi-finale contre le Red Star. Le premier tour est bien évidemment important, on a été gagner à Niort, une référence en Ligue 2, ce n’est pas facile d’aller gagner là-bas, mais bon, sur le coup, tu ne te dis pas que tu vas aller en finale, simplement que ce sera l’occasion, pourquoi pas, de recevoir à Gueugnon. Bref, on s’immisce dans le dernier carré en battant Strasbourg, une référence en L1 à l’époque, pareil pour Toulouse. Et puis il y a le PSG, Bastia et le Red Star. Quand on voit le tirage au sort, on se dit « super » : Paris était fort, et aller jouer à Bastia, ce n’est jamais évident. On a sauté de joie, mais bon, le match, faut quand même le disputer, surtout qu’ils jouaient les premiers rôles en National. D’ailleurs, la coupe leur a coûté la montée, comme à nous, je pense. Sauf que nous, on l’a gagnée, on était moins frustrés.
Du coup, on se retrouve un lundi à 18h au stade Marville à La Courneuve : oulalala. Le contexte ne nous était pas favorable. Face à nous, une équipe déterminée, une très bonne équipe. On a été dominés quasiment tout le match. Avec Georges Bernard, directeur sportif à l’époque, et Gilles Perrin, président, on s’était dit : « Allez, on va faire une semaine de stage pour préparer le match en région parisienne. » Mauvaise idée : les mecs avaient joué 1000 fois le match dans leur tête. Sur le terrain, ils nous ont bousculés physiquement, dans le jeu, on a vraiment lutté pendant les deux heures. On est menés à la mi-temps, je fais entrer Sylvian Flauto, il nous remet dans le match sur un but magistral, d’anthologie, une frappe de 30 mètres dans la lucarne. Le Red Star repasse devant sur un coup de pied arrêté, je crois. Là, tu te dis : « Bon, ça va être compliqué. » Amara égalise juste avant la fin. Ça, c’était le mérite de l’équipe, même moins bien, on ne lâchait rien. En prolongation, je ne pensais pas gagner 3-2, je pensais surtout aller aux tirs au but, parce que je ne voyais pas comment on allait faire pour marquer. On était vraiment dans un mauvais jour. On gagne 9-8, tout le monde a tiré, pas de jaloux ! C’est Richard Trivino, notre gardien, qui nous qualifie en mettant le dernier. Il avait pris la place du regretté Philippe Schuth en cours de saison, vous voyez à quoi ça tient.
Cette finale face au PSG, paradoxalement, on a l’impression que tout coule de source. Vous gagnez presque sereinement.Mon discours a été court : « Maintenant qu’on est en finale, autant la gagner, les gars. » Ce dont j’avais le plus peur, c’étaient les 80 000 spectateurs. C’est un contexte qui ne nous était pas familier. Tu te dis : « Est-ce que les mecs ne vont pas avoir les pieds serrés dans les godasses ? » Et puis Paris jouait chez lui, je m’en suis aperçu quand on est allés chercher la coupe : il n’y avait plus grand monde dans le stade. On n’a pas refait la même erreur que pour la demie : pas de stage ou de mise au vert. Le truc classique, arrivée la veille au soir. Sur l’ensemble du match, ce n’était pas immérité, c’est vrai. Je suis de ces entraîneurs pour qui il n’est jamais question de balancer en attendant qu’un but tombe du ciel, et je ne suis pas non plus obnubilé par l’adversaire. On s’est appuyé sur notre jeu, ne pas jouer aurait été prendre un risque énorme, car il y a bien un moment où tu te fais trucider face à Robert, Okocha, Benarbia ou leur attaquant brésilien (Christian, N.D.L.R.). On a joué sans aucun complexe, il y avait aussi du talent chez nous, et des vrais leaders. Je me rappelle qu’avant le match, Jean-Marc Ferreri, consultant France Télé, vient me voir : « Putain Alex, tenez au moins jusqu’à la mi-temps. » Les mecs avaient tellement peur que les gens zappent ! J’ai répondu qu’on allait s’accrocher. 0-0 à la pause, tu te dis que le temps joue pour toi. Sur 45 minutes, c’est jouable. On prend le jeu à notre compte, et on marque.

Et derrière ? Grosse fête ?Oui grosse, très grosse fête. Le président a fait ce qu’il fallait : il avait loué une boîte de nuit sur les Champs. Ensuite, on est allé au Lido, ça faisait partie du rituel. Je crois que je suis rentré à 4 ou 5h du matin, et j’étais le premier. Le lendemain, on était invités sur les télés, mais on bégayait pas mal. Et puis la fête a continué le mardi, lorsqu’on est rentrés sur Gueugnon : 15 000 personnes au stade Jean Laville, donc plus que les 9000 habitants. C’était émouvant. Le seul regret qu’on peut avoir, c’est qu’on ne soit pas monté. On a joué un match déterminant contre le Sochaux de Jean Fernandez, on perd 3-2 chez nous. On fait un bon match, mais j’avais fait tourner l’effectif en vue de la coupe. Finalement, on ne termine pas loin. C’est un peu dommage de ne pas avoir connu la L1 avec cette équipe. Il y avait du talent et des garçons qui méritaient d’y aller. Certains l’ont fait en quittant le club. C’était le cas de Sylvain Distin ou de Nicolas Esceth-N’Zi, qui a d’ailleurs gagné la Coupe de France deux ans plus tard avec Lorient.
Qu’est-ce que vous avez fait de votre médaille ?On a eu une médaille et une petite coupe. Je les ai mises dans mes toilettes. Je montre ça à mon petit-fils, qui s’est mis au football.
Derrière, vous filez à Sedan, que vous parvenez à hisser en Coupe d’Europe. Avec notamment un mémorable 5-1 infligé au PSG début décembre. Bien sûr mon petit ! Sur le coup, je me dis qu’on va vraiment jouer le titre, ou en tout cas que l’on ne va pas être loin. Hélas, on perd à Nantes un match clé, 4-2, en fin de saison. On perd Nicolas Sachy avant le match, et Cédric Mionnet pendant, qui se fait dégommer le genou sur un tacle de Gillet. Mais pour en revenir à ce match, il m’a valu un coup de téléphone du président, parce qu’après avoir battu le PSG en finale de Coupe de la Ligue, on leur met 5-1. C’était la seule fois que ça leur est arrivé, avant que Lille n’en fasse de même l’an dernier. Laurent Perpère m’appelle et me dit : « Est-ce que vous pouvez m’expliquer comment Gueugnon peut battre le PSG en finale et comment Sedan peut battre le PSG 5-1 ? » C’est à ce moment-là que j’ai été sollicité par l’OM.
Pardon ?Oui, j’ai rencontré le président Louis-Dreyfus en janvier, tout était prêt, je devais partir. Et puis, le président Urano ne s’est pas mis d’accord avec lui.
Vous étiez prêt à quitter Sedan en cours d’exercice alors que vous faisiez une belle saison ?C’est encore une bonne question ! Tout au long de ma carrière, j’ai essayé d’aller au bout de mon contrat. Après, tu ne peux pas être insensible quand Marseille te fait un appel du pied. Là, ça aurait été le premier cas d’un transfert de coach en cours de saison. Je pense que si les présidents s’étaient accordés sur l’indemnité, j’aurais été entraîneur de Marseille. Évidemment, quand t’es coach, c’est la question qu’on se pose : est-ce que ça te fait peur ? Mais à question idiote, réponse idiote : Non, bien sûr que non. Ça ne se refuse pas.
Vous dites souvent : « J’aime bien quand un stade de foot sent la bière et la frite. » J’imagine qu’aux Émirats et au Qatar, si on met de côté l’aspect financier, vous avez dû vous faire un peu chier ?
Je ne suis pas parti simplement pour l’aspect financier et assurer l’avenir de mes enfants, ils n’ont pas besoin de moi, mais pour le challenge des JO. Dans ma tête, au Qatar, je pars pour six mois, parce que je voulais retrouver le championnat de France au plus vite. Et puis, ça s’est tellement bien passé, avec des dirigeants sérieux, que j’étais obnubilé par cette qualif’ aux JO d’Athènes. Dans une carrière d’entraîneur, je pense que ça compte. Au-delà de la qualité de vie, j’ai trouvé des gens qui aiment le foot, bien avant qu’ils aient atteint ce niveau d’implication comme aujourd’hui. Bien évidemment que l’argent est prédominant dans la façon de faire des Qataris, mais ils aiment le foot. Les stades sont vides, mais ils ont contre eux la loi du nombre, qu’est-ce que tu veux y faire ? Il y a moins de licenciés au Qatar que dans le Finistère ! Ils ont des stades de 20 000-30 000 personnes, mais tout est concentré sur Doha, il n’y a pas de potentiel public. Le foot, pour eux, c’est à la télé. Je me suis investi à fond, ma femme est restée avec les enfants en France pour leur scolarité. Je suis resté deux ans. Malheureusement, on ne s’est pas qualifié pour les JO. Quand ils jouent contre les meilleures équipes d’Asie, le Japon, la Chine, l’Arabie saoudite, ils ne passent plus.

Et les Émirats arabes unis, c’est totalement différent ?Totalement. Totalement différent. En qualité de joueurs et de championnat, c’est meilleur. Il y a une population plus importante, c’est un conglomérat de sept émirats. La culture et les mœurs sont similaires, certes, mais Dubaï, c’est plus une vie qui nous ressemble. Ma mission était la même, la qualif pour les JO, cette fois ceux de Pékin, en 2008. C’était Bruno Metsu, qui était responsable des A, qui m’avait sollicité pour les olympiques. Il y a un peu plus de monde au stade, mais ce n’est pas non plus là que tu prends ton pied. Après, ils te donnent tous les moyens pour réussir. Vraiment. Ça m’a donné l’occasion d’aller dans le monde entier, de voir un autre football. J’ai en mémoire une confrontation contre l’Ouzbékistan. On va jouer à Tachkent au mois de janvier. On avait pourtant bien préparé ce match important, en aller-retour. Mais j’ai vu mes joueurs arriver en babouches et en basket à l’aéroport à Dubaï, alors qu’à Tachkent, on allait jouer dans la neige. « Mais vous savez où on va, les gars ? » Il faisait un froid, mais un froid… Les gamins étaient transis. C’était la première fois qu’ils voyaient la neige, alors pour l’entraînement de veille de match, on a fait une bataille de boules. C’était certes convivial, mais bon, niveau prépa…
Et le match en lui-même ?On le perd 2-1. Ils s’en étaient plutôt bien tirés, quand même. Avant le retour, je leur dis : « « Écoutez, on a joué en janvier à Tachkent, il est possible que le match retour, on le fasse cet été à Dubaï avec 50 degrés. » C’est un peu nous qui décidions des dates. On a finalement joué en juin, c’était la fin des championnats, je n’ai pas pu avoir les meilleurs joueurs parce que là-bas, les boss, ce ne sont pas les dirigeants de la fédé, mais les présidents de clubs. D’une, je n’avais pas la meilleure équipe, et en plus, si je m’étais dit que les Ouzbeks ne pourraient pas courir, je n’avais pas envisagé que ce serait également le cas pour nos gars. On a fait un bon 0-0 des familles.
Le plus gros regret de votre carrière, c’est quoi ? L’aventure Ajaccio ?Ouais, parce que je suis convaincu que c’était un club pour moi. J’ai beaucoup aimé. J’ai fait les premiers mois où ça s’était plutôt bien passé, et puis bon… Peut-être que je ne me suis pas assez accroché. J’aurais préféré que l’aventure dure un peu plus. Tous les entraîneurs au haut niveau se sont au moins fait virer une fois dans leur carrière, même si je n’ai jamais entraîné avec la peur de me faire virer. Ça ne faisait pas partie de mon quotidien, en tout cas. Souvent après une défaite, on cherche à expliquer l’inexplicable. Je me souviens, une fois, avec Brest en L1, fin novembre on était bien classés en championnat, on prend une rouste, 2-0 ou 3-0 à la mi-temps, match plié. En conférence de presse, on me demande : « Alors coach, après un match comme ça, qu’est-ce qu’on dit ? » Après un match comme ça, avec rien, le néant, tu peux chercher toutes les explications que tu veux. J’ai répondu : « Vous savez ce que je vais faire ? Je vais aller boire un coup. » Après une défaite, il ne faut pas tout remettre en cause. Inversement, après une victoire, on va parfois se pavaner, alors que c’est là qu’il vaut mieux profiter de cette dynamique pour travailler.
De loin, on se dit que vous avez cette « culture bistrot » . Vous étiez le genre de manager à souder le groupe au zinc ? Bien sûr que ça m’est arrivé ! Bon, tu me parles du monde d’avant. Le rôle d’un entraîneur, c’est certes de définir un cadre de jeu, mettre ses joueurs devant leurs responsabilités, mais c’est aussi de faire ressortir les notions de famille, de joie, d’instinct. La culture d’un club sera toujours plus forte qu’une stratégie quelconque. Après, bien sûr que d’aller boire des coups, ça ne suffit pas, ça se saurait. Mais je pense que l’aspect convivialité et professionnalisme peuvent tout à fait se mélanger. À Brest, il y a plein de bars, évidemment que j’allais au bistrot de temps en temps. Les gens étaient très sympas, on ne parlait pas trop de foot. En revanche, il fallait savoir se sauver, parce qu’avec tous les canons qu’on te payait, tu sortais bourré.

Vous n’étiez donc pas de l’école Guy Roux, vis-à-vis des sorties ?Pas du tout. Évidemment, tout doit rester dans la mesure du raisonnable. Ça aussi, ça se saurait, si les veilles de match, il fallait aller en boîte de nuit se bourrer la gueule pour être bon le lendemain. Mais ce n’est pas comme ça que ça marche. Aujourd’hui, il y a tellement de contraintes physiques que le joueur professionnel se doit d’avoir une hygiène de vie. Moi, je suis un petit peu comme l’État avec le déconfinement, qui demande aux Français de prendre leurs responsabilités. Tu fixes un cadre, avec, à l’intérieur de ce cadre, une certaine liberté. Les mecs qui en sortent s’éliminent d’eux-mêmes.
Y a-t-il, dans le football actuel, un entraîneur qui vous fascine, avec qui vous aimeriez échanger pendant une heure ou deux ?Klopp. Jürgen Klopp, ouais. Je le trouve incroyable. L’entraîneur d’aujourd’hui, c’est à 60% de la gestion humaine. T’as 30 mecs à l’entraînement, adversaires toute la semaine qui doivent devenir partenaires le week-end, avec des états d’âme, les agents qui mettent la pression. La mentalité des joueurs a incontestablement changé, et notre métier a de fait évolué. Je trouve qu’il représente parfaitement l’entraîneur d’aujourd’hui : il sait gérer des hommes, on sent qu’il est respecté, pas adulé, par ses joueurs, on sent qu’il se passe quelque chose entre eux. Il faut qu’il soit à 30% bon tacticien, il l’est. J’aime bien ce qu’il fait tactiquement, un jeu vers l’avant, avec de l’intensité physique, mais pas que. Beaucoup de lien dans son équipe, tu sens beaucoup d’affinité entre ses joueurs, des binômes qui fonctionnent. Et enfin, c’est un très bon communicant, qui aborde son métier avec beaucoup d’humilité. Moi, je me méfie toujours des entraîneurs qui gagnent des matchs et font comme s’ils avaient inventé le football. Il a d’autant plus de mérite parce qu’aujourd’hui, on a tendance à dire que si un entraîneur n’a pas fait une grande carrière de joueur, ça va être compliqué de faire passer ses idées.
Quand la vie normale reprendra son cours et que les huis clos seront passés, quel est le premier stade dans lequel vous souhaiteriez vous rendre ? Si on me donnait le choix, ce serait le premier match de Dunkerque en L2. Je garde une image forte de Dunkerque, en dehors du fait que ce sont mes racines et que j’y ai joué et entraîné. C’est un club qui m’a permis de mettre le pied à l’étrier, avec des gens que j’ai beaucoup apprécié, comme le président Rouvroy. Je les ai suivis depuis le jour où je suis parti. Ils ont vécu un long moment dans l’anonymat, au bord du gouffre même parfois, et là ils remontent en L2, dans un nouveau stade, et avec une volonté politique. En revanche, je n’ai aucune idée de pourquoi l’entraîneur est parti.
Propos recueillis par Marc Hervez