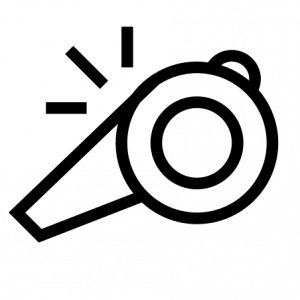Après dix-huit ans de carrière professionnelle, à quoi se résume la vie d’Alain Goma à présent ?
Depuis 2009, je bosse dans l’immobilier au sein de l’entreprise Indigo Development Limited. En gros, mon travail consiste à acheter des terrains avec des maisons, à la détruire et à la reconstruire selon les goûts de mes clients. Je suis un peu promoteur immobilier, en quelque sorte.
Pourquoi l’immobilier et pas un autre domaine ?
J’ai toujours aimé ce secteur. Par chance, je me suis bien entendu avec la personne à qui ma femme et moi avons demandé de construire notre maison en Angleterre en 2008. Il m’a proposé de participer à son projet et c’était parfait : c’était l’occasion pour moi de me lancer aux côtés de quelqu’un d’expérimenté.
Voilà sept ans que tu as pris ta retraite. As-tu vécu ce fameux « coup de blues » que connaissent la plupart des footballeurs ?
Avant d’arrêter en 2008, je prenais déjà des cours de coaching sportif. J’avais donc toujours un pied dans le milieu en m’arrêtant, mais j’avais besoin de voir autre chose. Je faisais du foot depuis trop longtemps pour m’en contenter. Ça n’a bien évidemment pas été facile, on a l’impression de sauter dans l’inconnu, mais je ne le regrette pas. Hormis le fait d’avoir pris un abonnement à Fulham et de suivre le foot à travers mes enfants, je ne me vois d’ailleurs pas revenir dans le foot.
Ta carrière commence à Auxerre, à une époque où le club se stabilise dans le haut du classement. Tu te souviens de tes premiers pas ?
Pas vraiment. En revanche, je me souviens de mon premier match télévisé. C’était le premier match de la saison, on jouait à Nantes et ça a été un calvaire. J’avais appris la veille que j’allais être titulaire et j’ai ressenti une énorme pression ce jour-là. On a finalement perdu 2-1 là-bas, mais ça aurait pu être bien pire. Sinon, il y a aussi la campagne européenne en 1993 que l’on perd face à Dortmund aux penaltys.
C’était perturbant pour toi de toujours changer entre défenseur central et arrière droit au début ?
Oui et non. Disons que si j’ai commencé en tant qu’arrière droit, c’est surtout parce que c’était le poste où j’avais l’opportunité de jouer. Mais il faut avouer que je n’avais pas les qualités nécessaires pour être un bon latéral. J’ai toujours été plus à l’aise au centre pour aller au combat que pour déborder ou dédoubler les ailiers. Bon, il faut quand même avouer que nous avions des consignes. Guy Roux refusait que l’on monte trop haut.
Justement, tu as connu le duo Jean-Claude Hamel-Guy Roux. Penses-tu qu’il existe encore de tels personnages dans le foot actuel ?
Non, tout simplement parce que c’est de plus en plus difficile pour un entraîneur de mener une longue carrière dans le même club. Guy Roux est, en plus de cela, un cas à part : il a formé les premières générations, il est à l’origine du club et de sa crédibilité. Il avait aussi une façon de travailler difficile à instaurer aujourd’hui.
J’imagine que tu as dû connaître pas mal de situations atypiques en le côtoyant ?
Je me souviens surtout des années où j’étais en jeune. À l’époque, je portais des lunettes et je ne voyais pas bien lorsque j’étais sur le terrain. Sur un dégagement du gardien adverse, je mets même une tête complètement à côté du ballon. Guy Roux était présent ce jour-là. Il est venu me voir, m’a pris un rendez-vous chez l’opticien et j’ai eu le droit aux lentilles. Ça a changé ma façon de jouer (rires).
Au cours de ton passage à Auxerre, il y a ce fameux doublé en 1996. Qu’est-ce qu’il s’est passé cette saison ?
Tu sais comment était Guy Roux : chaque année, on faisait profil bas et on visait le maintien. Lors de la saison 1995-1996, c’était pareil, sauf qu’on se retrouve à la deuxième place, juste derrière Paris. Heureusement pour nous, le PSG a fini par ralentir sur la fin, alors que nous, on a gagné nos six derniers matchs. Cette saison-là, ça a été l’aboutissement de la philosophie de Guy Roux, qui avait instauré dès les plus jeunes sections du club un goût prononcé pour la victoire. Du coup, on avait un gros mental et on savait que l’on pouvait éventuellement aller au bout.
Tu te souviens de ce que vous avez fait le soir du doublé ?
Comme le championnat n’était pas fini, on n’a rien fait lorsqu’on a gagné la coupe. On est rentrés de suite à la maison, on a respecté le couvre-feu et on s’est reconcentrés pour la fin de la saison. Le soir du doublé, on a donc fait une grosse fête, mais je ne m’en souviens plus bien (rires).
Vient ensuite le PSG où tu ne restes qu’un an. Comment s’est passé ton transfert dans la capitale ?
La saison avant mon transfert, j’avais plusieurs contacts avec des clubs étrangers, de Premier League notamment. Malheureusement, l’année 1998 a été un peu compliquée pour moi : j’ai eu pas mal de blessures et de problèmes aux ménisques. Assez logiquement, les contacts ne se sont donc pas renouvelés. Le PSG s’est malgré tout proposé et j’ai fait le pari d’y aller. Ça a été une année difficile, mais le projet d’origine était tentant.
Tu regrettes ce choix ?
Non, pas du tout. Ça reste une belle expérience, malgré le fait d’avoir connu trois entraîneurs différents en dix mois. J’aurais d’ailleurs pu poursuivre le challenge, mais l’Angleterre a toujours été mon rêve. Il fallait partir.
Avec le PSG, tu marques un but contre ton camp qui élimine le club de la C3. C’est un match qui t’a particulièrement marqué et qui a été dur à porter ?
Ça reste un mauvais souvenir, oui. Une grosse déception également. Avec tout le respect que j’ai pour le Maccabi Haïfa, c’était une grosse contre-performance pour nous. On s’est fait pas mal tirer dessus par la suite. Moi en premier. Ce que je peux comprendre.
À Paris, tu joues même un match arrière gauche, contre Auxerre. Tu t’en souviens ?
C’est Philippe Bergeroo qui m’avait demandé ça. Il y avait beaucoup de blessés au sein de l’effectif et il fallait absolument marquer Steve Marlet. J’avais déjà joué arrière gauche en jeune. Du coup, l’entraîneur m’a mis là et j’ai accepté pour dépanner l’équipe.
Aujourd’hui, le PSG a pris une nouvelle dimension. Quel regard portes-tu sur sa trajectoire ?
C’est un autre monde. Même le Parc a complètement changé. J’y suis allé l’année dernière et je n’ai rien reconnu. Ils se sont hissés au même niveau que les grandes équipes, que ce soit au niveau des infrastructures ou des joueurs. C’est à l’image du foot en quelque sorte. Le PSG est en phase avec son époque…
En 1999, tu t’envoles pour l’Angleterre et Newcastle pour 40 millions de francs. C’était une forte somme à l’époque…
Ça représentait pas mal d’argent, en effet, mais pas tellement pour un club anglais. À l’époque, Gullit voulait ramener un certain nombre de joueurs européens dans l’effectif afin de faire du beau jeu. Malheureusement, on a enchaîné six défaites d’affilée et c’était la fin pour lui.
Tu as l’air de regretter cette période…
Oui, parce que le changement d’entraîneur a rendu les choses un peu difficiles. Bobby Robson n’avait pas du tout la même philosophie de jeu et d’entraînement. Gullit voulait mettre en place une équipe homogène, sorte de mélange entre joueurs anglais et étrangers, alors que Robson misait davantage sur les joueurs anglais. Forcément, ça a créé des tensions. Les cadres anglais n’aimaient pas Gullit, mais vénéraient Robson. Il y avait donc très peu de copinages et beaucoup de va-et-vient au sein de l’effectif. On ne s’y retrouvait plus. Du coup, c’est vrai, l’expérience est assez mitigée.
Comment était la vie à Newcastle ?
C’était très différent de Paris. J’étais dans le Nord de l’Angleterre, après tout (rires). L’hiver est très sombre, les journées sont très courtes et il faut faire face au vent très puissant à cause de la mer.
Là-bas, tu côtoies des joueurs légendaires, tels qu’Alan Shearer. Ça reste une fierté pour toi ?
Bien sûr ! Ce mec, c’était la puissance à l’état pur, toujours à mettre la tête en premier dans la surface. Mais ce n’était pas le seul. Solano aussi pouvait faire ce qu’il voulait avec le ballon. Sans compter des mecs comme Louis Saha, que j’ai rencontré à Fulham et qui a toujours été, selon moi, l’un des deux meilleurs attaquants français. Il aurait dû avoir sa chance en équipe de France beaucoup plus tôt, tout comme Malbranque.
Tu n’avais pas peur de quitter tout ça en partant pour Fulham, alors en Championship ?
Quand j’ai signé à Fulham, le club avait déjà quinze points d’avance sur le second. Je ne prenais pas un risque fou en y allant (rires). Pour des raisons personnelles, j’ai toujours été attiré par Londres, j’étais donc motivé par le challenge. Le discours de Tigana était parfait, le projet était ambitieux et j’avais l’opportunité de retravailler avec un staff français. Les préparateurs physiques m’ont d’ailleurs permis de soigner un problème de posture non réglée depuis quelques mois en Angleterre. Ils m’ont emmené chez l’ostéopathe, m’ont traité différemment et mon corps était de nouveau équilibré.
Avec Auxerre, Fulham semble être le club où tu t’es le plus épanoui. C’est le cas ?
Complètement. Si Auxerre m’a permis de goûter à plusieurs reprises aux matchs européens, Fulham m’a fait évoluer dans un championnat au niveau très élevé et à la ferveur incroyable. Il faut avoir vu une fois dans sa vie un match en Premier League pour comprendre l’engouement qui y règne. Pour la petite anecdote, un ami à moi, quelques mois avant que je signe à Newcastle, m’avait dit : « Tu vas voir, au coup d’envoi, tu ne vas même pas entendre le coup de sifflet de l’arbitre. » Ça a été le cas.
Avec le recul, si tu devais retenir un joueur qui t’a marqué, ce serait qui ?
Gary Speed, je pense. Non seulement parce que c’était un gars extraordinaire, mais aussi parce qu’il est parti beaucoup trop tôt. Il n’a passé que sept années à Newcastle, mais il faisait partie de l’âme du club.
Tu as aussi été l’un des premiers Français à tenter l’aventure au Qatar. À quel niveau situais-tu le championnat à l’époque ?
Lorsque je suis arrivé, il y avait cinq ou dix équipes en Division 1, mais les matchs étaient épuisants à cause de la chaleur. On s’entraînait sérieusement, mais c’était complètement différent de Fulham. Là-bas, on ne prenait pas soin de nos corps et, physiquement, j’ai commencé à baisser. Ça a duré quatre mois, mais c’était une expérience.
Une expérience motivée par l’argent ?
Pas vraiment, puisque je n’avais pas forcément un gros contrat là-bas. C’était un petit club dans un championnat encore peu développé. Je voulais simplement vivre une nouvelle aventure, découvrir un nouveau pays et m’ouvrir à de nouvelles personnes. Bon, ça a été assez difficile de quitter le Qatar parce que votre passeport est automatiquement confisqué là-bas et qu’il faut respecter toute une procédure pour le récupérer, mais je suis fier d’avoir découvert un nouveau championnat et d’avoir travaillé au côté de Mécha Baždarević.
Pour terminer, peux-tu revenir sur ton parcours en équipe de France ? Court mais irréprochable, au final.
Oui, on peut dire ça (rires). J’ai eu la chance de pouvoir jouer avec toutes les sections de l’équipe de France. Ça a donc été une joie de pouvoir porter le maillot avec les A. La première fois, c’était contre la Turquie en 1996. On a gagné 4-0 et j’ai joué tout le match. La seconde sélection était juste après le Mondial 98, où je remplace Frank Lebœuf contre l’Autriche. Ça reste des bons moments, même si j’aurais aimé joué un peu plus souvent par rapport au nombre de fois où j’ai été appelé.
Et l’équipe de France à l’Euro l’année prochaine, tu y crois ?
C’est difficile à dire pour moi. Je n’ai pas la télévision française et les matchs des Bleus ne sont pas retransmis en Angleterre. Ça fait donc un bail que je n’ai pas vu jouer l’équipe de France.
Fonseca à Milan : mariage raté, divorce rapide