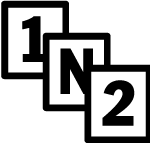- International
- Équipe de France
Jacques Santini : « J’ai été déçu par certaines personnes »

Alors qu’il n’a plus entraîné depuis douze ans, Jacques Santini, 66 printemps, a eu le temps de réfléchir, faire le point et se remettre en question. Le temps est passé, mais certaines plaies ne se sont pas cicatrisées. Enfance, Saint-Étienne, Lyon, l’équipe de France, Zidane, l’ancien sélectionneur des Bleus se confie.
Vous avez traîné toute votre vie une réputation de grand joueur de cartes. Poker ou tarot ? Plutôt tarot et, vu mes origines, pas mal de jeux de cartes italiens.
Quel plaisir jouer vous procure-t-il ? Déjà être en collectivité. Ces jeux réunissent quatre, cinq voire plus de personnes pour des jeux italiens. J’ai baigné dans cette atmosphère, car mes grands-parents et surtout mes parents tenaient un hôtel-bar-restaurant, siège du football dans le village. Certains jeux sont plus de réflexion ou de stratégie comme lorsqu’un entraîneur prépare ses plans de jeu pour son équipe.
Vivre dans cette atmosphère vous a fait mûrir plus vite ? Oui, mes parents travaillaient tous les deux et ils n’avaient guère le temps de s’occuper de nous, et puis, avec une quinzaine ou une vingtaine de copains de mon village ou d’école, on était tout de suite confrontés à des matchs de foot. Mon père était quelqu’un de très réfléchi et mature, peut-être que j’en ai hérité en partie, et je le remercie de ses gènes, si c’est le cas.
Comment vous définiriez-vous en tant qu’homme ? Ce que mon père, ma mère et ma grand-mère paternelle italienne m’ont inculqué, c’est le respect, ce qui existe de moins de moins. C’est pour ça que je suis parfois en bisbille avec mes enfants. Le respect à l’école, bonjour monsieur l’instituteur, des choses comme ça. On a beau me dire qu’il faut évoluer, j’ai toujours eu du mal à m’y faire. Et puis avoir vu mes parents travailler de 7h du matin jusqu’à tard la nuit… Savoir qu’au départ, il ne faut compter que sur soi-même pour pouvoir arriver à atteindre l’objectif qu’on se fixe jeune ou adolescent.

Vous avez remporté quatre titres de champion de France, deux coupes nationales, une finale de Coupe d’Europe, disputé 344 matchs avec l’ASSE et inscrit 50 buts de 1971 à 1981. Quel genre de joueur étiez-vous ? Dans son livre Nos années en Vert, Jean-Michel Larqué a déclaré avoir retrouvé du Jacques Santini dans Andréa Pirlo. Je ne savais pas qu’il avait dit ça, donc je le remercie. (Rires.) Il y a eu deux époques hélas pour moi.
De 1971 à août 1973, j’avais gagné ma place au sein du milieu stéphanois, malgré la concurrence et je m’apprêtais à être sélectionné en équipe de France par monsieur Kovač. J’étais plutôt un numéro dix, dans un 4-3-3 au milieu très offensif. Je marquais beaucoup de buts à l’époque. Mais la blessure m’a fait perdre un peu de puissance et de vivacité, donc je me suis retrouvé dans des zones où marquer n’était pas une priorité. Et je suis tombé avec Larqué et plus tard Platini, des garçons qui ne laissaient que des miettes pour les coups francs et les penaltys, alors qu’avant, je marquais surtout sur coup de pied arrêté. Après ma convalescence, je me suis identifié à Clodoaldo, le milieu de terrain de la grande équipe du Brésil en 1970. C’est pour ça que j’avais pris le numéro 5 à Saint-Étienne.
Quand vous êtes arrivé à Saint-Étienne, vos coéquipiers se moquaient de votre accent franc-comtois. Vous disiez qu’avec Synaeghel, vous étiez les boucs émissaires. Si on traçait une ligne, Franche-Comté et Nord étaient réunis. Après, ça allait de Toulouse à Bayonne et il y avait tous les Sudistes : Lopez, Repellini, Revelli. C’est vrai que Christian et moi-même, on ne parlait pas trop, on subissait le bagou des sudistes et on les chambrait également en retour. Adolescent, c’est important de montrer qu’on ne se laisse pas toujours faire. Quant aux pros, ils nous amenaient leurs chaussures le lundi en nous disant : je les veux pour jouer le samedi ou le dimanche. C’est ce qu’on appelle ou ce qu’on appelait dans les grandes écoles le bizutage des nouveaux.
La frontière entre chambrage et manque de respect ? Tout dépend le sujet sur lequel on taquine le copain ou le coéquipier, mais à partir du moment où on a un respect des valeurs communes… Lorsque la majorité des coéquipiers sont partis et qu’il est arrivé une génération avec laquelle on ne s’entendait pas trop, comme avec Rep, ce genre de joueurs, on n’avait pas été éduqués comme eux, donc ça ne s’est pas très bien passé dans le vestiaire, mais cela ne nous a pas empêchés d’être champions de France, en 1981, date hélas du dernier titre de l’AS Saint-Étienne.

En 1971, vous rencontrez votre épouse dans un bar du centre-ville. (Rires.) On devait jouer un match important le lendemain, mais comme c’était le carnaval de Saint-Étienne, on s’est dit : « On y passe et on n’y reste pas longtemps. » On s’est retrouvé dans un bar tenu par les parents d’un coéquipier : Gérard Migeon. Je commande une tisane camomille, je crois que Sarramagna aussi. Ma future épouse et ses copines ont commencé à nous chambrer. Comme le lendemain on a gagné, j’y suis revenu, et de plusieurs petites rencontres, on a vu qu’on pouvait faire un bout de vie ensemble. On est en 2018, on est toujours ensemble. (Rires.)
À Saint-Étienne, vous montez en puissance, et vient ce 7 août 1973, match au Vélodrome contre Marseille.Il y a des dates qu’on n’oublie pas. C’était le premier match de la saison. Les Marseillais avec leur virilité, leur méchanceté… C’était l’époque où j’évoluais au milieu avec Larqué et Bereta. On les avait étouffés, et Svunka, poussé par deux ou trois Marseillais m’a…
Aujourd’hui, si on était aux États-Unis, il y aurait possibilité de porter plainte. Il n’avait même pas été puni, aujourd’hui il prendrait entre quatre et six mois. Les deux pieds sur mon genou, sous les yeux de mes parents qui étaient au match. Ils avaient fait un détour avant d’aller en Italie, mais au lieu d’y aller, ils sont venus à Saint-Étienne à mon chevet. Pour moi, il y a toujours eu ce point d’interrogation : où serais-je arrivé si je n’avais pas eu cette grave blessure. Il m’a fallu presque 18 mois pour redevenir compétitif. Robert Herbin n’était pas comme les entraîneurs de l’époque, adepte du turn over. Je suis sûr que j’ai loupé entre 60 et 80 matchs toutes compétitions confondues.
Vous avez pardonné à Svunka aujourd’hui ? Non, jamais, jamais. Du moins, je n’en ai jamais eu l’occasion, mais dès lors qu’on jouait l’un contre l’autre, il faisait en sorte de vite changer de côté parce qu’il savait que moi ou des coéquipiers pouvions le sanctionner. Quarante-quatre jours dans le plâtre. Les points de suture que j’ai eu étaient tellement serrés que je n’ai plus jamais réussi à m’accroupir.

Vous avez pensé abandonner ? Je ne sais pas. Je m’inquiétais plus pour ma famille. Elle m’a beaucoup soutenu. Je venais d’être papa de mon premier garçon. J’ai pu remonter plus souvent chez moi, passer des moments avec mon père, avoir des discussions que je n’aurais sûrement pas pu vivre si tout ça ne s’était pas passé. Mais les séances de kiné, lorsqu’il me faisait porter des poids, ont été très difficiles, j’ai hurlé, les autres patients se demandaient qui il égorgeait. À mon retour, les copains étaient en route pour le premier doublé et s’entraînaient pendant que je faisais des tours de terrain. Là, je me suis dit : « Putain, accroche-toi. » Quand Herbin a voulu me prêter à Lille, il n’y a plus eu de copain, j’ai pris le mors aux dents et je me suis dit : « Ah il veut me prêter, il va voir ! » Trois semaines après, je faisais une passe à Revelli et on gagnait le derby. Mais même après ça, Herbin était… C’est pour ça que notre relation a toujours été difficile, je ne comprenais pas. Je faisais un bon match, je marquais deux buts, et la rencontre suivante, il me remettait sur banc. Mais bon, il fallait le respecter. Je lui expliquais mon ressenti, ensuite on se concentrait sur le match suivant. Mais bon, il n’y avait pas que moi. Il n’y avait quasiment que des internationaux dans l’équipe pour 12 joueurs sur la feuille de match. Maintenant, c’est plus facile, il y en a 18.
Parlez-moi de votre relation avec votre fils Stéphane, ancien joueur, comme vous, de l’ASSE. J’essaie d’être près de lui, de lui donner des conseils comme lorsqu’il a voulu commencer à être joueur pro. Tout à l’heure, on parlait de respect et de valeurs, mais quand je vois tout ce que j’ai fait pour certains clubs, certaines personnes qui ne lui tendent même pas la main… Un coup c’est le président, l’autre coup c’est l’entraîneur… J’ai dit au deuxième : « Écoute, j’ai quand même été à ta place à une époque à Lyon ! » On se pose beaucoup de questions, mais on ne peut rien y faire. J’aurais peut-être dû me comporter comme certains le font aujourd’hui. Mais c’est vrai que lorsque son propre fils traverse des situations difficiles comme ça, ça remet les pieds sur terre.
Le monde du football est ingrat ? C’est le monde actuel. Quand on voit l’épisode des enfants de Johnny Hallyday avec leur belle-mère… Mais je dis ça parce qu’on mon fils le mérite. Il avait fait ses preuves dans certains clubs. S’il était nul…
Entraîneur de l’ASSE, vous l’avez lancé en première division. Je ne peux pas dire que je n’étais pas fier, mais il le méritait professionnellement. Mais après, vous entrez en conflit avec des joueurs de l’effectif. Ceux qui ne jouent pas vous disent que c’est parce que votre fils prend leur place. On ne vous fait pas de cadeau et c’est un fardeau que traîne votre gamin.
Pourquoi avoir commencé à entraîner ? Je ne sais pas. (Rires.) Mon père et mon oncle le faisaient. J’avais en moi cette envie de transmettre, déjà en tant que joueur. Quand j’étais blessé, des copains m’avaient demandé d’aller coacher leur équipe amateur et ça m’avait fait du bien.

Sur le papier, votre association à Saint-Étienne avec Élie Baup en 1992 était complémentaire. Pourquoi ça n’a pas marché ? On l’avait un peu mis en pratique à Toulouse, mais hélas, Élie Baup m’a fait un enfant dans le dos comme on dit. Il a voulu jouer sa carte personnelle en me sacrifiant aux yeux des dirigeants et futurs dirigeants de l’époque.
Impossible d’en discuter ensemble ? Je ne sais pas. Quand j’ai fait des fautes par le passé, c’était moi qui faisais le premier pas. Il ne l’a jamais fait et pense qu’il a eu raison de me faire ça, mais c’est sa vie. D’ailleurs, il a de la chance, il est à beIN. Je me demande ce qu’il faut faire pour être à l’antenne comme le font certains. D’autres discutent les choix de Deschamps, alors qu’ils n’ont jamais exercé. Ils ne tiendraient pas une semaine. Je pense que si Emery avait été français, ils n’auraient pas tapé sur lui pendant deux ans comme ils l’ont fait. Cet entraîneur mérite tout le respect avec ce qu’il a fait à Séville et fait un pied de nez à tous ceux qui l’ont critiqué en signant à Arsenal et je pense qu’au vu de l’effectif, il va réussir et au moins revenir dans les quatre premiers.
Pour un ancien Stéphanois, pas difficile de signer à l’OL ?Non, lors de mes deux années comme entraîneur à Saint-Étienne, peu de gens m’avaient aidé et beaucoup s’étaient réjouis de mon départ. Ça m’a servi de motivation lorsque j’ai préparé l’équipe avec Bernard Lacombe. J’ai gagné la première Coupe de la Ligue du club. Lyon n’avait pas gagné de titre depuis la Coupe de France 1973. J’ai gagné le premier titre de champion de France en 2002 et j’ai préparé le terrain pour la suite, ce qui n’est pas vraiment reconnu de la part de la direction lyonnaise, au contraire des supporters.
Vous devenez sélectionneur des Bleus en 2002. Vous partez en juin 2004. 78,5% de victoire, le meilleur ratio pour un sélectionneur de l’équipe de France.Je ne veux pas me répéter, mais j’ai été déçu par certaines personnes qui sont revenues sur leur parole alors que j’avais un contrat de 2 ans supplémentaires si je qualifiais l’équipe pour le Portugal. Après vous savez, on tombe dans ce qu’on appelle le côté politicien du football.
Votre meilleur souvenir en tant que sélectionneur ? Le jour où j’ai voulu proposer à Zinédine Zidane le brassard de capitaine. C’est un bon souvenir, même si je me reproche quelque chose. Quand il m’a reçu chez lui à Madrid, je lui ai proposé le capitanat ce jour-là. Il ne l’a pas refusé, mais m’a dit que si Marcel Desailly continuait, il ne se voyait pas le porter. Peut-être que j’aurais dû l’imposer. Mais en même temps, ce groupe était tellement cimenté… Marcel n’était pas au top pendant l’Euro, et finalement, Zinédine a eu le brassard pendant la compétition, mais ça n’avait pas la même signification. Je me demande pourquoi je n’ai pas foncé.

N’avez-vous été trop respectueux ? Trop respectueux, pas assez fort peut-être dans ma tête et dans mon rôle de sélectionneur. Ça a peut-être fait ma force durant ma carrière, mais ça m’a pénalisé les dernières années.
Vous avez encore envie d’entraîner ? J’aimerais sincèrement si on me le proposait remettre quelques clubs à niveau en France en tant que directeur sportif. À Saint-Étienne, à Lyon ou même un club de L2 ou à Nîmes qui remonte. Faire une année comme Ranieri, faire un deal et remonter, je ne dirais pas non, non plus.
Propos recueillis par Flavien Bories