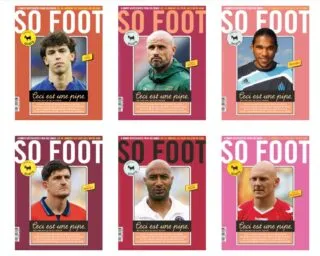- International
- Hongrie
- Interview
Antal Nagy : « Wenger nous motivait comme jamais »

Libéro du Honvéd pendant dix ans puis sentinelle de l’ASNL sous Wenger en 1986-1987, l’ancien international magyar Antal Nagy a troqué ses crampons contre des chemises impeccablement repassées de conseiller financier haut de gamme. Entre deux coups de fil, il parle Mundial mexicain caniculaire, bonhomie d’Arsène, OPA ratée sur son club de cœur avec deux ex-coéquipiers, genoux fragiles, optimisation fiscale et renforcement du français grâce à Lio et aux étiquettes de supermarché.
Tu es un gars du nord-est hongrois né non loin de l’Ukraine. Comment t’es-tu mis au foot ?J’ai touché mes premiers ballons dans mon village natal de Nagyhalász avant d’atterrir à ma majorité en deuxième division à proximité de chez moi à Nyíregyháza. C’était en 1974. Ensuite, j’ai rejoint le SZEOL de Szeged au sud du pays tout près de la Serbie qui évoluait en D1 à l’époque. J’effectuais mon service militaire et j’appartenais de facto au Honvéd. Ils m’ont jaugé en regardant ma saison à Szeged et je me suis relativement bien démerdé. Du coup, j’ai été appelé dès la saison d’après dans l’équipe première. En onze années, j’ai dû jouer un truc comme 290 matchs dans l’élite dont une petite quinzaine au SZEOL. Je te garantis qu’avec une légende comme Lajos Tichy comme coach du Honvéd (ancien du onze mythique des 50’s incluant notamment Puskás, Kocsis, Hidegkúti, Czibor et Bozsik, ndlr), on filait droit.
En 1986, tu fais partie de l’équipe hongroise qui encaisse un humiliant 6-0 d’emblée face à l’URSS. La canicule devait y être pour quelque chose, non ?Absolument pas. Je l’ai dit il y a trois ans au journal Magyar Nemzet et je le répète : ils ont forcément dû mettre une espèce de saloperie dans nos gourdes pour ne pas perdre la face devant les grands pontes de Moscou qui s’étaient pointés exprès au Mexique.
Les types avaient peur de nous, et ça se lisait sur leurs tronches quand ils sont entrés sur la pelouse. La chaleur ne nous avait jamais dérangés jusque-là, et soudainement, on s’est mis à voir du blanc partout. Les panneaux publicitaires se déformaient en les approchant. On se sentait pareil qu’un gars ébloui par le soleil au saut du lit. Qu’un truc comme ça se produise sur un match aussi politique, parce qu’il ne faut quand même pas oublier qu’on appartenait au bloc de l’Est, c’est franchement suspect. Je suis certain qu’il y a eu triche.
Peu avant la Coupe du monde, tu signes à Nancy en même temps que ton compatriote Péter Hannich. Pourquoi la Lorraine alors qu’Anderlecht, le Panathinaïkos et le Betis te couraient après ?Parce que le niveau du foot français était l’un des plus énormes d’Europe à l’époque. Les Bleus avaient gagné l’Euro 1984 et Aldo Platini s’est vraiment plié en quatre pour que le Honvéd me laisse partir là-bas. Anderlecht a proposé jusqu’à 600 000 dollars, une somme colossale, mais le Honvéd rejetait l’offre. Un manager hongrois vivant en Belgique, László Pintér, s’est occupé d’assurer le transfert comme il l’avait déjà fait avec d’autres joueurs hongrois souhaitant partir à l’étranger, sachant que tu ne pouvais quitter le pays qu’à partir de l’âge de 30 ans selon le règlement imposé par le Bureau national du sport. Il était en excellents termes avec le Honvéd et connaissait très bien Aldo qui avait évidemment l’oreille des dirigeants nancéiens étant donné sa longue histoire d’amour avec le club. Les deux parties se sont mises d’accord sur un prix par l’intermédiaire de László, on m’a dit « signe le papier » et j’ai rejoint l’ASNL.
Dans le bataillon du Chardon, on retouve Di Méco, Gava, ton futur bon copain Eric Martin ou David Zitelli débutant chez les pros. Et pour coordonner tout ce petit monde, un certain Arsène Wenger…Arsène débordait de foi, d’optimisme et de sérénité au-delà d’être un entraîneur extrêmement doué. Jamais un mot plus haut que l’autre, des exercices en petits groupes novateurs, un sens de l’écoute…
Il courait avec nous et nous motivait comme jamais, surtout quand on devait se confronter à un gros comme le PSG, l’OM ou le Matra Racing. Il nous disait qu’on était capables de les battre si on y croyait. Arsène avait autant confiance en moi que Mezey ou Tichy. Il m’a nommé capitaine comme je l’étais chez les A et au Honvéd sans l’ombre d’une hésitation et m’a chargé des coups francs que je tirais bien. Je parlais à peine français, mais Nancy m’a accueilli à bras ouverts. Le transfert d’Eric à Paris au mercato d’hiver et quelques défaites frustrantes comme celle contre Toulouse nous coûtent notre place en D1. La relégation m’a donné envie de changer d’air et Arsène filait à Monaco. D’où mon arrivée en Suisse.
Comment apprend-on le français quand on a 30 ans et aucune notion de cette langue ?Il m’a fallu du temps et beaucoup d’efforts. Au début, j’ai pris des cours avec des immigrés, on répétait bêtement ce que disait le prof et ça ne me plaisait pas, donc j’ai demandé des séances particulières deux fois par semaine, quitte à payer un supplément. L’enseignant m’avait à la bonne et j’ai pu progresser plus rapidement de cette façon. Je rassemblais les mots que j’apprenais au fur et à mesure et j’arrivais à construire des phrases cohérentes. J’ai acheté un livre d’expressions, j’apprenais à commander des plats à la cafétéria, je regardais les étiquettes de supermarché histoire de me familiariser avec le vocabulaire de l’alimentation et j’écoutais les tubes francophones qui passaient à la radio afin d’assimiler la musicalité de la langue. J’aimais beaucoup cette chanson sur les brunes, là…
Les brunes comptent pas pour des prunes de Lio ? C’est ça ! Je me disais : « Anti, c’est quoi ce bordel ? Quel est le rapport entre les nanas et les prunes ? » J’ai saisi en l’épluchant que le texte parlait d’une rupture ! Lio passait en boucle sur les ondes. Je mangeais du français sur le terrain, mais mon magyar revenait évidemment au quart de tour quand je ratais une action ou le cadre à l’entraînement. Un jour, un gars de l’équipe me demande pourquoi diable je hurlais « Stamboka ! » et ce que voulait dire ce truc de yougoslave alors que je gueulais « Az Isten fasza ! » (La bite de Dieu, ndlr). Mieux : les mecs répétaient avec leur accent français les « À picsába ! » (Putain, ndlr) ou les « Bazd meg ! » (Va te faire foutre, ndlr) que je sortais histoire d’évacuer ma rage. On avait parfois du mal à communiquer, mais ça s’évaporait direct après deux bières ! (rires)
Depuis 2004, tu es conseiller financier au sein d’un fonds d’investissements dont tu gères l’une des filiales à Budapest avec une petite troupe sous tes ordres. Ça te rappelle le côté managérial du foot ?Il y a un peu de ça, oui. Donner des instructions, organiser une stratégie, négocier la distribution des crédits, répartir les missions entre les employés, c’est comme gérer un club sans stade ni terrain.
Après l’échec de la marque de sports lancée avec mes ex-camarades du Honvéd Márton Eszterházy et Sándor Sallai, je voulais repartir de zéro et de me confronter à un domaine inconnu. L’opportunité s’est présentée et j’ai foncé. Quand tu as été footballeur professionnel, tu as de l’ambition, tu t’habitues à l’importance du résultat et au succès. J’aime avoir un bon job comme celui-ci, une famille unie, être à la tête d’une affaire qui tourne et porter des jolies fringues. La plupart du temps, j’aiguille des entreprises souhaitant mettre du fric dans le foot en échange de déductions fiscales via le programme TAO. Je traite aussi avec des boîtes de BTP et de construction, ce qui colle à ma formation d’architecte. Réunir ses principales passions dans son travail, ce n’est pas donné à tout le monde et j’en profite à fond.
Le patron que tu es devenu aurait bien aimé prendre les rênes du Honvéd, mais l’affaire a capoté…Eszterházy, Sallai, Jószef Andrusch et moi-même avions envie de servir le Honvéd qui avait guidé notre vie. Nous voulions façonner un modèle insufflé par les anciens comme Beckenbauer, Maier et Rummenigge au Bayern, Rudi Völler à Leverkusen, Blanc puis Deschamps avec l’équipe de France… On pensait avoir monté un dossier sérieux, Louis de Vries (célèbre intermédiaire belge ayant alimenté plusieurs clubs flamands et hollandais en joueurs africains, ndlr) s’est impliqué dans le deal et mon ancien coach du Honvéd Imre Komora avec lequel je voulais absolument collaborer m’avait assuré qu’il s’était mis les membres du conseil d’administration dans la poche. Résultat ? Une voix, fiasco complet. On a compris que les intérêts politiques primaient sur le sportif. Le problème vaut aussi pour aujourd’hui, car les grands clubs budapestois sont contrôlés par des amis proches du Premier ministre, tout comme la Fédération hongroise de football. Le pouvoir met un paquet dans des petites équipes qui n’iront jamais loin genre l’académie Puskás ou Mezökövesd au détriment des clubs historiques comme le Honvéd ou le Vasas. Les types sont soumis au régime. Ils te jureront que le sac est blanc alors que tout le monde voit qu’il est noir si le chef dit qu’il est blanc. Ils vont à 70 à l’heure sans essuie-glaces sous une pluie battante et refusent de voir que ça ne tourne pas rond. Le football magyar mérite mieux.
Pronostic Hongrie Allemagne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nationsPropos recueillis par Joël Le Pavous